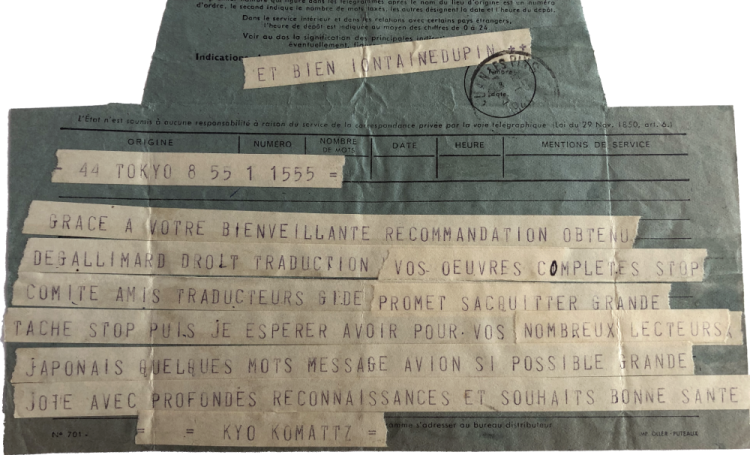Japonisme : le terme, on le sait, apparaît dans les années 1870, chez Philippe Burty, Duranty, Ernest Chesneau et d’autres. Il désigne l’intérêt des artistes, des écrivains et du public – français et étranger - pour l’art d’Extrême Orient dans la deuxième moitié du XIXesiècle1. Un intérêt devenu rapidement une mode et dénoncé comme tel. Champfleury n’hésitait pas à parler dès 1868 de « japoniaiserie2 ». Il n’empêche : peu d’écrivains, de peintres de musiciens y ont échappé, de Loti à Puccini, de Manet à Mallarmé, de Saint-Saëns à Degas, de Monet à Whistler, Tissot, Toulouse Lautrec et bien d’autres3.
Or, cette découverte massive du Japon porte une date, celle de l’ouverture du pays en 1858, sous l’ère Meiji4. Il y a alors comme une déferlante. De nombreux magasins d’objets japonais ouvrent, à Paris et ailleurs. Et, à partir de celle de 1867, le pays est présent à toutes les Expositions universelles.
Certes, il y avait eu quelques contacts antérieurs, notamment à travers le comptoir hollandais de Deshima. La Compagnie néerlandaise des Indes orientales avait d’ailleurs réussi à se réserver, pendant deux siècles, l’exclusivité du commerce avec l’archipel nippon. C’est un des administrateurs de la Compagnie, Isaac Titsingh (1745-1812), qui passe pour avoir apporté, le premier, des estampes mises en couleur. Et c’est Philipp Franz von Siebold (1796-1866), médecin de ladite Compagnie, qui aurait fait connaître Hokusai en Europe.


Dans tous les cabinets de curiosités des cours européennes figuraient des objets chinois, puis japonais. Après la chute de la dynastie Ming, au milieu du XVIIe siècle, les exportations de porcelaine connurent un coup s’arrêt. C’est le Japon qui s’est efforcé de combler le manque. Apparaissent alors les céramiques d’Imari, de Nabeshima ou de Kakiemon. Parallèlement, la production de Blanc de Chine se développe en Europe, à Meissen, notamment, et à Sèvres, si bien que les importations japonaises diminuent à nouveau, mais non pas celles de la laque, restée emblématique pour le Japon et synonyme de pureté, de fragilité et de luxe.
Or, ces motifs orientalisants, que l’on retrouve dans la peinture, le mobilier, les paravents, les tapisseries ou les dessus-de-porte des XVIIe et XVIIIe siècle, caractérisent un art aristocratique. Il sera connoté pendant longtemps encore avec luxe, rareté et raffinement. Ce n’est pas pour leur valeur d’usage que les porcelaines japonaises ou chinoises sont appréciées, mais pour leur valeur d’objet d’art. Inutiles au point qu’elles ont pu servir à Théophile Gautier de justification de l’art pour l’art, par exemple dans sa préface à Mademoiselle de Maupin (1835), un texte que les Goncourt connaissaient bien : « Je suis de ceux pour qui le superflu est le nécessaire, — et j'aime mieux les choses et les gens en raison inverse des services qu'ils me rendent. Je préfère à certain vase qui me sert un vase chinois, semé de dragons et de mandarins, qui ne me sert pas du tout, et celui de mes talents que j’estime le plus est de ne pas deviner les logogriphes et les charades. » Une argumentation retournée en son contraire par le Arts and Crafts Movement et l’Art nouveau, qui, très sensible au japonisme, voudront que chaque objet d’usage soit aussi une œuvre d’art.
Mais le décor orientalisant est un décor parmi d’autres, qui apporte une touche d’exotisme. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, en revanche, cette tendance devient massive. Elle ne répond pas seulement au goût d’un nouveau public bourgeois désireux d’imiter les mœurs de l’Ancien Régime, elle offre aussi de nouvelles opportunités aux écrivains et aux artistes, qui cherchent à s’affranchir de codes esthétiques jugés surannés.
Ces codes, depuis la Renaissance au plus tard, ont eu pour fondement dans toute l’Europe ceux de l’Antiquité gréco-latine. À la base de tout l’édifice, la mimésis, telle que l’avait définie Aristote. Elle a été interprétée différemment, selon les époques et les genres, mais elle n’a pas moins constitué l’axe central de l’art et de la littérature, de Raphaël à Ingres et Delacroix et de Rabelais à Balzac, Flaubert et Zola5. Ce que la description du monde extérieur était à la littérature, la perspective l’était à la peinture et la tonalité à la musique. Or, tous ces repères se trouvent remis en question par les différents mouvements d’avant-garde qui ont voulu se démarquer à la fois du naturalisme et du symbolisme. Il est vrai que l’époque, surtout en France, était à la décadence, définie par Bourget, dans ses Essais de psychologie contemporaine, comme une rupture des hiérarchies, qu’elles soient politiques, sociales ou esthétiques. Sa définition a eu un retentissement énorme.
Par le mot décadence, on désigne volontiers l’état d’une société qui produit un trop petit nombre d’individus propres aux travaux de la vie commune. Une société doit être assimilée à un organisme. Comme un organisme, en effet, elle se résout en une fédération d’organismes moindres, qui se résolvent eux-mêmes en une fédération de cellules. L’individu est la cellule sociale. Pour que l’organisme total fonctionne avec énergie, il est nécessaire que les organismes moindres fonctionnent avec énergie, mais avec une énergie subordonnée. Si l’énergie des cellules devient indépendante, les organismes qui composent l’organisme total cessent pareillement de subordonner leur énergie à l’énergie totale, et l’anarchie qui s’établit constitue la décadence de l’ensemble. L’organisme social n’échappe pas à cette loi. Il entre en décadence aussitôt que la vie individuelle s’est exagérée sous l’influence du bien-être acquis et de l’hérédité6.
Ce qui vaut pour la société, vaut également pour la langue et le style. « Un style de décadence est celui où l’unité du livre se décompose pour laisser la place à l’indépendance de la page, où la page se décompose pour laisser la place à l’indépendance de la phrase, et la phrase pour l’indépendance du mot7. » Une désintégration de la langue que, près de vingt ans plus tôt, un Théophile Gautier avait déjà théorisée, notamment dans ses propres textes sur Baudelaire, comparant son style à celui des Latins de la fin de l’Empire.
Dans cette mise en cause des fondement des codes esthétiques, l’art japonais – ou généralement d’Extrême Orient – sert d’argument, voire d’arme. C’est bien ainsi que l’ont compris les Goncourt. « L’art n’est pas un – notent-ils dans leur Journal en janvier 1862 déjà –, ou plutôt, il n’y a pas un seul art. L’art japonais est un art aussi grand que l’art grec. L’art grec, tout franchement, qu’est-il ? Le réalisme du beau. Pas de fantaisie, pas de rêve. C’est l’absolu de la ligne. Pas ce grain d’opium, si doux, si caressant à l’âme, dans la figuration de la nature ou de l’homme8. »

Les Goncourt, on le sait, se sont toujours considérés comme des précurseurs, des précurseurs méconnus, à qui d’autres ont volé la vedette. Le cas le plus fragrant étant celui de Zola, qu’ils ont accueilli comme leur disciple – il s’était lui-même déclaré comme tel –, mais qu’ils ont accusé par la suite de les avoir plagiés. Ils se sont targués d’avoir œuvré en particulier parmi les tout premiers dans trois domaines. Edmond le rappelle encore dans la préface de Chérie, en 1884. Elle a valeur testamentaire, car introduit à son dernier roman. Et elle a été largement commentée, Edmond l’ayant d’abord publiée dans Le Figaro. Il se souvient d’une conversation avec son frère déjà diminué par la maladie :
Ça ne fait rien vois-tu, on nous niera tant qu’on voudra… il faudra bien reconnaître un jour que nous avons fait Germinie Lacerteux…. Et que « Germinie Lacerteux » est le livre-type qui a servi de modèle à tout ce qui a été fabriqué depuis nous, sous le nom du réalisme, du naturalisme, etc. Et d’un ! Maintenant par les écrits, par la parole, par les achats… qu’est-ce qui a imposé à la génération aux commodes d’acajou, le goût de l’art et du mobilier du XVIIIe siècle ?... Où est celui qui osera dire que ce n’est pas nous ? Et de deux ! Enfin, cette description d’un salon parisien meublé de japonaiseries, publié dans notre premier roman, dans notre roman d’En 18.., paru en 1851… oui, en 1851… — qu’on me montre les japonisants de ce temps-là… — et nos acquisitions de bronzes et de laques de ces années chez Malinet et un peu plus tard chez Mme Desoye… et la découverte en 1860, à la Porte Chinoise, du premier album japonais connu à Paris… connu au moins du monde des littérateurs et des peintres… et les pages consacrées aux choses du Japon dans Manette Salomon, dans Idées et sensations… ne font-ils pas de nous les premiers propagateurs de cet art… de cet art en train, sans qu’on s’en doute, de révolutionner l’optique des peuples occidentaux ? Et de trois ! Or la recherche du vrai en littérature, la résurgence de l’art du XVIIIe siècle, la victoire du japonisme : ce sont, sais-tu, ajouta-t-il après un silence, et avec un réveil de la vie intelligente dans l’œil, — ce sont les trois grands mouvements littéraires et artistiques de la seconde moitié du XIXesiècle... et nous les aurons menés, ces trois mouvements… nous pauvres obscurs. Eh bien ! quand on a fait cela… c’est vraiment difficile de ne pas être quelqu’un dans l’avenir9.
Chacune de ces affirmations mériterait d’être précisée et nuancée. Il est vrai que leur place dans le roman français, entre Balzac et Zola, a souvent été sous-estimée10. C’est que la Troisième République, qui a établi la liste des auteurs canoniques qui est en bonne partie encore la nôtre, ne les portait pas dans son cœur. Réactionnaires, misogynes, antisémites, ne sont-ils pas infréquentables11 ? Nonobstant la bonne compagnie que leur font Flaubert, Baudelaire et quelques autres… Quant à la réhabilitation du XVIIIe siècle, on a pu montrer qu’elle avait été plus que simplement entamée dès la Monarchie de Juillet12. « Le grand siècle, c’est le XVIIIe que je veux dire », proclamait Michelet à l’ouverture d’un de ses cours. La réhabilitation concernait également l’art, le retour à Watteau, à Chardin, à Greuze ne se traduisant pas seulement à travers la critique, dont témoignent par exemple les nombreux articles dans L’Artiste, mais aussi et surtout par l’évolution des prix sur le marché et ceci vingt ans avant les premiers textes et les premières acquisitions des Goncourt13.
C’est peut-être dans le domaine du japonisme que les deux frères ont été vraiment pionniers, encore que la préface de Chérie arrange un peu les choses. Car ce ne sont pas des « japonaiseries » provenant de la province de Yamato, qui ornent le salon du héros dans l’édition originale d’En 18.., mais des « chinoiseries » originaires de celle de Kouëi-Tchou. Mais il est vrai qu’ils achetèrent dès 1851 deux brûle-parfum en bronze Tonkin et qu’ils étaient clients chez « la grosse madame Desoye », rue de Rivoli14. La Porte Chinoise, magasin de thé et d’objets chinois et japonais était située rue Vivienne. Le Journal garde le souvenir de plusieurs de leurs passages. Ainsi de celui du 8 juin 1861 : « J’ai acheté l’autre jour à la Porte Chinoise des dessins japonais, imprimés sur du papier qui ressemble à une étoffe, qui a le moelleux et l’élastique d’une laine. Je n’ai jamais rien vu de si prodigieux, de si fantaisiste, de si admirable et poétique comme art. Ce sont des tons fins comme des tons de plumage, éclatants comme des émaux ; des poses, des toilettes, des visages, des femmes qui ont l’air de venir d’un rêve ; des naïvetés d’école primitive, ravissantes et d’un caractère qui dépasse Albert Dürer ; une magie enivrant les yeux comme un parfum d’Orient. Un art prodigieux, naturel, multiple comme une flore, fascinant comme un miroir magique15. »
Le Journal permet de suivre année après année leurs acquisitions, qui rejoignent, à partir de 1868, leur maison d’Auteuil, admirablement décrite par Edmond dans La Maison d’un artiste, en 1881, et dont près de la moitié du deuxième tome est consacrée au « Cabinet de l’Extrême Orient ». Très vite, l’art oriental prend la même importance que celui du XVIIIesiècle, leur époque de prédilection, le siècle de leurs origines, leur Antiquité. Il lui avait consacré une quinzaine de livres d’histoire et d’histoire de l’art. Mais voici qu’Edmond note dans son Journal, sous la date du 11 janvier 1876 : « Depuis que mes yeux prennent l’habitude de vivre dans les couleurs de l’Extrême-Orient, mon XVIIIe siècle se décolore : je le vois grisaille16. » Il aurait voulu consacrer à l’art japonais une série d’études aussi importantes que celles qu’il avait consacrées à L’Art du XVIIIe siècle. Deux parties au moins seront exécutées, une monographie sur Outamaro, publiée en 1891, et une autre sur Hokusaï, publiée en 1896, quelques semaines avant sa mort. Il avait aussi pensé à Korin et à Ritzino « deux célèbres peintres et laqueurs », voire à Gakutei, « le grand artiste sourimonos, celui qui, dans une délicate impression en couleur, sait réunir le charme de la miniature persane et de la miniature du Moyen Âge européen17 ».
Ce que les Goncourt demandait à l’art japonais, c’est ce réalisme poétique qui les avait enchantés chez Watteau. Outamaro n’est-il d’ailleurs pas « le Watteau de là-bas18 » ? Ce qui les séduit, c’est l’alliance d’une extrême précision et d’une imagination parfaitement libre, exactement ce qui séduit aussi Coriolis dans Manette Salomon (1867). Ils pensent que le japonisme pourrait révolutionner la tradition picturale, que l’impressionnisme lui doit ce qu’il a de meilleur, les teintes claires, que la perception même que nous avons de la réalité pourrait être renouvelée19. Réagissant à la polémique qu’avait suscitée sa préface de Chérie, Edmond précise ainsi sa pensée :
« Au fond, dans les colères contre ma préface, ce qui m’étonne, c’est le peu d’ouverture de ces intelligences de journalistes, de reporters qui blaguent tous les jours l’absence de sens artistique chez les bourgeois. Je parle par exemple du japonisme, et ils ne voient dans une vitrine que quelques bibelots ridicules, qu’on leur a dit être le comble du mauvais goût et du manque de dessin. Les malheureux ! Ils ne se sont pas aperçus à l’heure qu’il est que tout l’impressionnisme – la mort du bitume, etc. – est fait par la contemplation et par l’imitation des impressions claires du Japon. Ils n’ont pas davantage observé que la cervelle d’un artiste occidental, dans l’ornement d’une assiette ou de n’importe quoi, ne conçoit et ne crée qu’un décor placé au milieu de la chose, un décor unique ou un décor composé de deux, trois, quatre, cinq détails décoratifs se faisant toujours pendant et contrepoids, et que l’imitation de la céramique actuelle du décor jeté de côté sur la chose, du décor non symétrique, entamait la religion de l’art grec, au moins dans l’ornementation. […] Et quand je disais que le japonisme était en train de révolutionner l’optique des peuples occidentaux, j’affirmais que le japonisme apportait à l’Occident une coloration nouvelle, un système décoratoire nouveau, enfin, si l’on veut, une fantaisie poétique dans la création de l’objet d’art, qui n’existait jamais dans les bibelots les plus parfaits du Moyen Age et de la Renaissance20. »

Cette mode du japonisme, Gide l’a évidemment enregistrée, comme il a enregistré tous les mouvements artistiques et littéraires de son époque. Curieux de tout, on le voit pousser, en 1902, la porte du magasin de Bing, comme l’avaient fait les Goncourt avant lui :
« Chez Bing. Un peu submergé. Admirable petite salle du fond où sont les kakémonos du XIIe siècle chinois et du IXe siècle japonais. Car il est admirable que le Japon ait eu trois siècles d’avance sur la Chine. Pourquoi ? Le bouddhisme y aurait-il plus tôt pénétré ? Car il me semble impossible qu’une pareille pousse artistique ne soit pas l’accompagnement d’une urgence religieuse. Il faudrait regarder cela21. »
L’angle sous lequel Gide aborde cet art n’est pas du tout celui des Goncourt. Ce qui retient l’attention de ceux-ci, ce sont les questions purement esthétiques, alors que l’intérêt de Gide est anthropologique. « Rien ne m’intéresse dans un livre, que la révélation d’une attitude nouvelle devant la vie. » Mais, lecteur compulsif, il a tout lu ou presque : « Je lis tout Goncourt à la fois ; c’est-à-dire que je suis à la fois dans les lettres de Jules, dans leur Journal, dans le livre de Delzant sur leur œuvre… Quelles vulnérables natures !... J’ai beaucoup réfléchi sur eux et autour d’eux ; mais noter, si mal que ce soit, ce que je pense, me forcerait d’écrire à nouveau lentement, et c’est surtout ce qu’ici je veux éviter22. »
Gide aurait encore pu connaître Edmond, mais il ne semble pas l’avoir croisé. Il lui avait pourtant adressé Le Voyage d’Urien, sur Hollande antique, avec les figures intercalées de Maurice Denis, ainsi que Paludes (orthographié par erreur Palindes23). Mais son nom n’apparaît pas dans le Journal d’Edmond. En revanche, Gide s’est amusé des récits que lui faisait Jacques-Emile Blanche, qui n’estimait pas beaucoup les deux frères, des rencontres d’Edmond avec son père. Mauvais observateur, Edmond n’aurait le plus souvent « rien vu, rien senti, rien compris ». « Il n’était pas du tout intelligent. » Ce à quoi Gide répond : « Les paroles qu’il prête aux uns et aux autres, si fausses qu’elles soient d’après vous, ne sont presque jamais inintéressantes. Faites attention que, plus vous le diminuez comme sténographe, plus vous le grandissez comme littérateur, comme créateur24… » Gide a lu les Goncourt très tôt et fort assidument. À en croire le catalogue de la vente de sa bibliothèque, en 1925 — qui devait financer son voyage en Afrique —, il possédait une quinzaine de leurs livres25. Certains titres, il les a lu crayon en main, comme Manette Salomon : « Livre très fatiguant à lire ; c’est une enfilade de perles précieuses ou communes liées les uns aux autres par un fil invisible ; quelque chose de menu, de grêle ; un entassement de menus faits ; des élément d’un excellent livre, mais restés à l’état de documents, n’ayant point été refondus en une masse homogène par la philosophie généralisatrice de l’artiste. »
C’est bien là, aux yeux de Gide, leur principal défaut : les Goncourt sont des naturalistes, voire des empiristes. Contrairement à Zola qui, à ses yeux, n’a jamais été naturaliste. Or, cette manière empiriste n’est pas vraiment française, c’est même « l’effort le plus antifrançais qui ait été tenté ». « On devrait laisser cela à l’Allemagne. » C’est ce que répond Gide en 1905 à une enquête sur le classicisme. Grâce à Peter Schnyder et à son récent volume, Parcours critique26 (Garnier, 2023), fort utilement pourvu d’un excellent index, on a tout loisir de mettre bout à bout et de comparer les différents jugements de Gide sur les Goncourt, ainsi que sur nombre d’autres écrivains. Plus on avance dans le temps, plus l’auteur des Faux-Monnayeurs devient sévère. Il n’aime pas l’écriture artiste. Elle sent l’effort et la recherche de l’originalité à tout prix. Il n’aime pas la marqueterie de leurs livres. Elle frise le maniérisme. Il n’aime pas le ton péremptoire qui est souvent le leur. Jugements maintes fois confirmés par le Journal : « Gardez-vous de confondre art et manière. La manière des Goncourt, par quoi ils paraissaient si “artistes” de leur temps, est cause aujourd’hui de leur ruine. Ils avaient des sens délicats ; mais une intelligence insuffisante les fit s’extasier sur la délicatesse de leurs sensations et mettre en avant ce qui doit leur être subordonné. On ne lit point une page d’eux où n’éclate entre les lignes cette bonne opinion qu’ils ont d’eux-mêmes ; ils cèdent infailliblement à cette complaisance qui les fait penser : Ah ! que nous sommes donc artistes ! Ah ! que les autres écrivains sont épais ! » La manière est toujours l’indice d’une complaisance, et vite elle devient la rançon. L’art le plus subtil, le plus fort et le plus profond, l’art suprême est celui qui ne se laisse pas d’abord reconnaître. Et comme “la vraie éloquence se moque de l’éloquence”, l’art véritable se moque de la manière qui n’en est que la singerie27. »
Quant au japonisme, même si Gide a lu dès 1902 le livre d’Edmond sur Outamaro (dans lequel il a glané le mot de « naturiste »), il ne semble pas y avoir été particulièrement sensible. Sans doute parce qu’il n’était pas particulièrement sensible aux arts non-européens. On ne peut pas s’empêcher de constater, en lisant les textes réunis dans Parcours critique que, de manière générale, la place faite aux civilisations non-européennes est des plus minces. Le regard de Gide est résolument concentré sur l’Europe, voire sur la France. Une France qui n’a pas encore honte de son universalisme.




[1] Voir, entre autres, le catalogue de l’exposition montrée à Paris (Grand Palais) et à Tokyo, Le Japonisme, Paris, RMN, 1988, ainsi que le livre publié sous la direction d’Olivier Gabet, Japonismes, Paris, Flammarion, 2014.
[2] Champfleury, « La mode des japoniaiseries », La Vie parisienne, 21 novembre 1868.
[3] Voir Yvonne Thirion, « Le japonisme en France dans la seconde moitié du XIXe siècle à la faveur de la diffusion de l’estampe japonaise », Cahiers de l’Association des études françaises, no 13, 1961.
[4] Voir l’anthologie de textes français réunis par Patrick Beillevaire, Le Voyage au Japon, 1858-1908, Laffont, « Bouquins » 2001.
[5] Voir Erich Auerbach, Mimesis, dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur, Berne, Francke, 1946, traduction française, Paris, Gallimard, 1969.
[6] Paul Bourget, Essais de psychologie contemporaine. Etudes littéraires. Edition établie et préfacée par André Guyaux, Paris, Gallimard, « Tel », 1993, p. 14. La citation est empruntée au premier de ces Essais, consacré à Baudelaire, paru en 1881 dans La Nouvelle Revue, avant d’être repris en volume en 1883 ; le chapitre en question est intitulé « Théorie de la décadence » ; sa répercussion a été énorme, il a par exemple servi à Nietzsche pour sa propre théorie de la décadence, développée à partir de Wagner. Voir Robert Kopp, « Nietzsche, Baudelaire, Wagner. À propos d’une définition de la décadence », Travaux de littérature, no 1, 1988.
[7] Ibid.
[8] Edmond et Jules de Goncourt, Journal. Mémoires de la vie littéraire, Paris, Laffont, « Bouquins », t. I, 1989, p. 766. Ce n’est évidemment pas cette version du texte que Gide a pu lire, elle n’a été publiée qu’en 1956, mais celle donnée par Edmond chez Charpentier (9 volumes de 1887 à 1896), expurgée et récrite et que voici : « L’art n’est pas un, ou plutôt il n’y a pas un seul art. L’art japonais a ses beautés comme l’art grec. Au fond, qu’est que l’art grec : c’est le réalisme du beau, la traduction rigoureuse d’après nature antique, sans rien d’une idéalité que lui prêtent les professeurs d’art de l’Institut, car le torse du Vatican est un torse qui digère humainement, et non un torse s’alimentant d’ambroisie, comme voudrait le faire croire Winckelmann. Toutefois dans le beau grec, il n’y a ni rêve, ni fantaisie, ni mystère, pas enfin ce grain d’opium, si montant, si hallucinant, et si curieusement énigmatique pour la cervelle d’un contemplateur. »
[9] Edmond de Goncourt, Chérie, édition critique établie et annotée par Jean-Louis Cabanès et Philippe Hamon, Jaignes, La Chasse au snark, 2002, p. 51-53.
[10] Voir Edmond et Jules de Goncourt, Les Hommes de lettres et autres romans, édition établie et présentée par Robert Kopp, Paris, Bouquins, 2022.
[11] Voir Robert Kopp, « Ces infréquentables Goncourt », L’Histoire, no 270, novembre 2002.
[12] Voir Catherine Thomas, Le Mythe du XVIIIe siècle au XIXe siècle (1830-1860), Paris, Champion, 2003, ainsi que mon introduction à l’édition, dans la coll. « Bouquins », Laffont, 2003, des Maîtresses de Louis XV et autres portraits de femmes.
[13] Voir Jean-Paul Bouillon, « Les Goncourt : apparence et sensibilité », introduction à Goncourt, L’Art du XVIIIe siècle, Paris, Hermann, « Le Miroir de l’art », 1967.
[14] Voir Elisabeth Launay, Les Goncourt collectionneurs de dessins, Paris, Arthena, 1991, p. 73.
[15] Journal, éd. cit., t. I, p. 706-707. Ce passage ne figure pas dans l’édition qu’a pu consulter Gide.
[16] Journal, éd. cit., t. II, p. 678.
[17] Journal, 25 mai 1888, éd. cit., t. III, p. 127.
[18] Ibid.
[19] Voir Bernard Vouilloux, « Les impressions japonaises d’Edmond de Goncourt » et Laurent Houssas, « Les Goncourt et le japonisme », Cahiers Edmond et Jules de Goncourt, no 11, 2004, ainsi que Ting Chang, « Le japonisme, la chinoiserie et la France d’Edmond de Goncourt » et Pamela Warner, « La politique identitaire du japonisme : Edmond de Goncourt et Hayashi Tadamesa », Cahiers Edmond et Jules de Goncourt, no 18, 2011.
[20] Journal, 19 avril 1884, éd. cit. t. II, p. 1065.
[21] André Gide, Journal, t. I : 1887-1925, édition établie, présentée et annotée par Eric Marty, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1996, p. 324.
[22] Ibid., p. 327.
[23] Voir le catalogue de vente, 1897, Hôtel Drouot, Bibliothèque des Goncourt. Livres modernes, no 390, p. 58.
[24] Ibid., p. 331.
[25] Alain Barbier Sainte-Marie, Cahiers Edmond et Jules de Goncourt, no 8, 1997.
[26] André Gide, Parcours critiques. Avec un texte inédit, édition Peter Schnyder, Paris, Classiques Garnier, "Bibliothèque gidienne", 2022.
[27] Journal, éd. cit., t. I, p. 1156