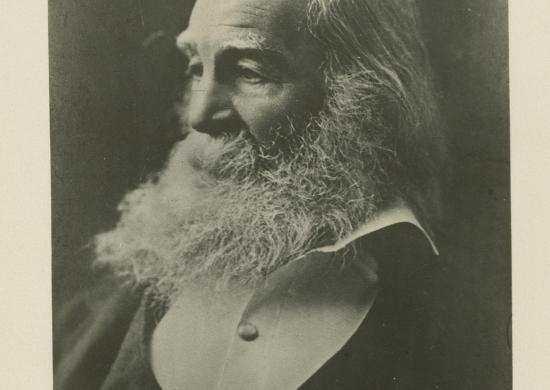Le vendredi 6 juillet 2018, à 14 h, Anne Frenzel a soutenu publiquement à l’Université de Toulon, une thèse consacrée à La Physiognomonie au cœur des Caves du Vatican d’André Gide, devant un jury composé de Jacques-Emmanuel Bernard (Professeur à l’UTLN), Pierre Masson (Président, Professeur émérite, Université de Nantes), Martine Sagaert (directrice de thèse, Professeure émérite à l’UTLN), Peter Schnyder (Professeur émérite, Université de Haute-Alsace). Un sujet original, une manière particulière d’aborder l’œuvre d’André Gide, la condition humaine et notre rapport aux autres.
La physiognomonie, que les adeptes définissaient tantôt comme science (une science qui prétend connaître par l’inspection des traits du visage, et de toutes les parties du corps, le caractère et les mœurs, les vices et les vertus d’un individu), tantôt comme art (un art de tirer des interférences éthiques à partir d’un donné physique), a été appliquée à de nombreux domaines, dans la sphère médicale comme dans la sphère judiciaire, avec tous les dangers que cela comporte, avec toutes les dérives que cela a entraînées — une particularité physique pouvant susciter rejet et stigmatisation (par exemple, selon Lombroso, le tubercule de Darwin est le signe caractéristique d’un être malfaisant).
La thèse d’Anne Frenzel est la suivante. Gide connaît de manière approfondie la physiognomonie en ses répétitions et différences et en ses applications diverses. Juré à la cour d’assises, il a pu observer la théorie physiognomonique en acte et Lavater, le célèbre auteur de La Physiognomonie ou l’art de connaître les hommes par la physionomie, est mentionné dans les brouillons des Caves du Vatican. Et il la parodie pour mieux s’en démarquer.
Gide, selon son habitude, est à l’étroit dans des parcours tout tracés. Il passe outre les principes mêmes de la physiognomonie, il en montre les travers et les erreurs. Il refuse les généralités et les déductions abusives et s’insurge contre les dérives du bertillonnage et de la phrénologie. Il signale les contradictions de la physiognomonie, il démasque ses conclusions simplistes et manichéennes et crée un monde de personnages imaginaires qui ont l’art d’être double, tous caves et subtils. À la vérité unique, Gide oppose les vérités plurielles des expressions, des gestes et des voix. Il varie les éclairages, cultive les différences, privilégie le rare, l’unique. Effectivement la physiognomonie est à l’idiosyncrasie gidienne ce que le pigeon gris est à l’oiseau bariolé, ce que le point de vue globalisant est à la multiplication des points de vue. Aux certitudes et aux affirmations physiognomoniques, Gide oppose le doute et les questionnements, ce qui donne place à la réflexion du lecteur / de la lectrice. À la différence d’un physiognomoniste qui estime délivrer une connaissance scientifique de l’être humain, Gide explore en écrivain les terrae incognitae des personnages de sa sotie,genre théâtral ancien qu’il revisite avec son « drôle » à lui, genre qui permet des jeux multiples sur l’identité et des couplages attendus ou singuliers entre corps et esprit. La force de l’écriture gidienne est dans l’exagération qui cause le rire, dans la richesse polysémique des êtres et des mots, et paradoxalement dans les silences et les non-dits.
Fervente gidienne, Anne Frenzel défend un point de vue original, susceptible d’engendrer discussions et controverses. Un travail de recherche qui enrichit la connaissance de Gide et contribue à son actualité.