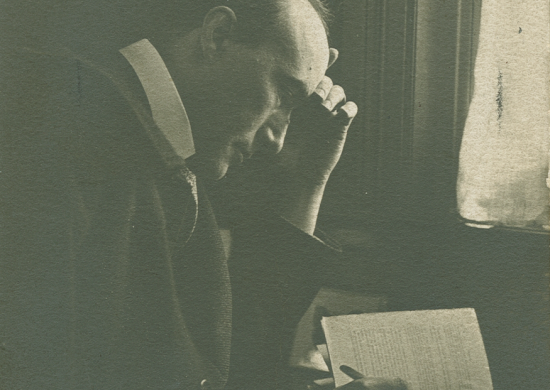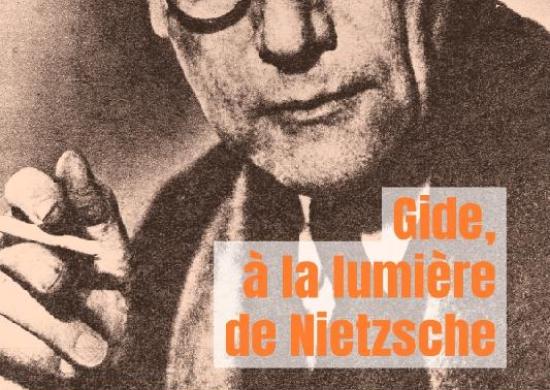Marcel Drouin (alias Michel Arnauld), critique littéraire. De La Revue blanche à La NRF (1900-1925). Édition critique de Stéphanie Bertrand, Pierre Masson et Jean-Michel Wittmann, à paraître aux Éditions Classique Garnier
Voici les grands traits d’un ouvrage, qui ouvre magnifiquement à la personnalité de Marcel Drouin, critique littéraire brillant et discret, que l’entourage – plein de délicatesse – encourage à devenir « important ». Originellement intitulé Marcel Drouin, critique littéraire, ce livre a été récompensé en 2016 par le Prix de la Fondation Catherine Gide du Centre André Gide–Jean Schlumberger de la Fondation des Treilles.
Co-fondateur de La Nouvelle Revue française, agrégé de philosophie, Marcel Drouin, beau-frère de Gide, est une figure majeure de la critique littéraire à l’articulation des XIXe et XXe siècles. C’est principalement au sein de La NRF, de La Revue blanche, et de L’Ermitage, qui participent des revues les plus influentes du début du XXe siècle, que celui-ci – qui craignait d’être incompétent – a successivement recouru aux pseudonymes : Stello, puis M. Gracian, et enfin Michel Arnauld. Les chercheurs d’aujourd’hui s’attachent à mettre en lumière la place de cet intellectuel, qui appartient, du fait de sa formation universitaire, à la critique professionnelle. S’il fut « mal (re)connu » par les anciens critiques, il fut remarqué par Gide dès l’année 1892. Cependant, critique n’est pas son métier premier, il est d’abord professeur, et s’il écrit de nombreux articles, c’est de façon sporadique. Néanmoins, son œuvre est considérable, nonobstant une « mésestime de soi, [qui] contribua certainement à [le] freiner, voire [le] paralyser », alors que sa critique « toujours argumentée », est d’une qualité remarquable. Et, ces écrits sont dans l’esprit de La NRF, ce critique, proche du socialisme, s’éloigne peu à peu du « conservatisme masqué » de Gide. Marcel Drouin est « probe, […], sérieux sans être professoral, parfois ironique sans être méchant, son regard s’efforce surtout d’évaluer la cohérence des œuvres ». Gide lui prodigue moult conseils, qu’il n’écoute pas toujours, alors que Gide lui demande de prendre ses positions :
Si tu fais un ou deux articles, fais-les le plus long, le plus affirmatif, le plus important possible. Bouffis-toi, mon vieux, de toutes tes forces. […] Prends donc tes aises, étale-toi, vautre-toi ; écris donc ce que tu veux et veuille écrire. Éclaircis ta voix, grossis-là ; je sais bien, moi, que tu as toujours plus de choses à dire ; amuse-toi, etc.
En 1905, Marcel Drouin s’intéresse à tout ce qui paraît, mais « repousse sévèrement l’écriture démonstrative dont Paul Bourget fournit un modèle-repoussoir ». Il énonce sa propre doctrine, sur le rôle du critique, qui doit selon lui, déplier, déployer, éclairer, partir de l’impression, sans être doctrinaire. Il souhaite :
[…] une critique d[e] spécialistes, dont le métier est de lire des livres, de tirer de ces livres une certaine doctrine commune, d’établir entre les livres de tous les temps et de tous les lieux une espèce de société.
Devant la monumentalité de son œuvre critique, Marcel Drouin est incité par ses amis à publier sa production. Il hésite, mais trop scrupuleux, abandonne cet attrayant projet, car il ne peut se résoudre à livrer ses écrits, dont certains ne le satisfont plus. Son regard a évolué… Aussi, était-il temps pour les critiques du XXIe siècle de lire et de publier cet ensemble d’articles. À cet effet, un choix a été opéré par Stéphanie Bertrand, Pierre Masson et Jean-Michel Wittmann. Ces trois universitaires présentent, dans leur ouvrage, les analyses les plus pertinentes effectuées sur quelques-unes des œuvres les plus importantes de la littérature française du début du XXe siècle ; ils les ont commentés, contextualisés et regroupés, selon leur distance par rapport à cette actualité, en trois catégories : articles, études, hommages, présentés succinctement ici.
1900, critiques de Drouin dans La Revue blanche
La Route Noire ou Paris Port de Mer, de Saint-Georges de Bouhélier, est l’objet, dans la revue L’Ermitage du mois d’avril, d’un compte rendu de la part de Gide, qui éreinte ce livre encensé par Eugène Montfort. Le 1er avril paraît, dans La Revue blanche, la critique assassine de Drouin. « Voici un pauvre volume de vers, une morne pièce, un ennuyeux et faux roman où de Bouhélier a renoncé au seul don qu’il avait, “le style” »… Les deux critiques – sans s’être consultés – ont de concert accablé de reproches l’auteur de ce livre, laissant paraître au grand jour la distance qui les sépare désormais de ce chantre du naturisme.
Le 15 mai, paraît le deuxième volet de la trilogie du Roman de l’énergie nationale de Maurice Barrès : L’Appel au soldat (Fasquelle). Gide attend de Drouin un compte rendu politique. Ce dernier refuse et écrit un article essentiellement littéraire, car il considère que ce livre est un geste de combat fait pour soulever l’amour ou la haine. Drouin admire Barrès, mais souhaite montrer « les limites de sa construction romanesque », déplorant les artifices de son écriture, comme il a déploré les exclamations ingénues de Montfort. Barrès cherche une doctrine. Il ne la trouve pas. L’écrivain a manqué sa cible, son récit est une « image d’Épinal retouchée par une main d’artiste ».
Le 1er décembre, Marcel Drouin commente Par le fer et par le feu (traduit par Wodzinski et Kozakiewicz). Il s’agit du premier des trois romans héroïques d’Henryk Sienkiewicz, auteur de Quo Vadis ? Par le fer et par le feu, traite de la décadence polonaise et d’une guerre primitive, dans laquelle il reconnaît généreusement le talent : « Nulle part je n’ai lu si belles batailles, si beaux pillages, si belles déroutes. » Cette « progression savamment menée », ravit Drouin : « On attendait un roman, et l’on trouve une épopée », conclut-il.
1901, critiques de Drouin dans La Revue blanche
Le 1er février paraît Messaline (Éditions de La Revue blanche). Ce roman d’Alfred Jarry met en lumière une Rome décrite par Marcel Drouin : secrète et presque souterraine. Séduit, il invite tous les lecteurs à lire ce texte – dont il brosse magnifiquement l’écriture –, approuvant les écarts littéraires de Jarry, qui participeront – assurément – de la jouissance des lettrés. Aussi, est-ce dans une invitation enjouée, que Drouin loue successivement, l’érudition bizarre, la complication de phrases en arabesque, la truculence rabelaisienne et la directe brutalité, parce que le tout aboutit à des « effets plus intenses et plus francs ». Prompt à faire aimer l’œuvre de Jarry, il joue avec les mots, les phrases. Il les contourne, les fait réapparaître, pour mieux les distinguer, et par ricochet, susciter l’intérêt de son lectorat. Convaincant, le critique revient sur chaque détail d’une écriture grandement appréciée, et ainsi légitimée.
Le 15 février, paraît le tome VII des Mille Nuits et Une Nuit, (Éditions de La Revue blanche), dans une traduction littérale et complète du texte arabe du Dr Joseph-Charles Mardrus. Gide avait rendu compte du premier tome dans L’Ermitage et du sixième dans La Revue blanche. Dans cette même revue, Drouin, qui avait accepté l’érotisation au sein de Messaline, manifeste à l’égard du contenu érotique des Mille Nuits et Une Nuit, plus de distance, et il s’appuie sur Mallarmé et Hugo, pour expliciter au lecteur ce qui peut être goûté dans le texte de Mardrus. Puis, il émet un reproche en demi-teinte, soulignant que les images, aussi belles soient-elles, à force d’évocation, s’usent. Mais l’objection est aussitôt contredite, et devient soudain, éloge :
Par sa seule exactitude, la traduction de Mardrus nous livre la psychologie d’une race, et cela même dans les contes où l’intérêt littéraire faiblit…
Le 1er mars paraît Bubu de Montparnasse (Éditions de La Revue blanche). Charles-Louis Philippe, ami d’André Gide, en est l’auteur. Drouin sera le premier à faire la critique de ce roman pathétique. Gide ne l’évoquera qu’en décembre dans L’Ermitage. Les deux critiques en font un auteur du désespoir, qui se complait dans l’univers de la pauvreté. Philippe s’apitoie trop, et ne peut susciter, à cause de sa « mièvrerie maladive », de compassion. Cependant, les deux critiques considèrent de concert que c’est un auteur excellent !
Le 15 mars, Marcel Drouin commente Monsieur Bergeret à Paris (Calmann-Lévy), quatrième et dernier volume de L’Histoire contemporaine, d’Anatole France. Définitivement conquis, il l’encense. Il n’a oublié ni la finesse d’Anatole France à ses débuts – alors qu’il signait ses premiers écrits AF –, ni le talent du chroniqueur le plus subtil de son histoire, ni son assurance lorsqu’il s’affirma, parce qu’il aimait ce qu’il faisait. Anatole France sublime ce qu’il observe autour de lui, et recompose dans l’écriture, en une forme pure, la vie de l’homme contemporain. Utopiste, son personnage éponyme, M. Bergeret, a toutes les qualités de l’homme probe, dont la seule arme contre l’agression, et l’injustice sociale, est la parole ! Le critique ne pouvait qu’être séduit par l’intelligence sensible de cet auteur engagé.
Le 1er avril, Marcel Drouin réfléchit au roman éponyme de Stendhal, Lucien Leuwen. Cette œuvre posthume, écrite en 1834, ne sera pas achevée, car son auteur a craint la censure de la monarchie de Juillet. Lucien Leuwen ne sera publié par Jean de Mitty, qu’en 1894. Drouin, situe cette œuvre – reconstituée à partir des manuscrits originaux – entre Le Rouge et le Noir et La Chartreuse de Parme. Quant à Jean de Mitty, il signale l’ironie de Stendhal, et la nouveauté de ce livre qui part à la rencontre de milieux inexplorés. Drouin est reconnaissant à de Mitty, d’avoir rendu lisibles les cinq cents pages manuscrites d’un roman subtil, dont il apprécie la rigueur de l’écriture et la spontanéité de l’auteur.
Le 15 avril, Marcel Drouin commente Une Histoire des Temps à venir et Récits de l’Âge de pierre, L’Île du Docteur Moreau, de George Wells, publiée en 1896, traduction Henry Davray (Éditions du Mercure de France). Le critique se demande quelle est l’intention de cette œuvre, dans laquelle il voit un conte philosophique ayant en son sein, un peu de Jules Verne, de Stevenson, et d’Edgar Poe. Il conseille à Wells de lire un volume de Villiers de l’Isle-Adam, plus incisif dans son approche de l’anticipation scientifique, car il observe chez Wells, une « philosophie confuse [dont] la fantaisie tantôt s’élève au symbole, tantôt retombe au plus futile amusement ». Mais, pour le critique :
[…] un plus noble intérêt naît, ici, de la comparaison avec l’humanité normale, là, de la comparaison avec l’humanité présente ; ici et là, de cette pensée que la vie humaine n’offre aucun sens en elle-même, et ne prendrait un sens que vue de l’infini.
Le 1er juin paraît Travail, le deuxième volume des Quatre Évangiles (Bibliothèque Charpentier), d’Émile Zola. Drouin voit dans cette série, le développement d’un « idéal moderne devenant action, chair et vie ». Point de chimères chez ce naturaliste, mais une résolution réaliste, qui s’observe dans « le renforcement du caractère par l’accumulation de détails convergents » – formellement éloignée de « la personnification lyrique ». Le critique, qui a beaucoup à dire, souligne que Zola est attaché au déterminisme, et que s’il ne cesse pas de croire à l’hérédité […] il croit toujours davantage à l’éducation libératrice. Drouin voit également dans Travail, une épopée socialiste, dans laquelle Zola a une vision réaliste de l’ensemble et du détail ; il montre ce qui est, sans pour autant donner de solutions ! C’est un idéaliste, qui croit à l’hérédité et à l’éducation libératrice. Le titre de ce deuxième volume ne doit pas nous tromper, surenchérit le critique prolixe : il chante le triomphe des travailleurs plutôt que l’apothéose du travail. Drouin, termine un article généreux :
[…] par une inconséquence heureuse, le livre de Zola n’est pas seulement l’Évangile du Travail, mais encore, mais surtout l’Évangile de la Pensée, de la Justice et de l’Amour.
Le 15 juillet, paraît Les Moujiks d’Anton Tchekhov, traduit par Denis Roche (Librairie académique Perrin). Drouin découvre dans cette nouvelle – éditée pour la première fois en 1880 dans La Pensée russe, le plus ancien hebdomadaire en langue russe publié en Europe – un réalisme triste et minutieux, où l’imagination n’est pas féconde, mais où l’art de Tchekhov, sobre et classique, retient l’attention, parce qu’il atteint la perfection. Néanmoins, il ne voit en Tchekhov, « qu’un excellent homme de lettres qui suit avec amour et conviction les traces des grands romanciers russes ».
Le 15 juillet, c’est en critique conquis, et amusé, que Drouin commente les Nouvelles conversations de Goethe avec Eckermann (1897-1900) (Éditions de La Revue blanche). Cet échange, imaginé par Léon Blum, offre au lectorat français une belle traduction, et mérite tous éloges. « Blum enrichit de mille nuances la large simplicité du texte » – écrit Drouin qui décide de ne pas parler des passages qu’il préfère, mais de ceux où se brouillent les pensées connues de Goethe. Il aurait voulu tout citer, de cette singulière conversation rapportée, interprétée, dans laquelle sont évoquées : la Sémantique, la politique, la morale, la justice, la liberté, notion, qui serait « le privilège des forts, et non pas un droit naturel : L’homme n’est pas né pour être libre ». L’illusion est définitivement dissipée. Drouin retrouve partout Blum ! Il étudie la teneur d’un texte hybride dont il n’est pas dupe ; il connaît trop les pensées du véritable Goethe… – Qui parle tout au long de cet entretien ? Il s’agit bien de Blum, dont il partage ici la plupart des raisonnements, et dont le talent lui renvoie l’image d’Anatole France ! Cette « fiction ingénieuse », est instructive à plusieurs titres, aussi stipule-t-il avec finesse :
[S]i des objections sont possibles contre les arguments du Goethe imaginaire, nous ne saurions les inventer ; je crois qu’elles sont d’avance inscrites dans l’œuvre authentique de Goethe.
Le 15 juillet, Drouin offre au lecteur un moment délicieux en parlant du livre de Franc-Nohain, Le Pays de l’Instar (Éditions de La Revue blanche), et en lui proposant de lire ce volume de « prose malicieuse et sobre », qui n’a d’égal que sa « force comique ».
Le 1er août, Drouin s’apprête, après Gide, à commenter L’Homme qui voulut être roi (Mercure de France) de Rudyard Kipling. Sa critique est dure : Kipling, hier, fut. Aujourd’hui, il n’est plus ! Il loue les traducteurs qui ont su mettre, à l’instar de Gide, les auteurs en valeur. Les œuvres ne sauraient-elles Être sans Eux ? Il surenchérit durement à l’égard de Kipling, après avoir passé en revue les œuvres qui ont ravi ses lecteurs ; grinçant, il rappelle que cet auteur d’outre-Manche aura été :
[…] le premier à tirer des effets du contraste des civilisations entre elles ou surtout avec la barbarie. Il est Anglais sans doute, mais Anglais-colonial ; on comprend que le peuple anglais lui ait voué un pareil culte.
Le 15 août paraît la critique de Drouin sur Almaïde d’Étremont ou l’Histoire d’une Jeune fille passionnée (Société du Mercure de France) de Francis Jammes. Histoire vieillotte et fraîche et candide, scande le critique. Certes, mais les romans de Jammes révèlent, comme ses poèmes, son talent, tout entier « de tendresse et de pitié ». Sans ce penchant, ses romans ne seraient point si savoureux, et sa prose ne serait pas si classique, si juste, toute en nuances, toute en émotions, qui font oublier au critique – quelque peu déconcerté – une certaine mièvrerie, qu’il percevait déjà chez Charles-Louis Philippe.
Le 15 août paraît aussi la critique de Drouin sur La Flèche noire, traduit de l’anglais par E. La Chesnais (Société du Mercure de France), de Robert-Louis Stevenson. Étonnamment, ce roman n’est pas apprécié par son auteur, qui confie à Marcel Schwob qui désirait le traduire – comme il a traduit ses précédentes œuvres, qu’il a cependant été « fier d’avoir conçu un Richard III aussi vivant, et plus possible que celui de Shakespeare », qui était de son point de vue : un mélodrame énorme, noir, épais, traînant, écrit avec infiniment de vigueur, mais sans raffinement ni philosophie. Quant à Marcel Drouin, il concède que « La Flèche noire est un des moins bons livres de Stevenson ; mais c’est un fort bon livre encore » ! Néanmoins, il apprécie, dans ce récit, les moments impalpables liés à l’action, et les lieux évoqués qui représentent les tourments de l’âme des personnages – qui n’ont pas pour but de marquer un territoire, mais la mémoire ! Il a vu chez Stevenson, outre son goût pour les lettres françaises, un besoin irrépressible de vivre et de narrer l’inattendu.
Le 15 septembre, Drouin fait une critique élargie de L’Arbre de Paul Claudel, qui venait de rassembler sous ce titre : Tête d’Or, L’Échange, Le Repos du Septième Jour, La Ville, La Jeune Fille Violaine (Éditions du Mercure de France). Il tente de situer l’œuvre de Claudel dans le paysage littéraire contemporain. Après avoir considéré ses œuvres antérieures, il en déduit que pour juger des cinq drames réunis dans L’Arbre :
Il faut une assez longue étude pour démêler ce qu’ils ont de traditionnel et de classique, et le rapprocher des modèles que le poète s’est choisis : un peu Shakespeare, beaucoup Eschyle, surtout la Vulgate biblique…
Drouin décèle une véritable œuvre d’art née du génie de Claudel, et déploie une magnifique critique, qui s’immerge dans l’abondante frondaison des images, le balancement de lumières et des ombres, la justesse hardie des métaphores, et les courts tableaux, pareils aux comparaisons d’Homère, qui semblent ouvrir, par-delà le drame, de soudaines percées vers l’horizon. Cependant, l’action dramatique qui cherche à se créer une voie d’accès au sein du théâtre ne réussit pas totalement sa mission ; empêchée par de solennels versets bibliques qui figent l’action. Le critique adoube néanmoins la belle œuvre, et devient à son tour, le poète d’un discours critique entièrement reconnu.
Le 15 octobre, Drouin revisite le roman héroïque Le Déluge d’Henrik Sienkiewicz, traduit par le comte Wodzinski et de B. Kozakiewicz (Éditions de La Revue blanche). Il a déjà fait, le 1er décembre 1900, l’analyse de Par le fer et par le feu, où est narrée une Pologne en lutte contre l’ennemi du Sud, Cosaques et Tatars. La deuxième partie de cette trilogie historique relatant une guerre civile en Pologne, soulevée contre l’ennemi du Nord – les Suédois –, ne pouvait que l’intéresser. Le critique pourrait mettre en valeur le récit des exploits imaginaires et des fabuleuses aventures relatées, mais ce serait déplacer l’intention de l’auteur, qui ne souhaite que faire corps avec « l’épopée nationale ». Cela inquiète Drouin, qui observe que Sienkiewicz est tout entier saisi d’une « conviction naïve et grave ». Ce dernier expose ce qui émeut les Polonais : courage constant, amour fidèle, adresse au milieu des dangers, catastrophes subites, secours inattendus, enlèvements, tentations, résistance, union finale des amants. Mais qu’en est-il des chimères qui peuvent conduire le peuple à sa perte ? Le critique, tout en louant le talent de Sienkiewicz, souhaite que la Pologne se réveille, et que la raison vienne pour éloigner les fatales illusions.
Le 1er novembre, M. de Phocas (Ollendorf), de Jean Lorrain, fait le bonheur de Marcel Drouin, qui observe chez cet écrivain – mal-aimé – l’horreur de la banalité, le goût effréné pour de multiples expériences, « tout cela, fortifiant son amour des expressions justes et neuves ». Son esprit vif n’éprouve pas le souci de la perfection ; l’animal produit beaucoup et bien, son domaine d’observation n’est pas étriqué. Et, curieux de tout, il sait « écrire facilement des choses difficiles et joindre la verve au raffinement ». Ce roman, stipule le critique, est plutôt l’œuvre d’un historien de[s] mœurs. « M. Lorrain nous donne ce que lui seul pouvait faire : la chronique vivante et complète des névroses contemporaines. »
Le 1er novembre, Marcel Drouin fait également la critique du roman La Colonne (Stock), de Lucien Descaves. Il passe en revue ses romans précédents, afin de montrer le talent grandissant de l’auteur qui écrit ici, « un roman vrai, un roman plein de choses ». Cela ravit le critique qui déplorait que « le talent de M. Descaves gard[e] un air chagrin, têtu, presque hargneux ». Conquis, il loue ce roman parce que la langue est « sûre », et que l’auteur s’y accomplit. Descaves semble appartenir tout entier à la cause qu’il décrit. Et, le sentiment d’appartenance qui s’en dégage, fait de la colonne Vendôme, un objet de glorification de la guerre, de la force et du génie.
Le 15 novembre, Marcel Drouin analyse Les Amants singuliers (Mercure de France), quatre histoires rassemblées sous une même couverture, d’Henri de Régnier – Gide en fera un compte rendu dans L’Ermitage de décembre 1901, bien que ces nouvelles, « admirablement écrites », ne soient absolument pas dans le courant de la revue, écrit-il à Drouin. Le critique sous-entend qu’il faut connaître l’auteur pour tout comprendre de son écriture, tant les liens sont variés dans ce voyage imaginé. Mais il ajoute que l’on peut l’apprécier pour sa seule perfection ! Son conte préféré semble être L’Aventure de Balthazar Aldramin : on y goûte, dit-il, la valeur nouvelle que donne à la vie l’attente d’un danger mystérieux et certain… Le point de vue de ce critique est plaisant :
Un poète peut choisir de s’exprimer, non seulement par des thèmes sympathiques à sa nature (comme c’est le cas le plus fréquent), ou par des thèmes tout à fait contraires, mais aussi bien par des thèmes indifférents, pourvu que cette indifférence soit sentie.
Le critique s’est lui-même métamorphosé en poète à la lecture des textes d’Henri de Régnier. Et qui n’aime pas la poésie est surpris, et instantanément comblé, par cette critique à nulle autre pareille – à la fois riche et simple.
Le 1er décembre, Le Crépuscule des dieux (P.-V. Stock) d’Élémir Bourges arrive sur la table d’étude de Marcel Drouin. C’est avec enthousiasme qu’il se penche sur ce livre qui lui « paraît meilleur qu’au premier jour ». Fait, comme la musique de Wagner, pour résister au temps ; et « la seule fatalité des passions, donne pâture aux ardeurs du romantique comme aux rêveries du philosophe ». Le critique est un savant qui décrypte tout, et apprécie de Bourges « la phrase souple et solide, ample et concise, riche de tous les trésors de la langue ». Il regrette d’observer que des passages ont été, au fil du temps, effacés, alors qu’ils n’étaient « ni faibles ni superflus ». Le seul défaut de cette œuvre est pour lui, la ponctuation chaotique, qui distrait de tant de beauté.
Le 1er décembre, Ces Messieurs (Éditions de La Revue blanche), pièce du « meilleur comique », de Georges Ancey, est publiée, mais empêchée par la censure. Ce texte a retenu l’attention de Marcel Drouin qui s’insurge contre cette décision, car cette comédie est « excellente ; on l’arrête sans motifs sérieux. » Drouin considère que « c’est une des plus solides, une des mieux équilibrées qu’on nous ait offertes depuis longtemps ». Aussi, pose-t-il la question de l’avenir de la Littérature, mise en danger pour une soutane entachée ! Pour faire admettre sur scène une comédie de caractère et de mœurs, le dramaturge devrait-il donc faire fi du réel :
Mais quoi ! la visite du curé, sa façon de saluer, d’attirer les enfants, de flatter les dames, de solliciter des subsides avec l’air de ne demander rien, tout cela ne sent point la charge, tout cela fleure un parfum ecclésiastique qui n’échappe même pas au flair des croyants.
1902
Le 1er mars, Marcel Drouin analyse Dans la steppe (Perrin) ; Caïn et Artème (Perrin), trad. S. M. Persky, de Maxime Gorki. Le critique présente ces deux récits qui avaient pour sous-titre respectivement Récits de la vie des vagabonds et Nouveaux Récits de la vie des vagabonds. Si Gide eut un jugement modéré, Henri Ghéon fut véhément :
On l’espérait âpre, brutal, sentant le port et la saumure, l’air pur et le haillon, […]. Et voici des contes, eh ! oui ; des nouvelles – le mot convient, – des nouvelles à la française, au sens le plus banal du mot, trop claires, trop froides, trop sommaires, sans dessous et sans profondeur – j’entends au point de vue de l’art…
Drouin, quant à lui, goûta les deux nouveaux volumes qui contiennent de vrais chefs-d’œuvre : Vingt-Six et Une et Caïn et Artème. L’œuvre de Gorki apporte « une réelle et frappante nouveauté ». Elle ressemble à son créateur, qui a vécu « franchement sa vie, et la décrit sincèrement ». Voilà qui est tranché par le critique, qui balaie les objections faites à cette œuvre. Néanmoins, compte tenu des espoirs que ce dernier a fait naître, chez « une jeunesse préparée par Nietzsche, mais cherchant autre chose », n’a-t-il pas, malgré lui, fait inutilement de l’ombre à Tolstoï, Dostoïevski, et à Gogol, questionne Drouin.
Le 1er mars, Marcel Drouin examine La Résurrection des dieux, deuxième volume d’une trilogie de Dimitri Merejkowski, paru dans La Revue blanche. Ce dernier regarde la Renaissance comme un spectacle neuf, dont les mystères relèvent de la psychologie. La Résurrection des dieux l’exalte et le trouble. Il introduit la figure de Léonard de Vinci, montre « son génie, et les tares de son génie ». L’œuvre, entreprise est « hasardeuse », mais belle. Nonobstant ses ambivalences, elle a le sens du vrai, cela même si elle reste inachevée ; Merejkowski a su fabriquer du charme et de la grâce, conclut le critique.
Le 1er mars, Marcel Drouin étudie également Sainte Lydwine de Schiedam (Stock) et De tout (Stock), de Joris-Karl Huysmans. Il réfléchit au christianisme de Huysmans, qui une fois converti, croit en réaliste. « Il lui faut des faits précis, des faits choquants : ce sont ceux-là dont on peut le moins douter » ; son talent y gagne. Huysmans a choisi Lydwine de Schiedam pour ses vertus, mais « il l’aime surtout pour ses tortures, pour la carie de ses os, pour le pus de ses ulcères, pour la sanie de ses plaies ». L’écrivain use des miracles, et des hagiographies, pour nourrir cette œuvre. Mais il n’en a pas fini avec la littérature, et lorsqu’il termine son ouvrage, il livre au lecteur De Tout. L’ancien Huysmans est tout entier dans ce livre, où est restituée « la même observation minutieuse et bizarre ». La saveur du texte est sauvegardée, mais il manque, la beauté et la simplicité du livre précédent, dans lequel le critique appréciait : le fin paysage de Hollande dans le cadre d’une fenêtre, les jeux de la flamme autour du foyer… que Lydwine de Schiedam, bientôt, ne verra plus.
Le 1er avril Marcel Drouin analyse Anthinéa (Juven) de Charles Maurras. En 1899, il reconnaissait son importance : ses intentions nettes, et « une doctrine, dont l’influence peut produire quelque mal et quelque bien ». En 1902, le ton du critique se fait plus circonspect sur cet écrivain dont il loue l’écriture mesurée, parce qu’il connaît la valeur des mots, et qui n’en mésuse qu’à dessein. Avec Anthinéa, le lustre de cet érudit se ternit, Drouin fait fi de sa « langue pure et délicate, d’une grâce un peu grêle et concertée », car il lui reproche de trahir, dans cette œuvre, la coordination des événements historiques, et de conforter l’idée d’une « division si nette du genre humain », à l’origine d’un passé récent tragique.
Le 1er avril, Marcel Drouin s’intéresse aussi à La Leçon d’amour dans un parc (Éditions de La Revue blanche) de René Boylesve. En 1899, le critique goûtait « fort Boylesve » pour la parution de Mlle Cloque. Que dire sinon qu’en 1902, son sentiment à l’égard de cet auteur n’a pas changé !
Dans le même numéro, Marcel Drouin s’attache à l’étude du troisième et dernier volet du Roman de l’énergie nationale : Leurs Figures (Juven) de Maurice Barrès. Ouverte avec ampleur, l’œuvre Les Déracinés, est dignement continuée avec L’Appel au soldat ; la seconde trilogie de M. Barrès se clôt, avec Leurs Figures, sur un dénouement un peu brusque [de cette] réconciliation tragique. Le soin de défendre une thèse a été moins vif que le désir d’évoquer les souvenirs de l’auteur, stipule le critique, qui attendait dans ce dernier volet, « une âcreté plus corrosive, des brûlures plus atroces, une rancune plus acharnée ». La crise parlementaire est là, les luttes politiques aussi, et cependant, l’auteur est « presque modéré dans sa violence », installé dans « une espèce de férocité tranquille ». Le public ne connaissait que sa délicatesse. Barrès a montré sa puissance, mais sa vigueur nouvelle n’a pas fait alliance avec ses grâces d’autrefois.
Le 1er mai, Marcel Drouin analyse Le Bon Plaisir (Mercure de France), d’Henri de Régnier, roman qui se présente tel une chronique rédigée dans le style du Grand Siècle. Le 15 novembre 1901, le critique avait commenté Les Amants singuliers. Le Bon Plaisir est moins énigmatique que les romans qui l’ont précédé, mais il permet d’apporter une certaine lumière à l’œuvre. Henri de Régnier fait une caricature de la cour et de ses manières, dont le critique désapprouve – tout en finesse – la lourdeur, attendu qu’il faut ménager cet écrivain. En revanche, avec malice, il libère : « À ce propos, des lecteurs qui l’aiment lui reprochent quelque excès et quelque complaisance. »
Le 15 mai, Marcel Drouin examine Le Surmâle d’Alfred Jarry (Éditions de La Revue blanche). Il se plaît à décrire le héros de ce « roman moderne », dont « l’excès même de sa puissance le situe nettement hors de notre espèce, de notre règne, de notre terre ». Le critique semble l’avoir apprécié, en dépit des :
[…] passages d’émotion ou de sensualité [qui] détonent ou sont, à tout le moins superflus ; aucun, certes, n’égale en vigueur ce récit fantastique du record Paris-Irkoutsk, qui restera parmi les meilleures pages de la littérature sportive.
Le 1er juin, Marcel Drouin étudie Dingley, l’illustre écrivain, récit de Jérôme et Jean Tharaud (Les Cahiers de la quinzaine). Il est intéressant de souligner que le succès de cet ouvrage est tel, que les auteurs vont le retoucher par deux fois – Ils doublent leur volume en 1906, reçoivent le Prix Goncourt, et triplent leur ouvrage en 1911. Dingley est un contemplateur qui « se contente d’ouvrir tout grands ses yeux, pour lire sur la terre et la mer les destinées de sa race et du monde… » Il constate « les sottises, les misères, les horreurs ; et ces spectacles le pénètrent plus sûrement qu’aucune pensée ». Le critique décèle en Dingley, le même combat existentiel que celui de Kipling, « gonflé de zèle impérialiste et de sain orgueil littéraire ». Drouin est sensible à l’aventure « contée sobrement, sans insistance, sans réflexions morales et sans psychologie ». – Dingley ne se contente pas de contemple le monde, il s’émeut de ce qu’il voit.
Le 15 juillet, Marcel Drouin se penche longuement sur L’Étape de Paul Bourget, (Plon). Le critique, concerné par cette lecture, déconstruit pas à pas l’édifice de Bourget. Il lui reproche son irréalisme foncier, et lui conseille de lire le volume de M. Bouglé sur les Idées égalitaires, et celui de M. Durkheim sur la Division du travail social. Les reproches du critique sont grands : Bourget est un prédicateur, il se croit savant ! Son écriture est grandiloquente, et sans effet. « Il a cru que tout besoin non satisfait devait se traduire en esclavage, en petitesse d’esprit ou de cœur. » Drouin élève sa sentence contre la « creuse idéologie » de Bourget :
Celui qui croit devoir élever des barrières autour de la pensée et de l’art, les préserver comme des fleurs fragiles, leur épargner les poussées et les chocs, celui-là se condamne à transporter partout la même timidité inquiète ; et, si la société de son temps ne répond plus à son souci de conservation et de hiérarchie, à la regarder comme une chimère, un monstre, un cloaque d’incertitude et d’erreur.
Le 1er août, Marcel Drouin s’attelle à l’étude de Kim de Rudyard Kipling, traduit par Louis Fabulet et Charles Fountaine Walker (Mercure de France). Le critique décrit ce roman, comme étant « un récit touffu, grouillant, sinueux, interminable et toujours captivant ». Il voit dans Kim, roman d’espionnage, « une grande fresque panoramique », dont la multiplicité des détails séduit, puis perd le lecteur. S’il reconnaît un certain talent à Kipling, il ne l’adoube pas.
Le 15 août, Don Pablo de Ségovie (El Gran Tacano), roman traduit par les frères Rosny (Éditions de La Revue blanche), trône sur la table de Marcel Drouin, enthousiasmé par cette « traduction moderne, sans adoucissements, sans timidités, précise et truculente à souhait ». Don Pablo est un homme tourmenté, et l’on retrouve dans ce « tableau de l’Espagne pouilleuse […] l’ironique philosophie des gueux ». Bien sûr, le genre picaresque n’est pas neuf, mais il laisse entrer en son sein, le « grotesque, le creuse, le rend plausible à force d’absurdité », et séduit définitivement le critique, car à cet endroit où se meut la douleur, entre aussi une dérision inattendue.
Le 1er septembre Drouin analyse Un Adolescent (Éditions de La Revue blanche) de Dostoïevski, qui, en 1875, compose d’un jet, ce « livre écrit avec fièvre, qu’il faut lire tout d’une haleine : sinon l’on risquerait de s’y perdre, tant les événements y sont rapides, et soudaines les révolutions sentimentales ». Dostoïevski ne cherche pas à décrire l’âme des hommes dans une époque modérée, mais dans une époque trouble, où « chacun tient tous les autres, mais est aussi tenu par tous ». Ces hommes :
[…] depuis la cruauté superbe jusqu’à l’ingénue bonté : ils parcourent tous les degrés de la honte douloureuse, étant tous, ou presque tous, des Humiliés, des Offensés ; enfin, dans quelque crise aiguë d’ivresse, de faim, de fièvre ou d’hystérie, ils mettent à nu leur plaie la plus intime, ils la fouillent avec un rire de cynisme ou de désespoir.
Cette œuvre de Dostoïevski, « composition hâtive, à la fois savante et gauche », et troublante, plaît à Drouin pour l’idéal et l’émotion qui s’en dégagent, et procurent un sujet de réflexion grave sur la personnalité de l’homme, sur son salut, et sur son comportement face à la communauté. Intuitif, l’écrivain russe a deviné, et ne s’est pas trompé.
Le 1er novembre, Marcel Drouin réfléchit aux Scènes et doctrines du nationalisme (Félix Juven), issues des principaux articles politiques, discours et manifestes publiés au cours de la carrière de Maurice Barrès. Si, à la lecture de ce livre, le critique émet quelques réserves : défauts de composition, discontinuité des raisonnements, multiplicité des formules ; il ne le trouve pas sans mérite et augure de son influence sur le public. Cependant, que penser d’un Barrès, patriote, qui semble être « occupé moins de régler l’avenir que de justifier sa conduite passée » ? Ce comportement agace le critique et le pousse à déconstruire quelque peu son discours, lui opposant le rationalisme de Goethe et de Kant, et terminant son commentaire sur l’extrait d’une lettre d’Ernest Havet adressée à Barbey d’Aurevilly, qui souligne les erreurs de son raisonnement :
Une thèse erronée peut être une occasion de penser très fortement et de répandre des vérités à pleines mains ; et c’est précisément ce que vous faites et ce qu’ont fait aussi vos grands hommes. Comme eux, à mon avis, vous êtes à la fois puissant et impuissant.
Le 15 novembre, Marcel Drouin reporte son attention sur L’Immoraliste (Mercure de France) d’André Gide, à l’occasion de la parution de l’édition courante, augmentée d’une préface. Ce titre doctrinal fait office de profession de foi. Il « convient bien au livre, en exprime le sens total […] c’eût été timidité vaine » spécule le critique, qui se réjouit d’en parler, mais s’étonne d’avoir « à l’expliquer ». Drouin déclarant que :
[C]eux qui désirent voir s’épanouir un immoralisme candide relisent l’histoire de César Borgia ou de Jean-des-Bandes-Noires, les romans-poèmes de M. Lemonnier, ou l’histoire d’Aladdin. Ceux qui préfèrent l’immoralisme à l’état de doute, de fièvre et d’angoisse s’arrêteront au cas de Michel.
Le critique propose aux lecteurs de s’attacher à lire et à relire une œuvre avant d’en parler afin d’éviter les malentendus. Il montre que Michel est « spontané », « libéré malgré lui », il a tout désiré sans différer : la frénésie de sa force, et l’amour d’un être faible. Mais, née de sa propre faiblesse, que reste-t-il, de cette liberté enfin acquise, sans choix de vie préétabli ?
Le 15 décembre, c’est de nouveau Charles-Louis Philippe, avec son roman Le Père Perdrix (Fasquelle), qui trône sur la table de Marcel Drouin, mais cette fois, les éloges du critique ne comporte aucune restriction. Le Père Perdrix, roman réaliste et novateur, redonne, tout en douceur, du prix à Bubu de Montparnasse, sur lequel le critique avait vite tranché. Dans ce roman, l’auteur se confond avec le Père Perdrix, avec d’autant plus de respect, que c’est un pauvre, qui parle des pauvres, donnant à son récit une coloration authentique, qui ne peut que toucher le lecteur.
1903
Le 5 mai, Marcel Drouin s’intéresse à L’Amour sacré de Francis Vielé-Griffin (L’Ermitage), considéré par Gide comme le plus important de ses livres. Le critique est conquis. Il livre : « Quand sous la lampe, dans le silence, nous relisons L’Amour sacré, les vieux mots de lyrisme et de spiritualité reprennent leur sens aboli. » Pour le critique, cette poésie « est hautement spirituelle ». Il donne en partage moult de ces vers libres, qui l’enchantent. Sa propre parole devient superflue. Il conclut sur une sentence : « Il n’y a point de choses sacrées ; il n’y a point de choses profanes ; car le sens et la valeur des choses résident dans l’âme qui croit et qui aime… » Fort de ce constat, le lecteur peut contempler, sans adhésion religieuse, « une source simplement humaine et divine ».
1908
Le 1er novembre, Marcel Drouin fait un double et long compte-rendu à propos de deux volumes d’Anatole France : Vie de Jeanne d’Arc et L’Île des Pingouins (Calmann-Lévy). Il salue « le style toujours impeccable de France, [et] s’attache à distinguer ce qui fait de La Vie de Jeanne d’Arc une œuvre estimable dans laquelle l’auteur ne s’est pas “contrefait” ». A contrario, il juge L’Île des pingouins, déplorable. Drouin va fournir un commentaire élogieux à la Vie de Jeanne d’Arc, « œuvre d’amour et de patience [qui] vaut bien qu’on l’admire ». Il propose que l’on ne se contente pas de voir ici, en ce romancier érudit, qu’un collectionneur et chartiste, qui se repose, en prenant des fiches, du labeur d’imaginer. Car, dans ce premier volume, France offre, outre son savoir, de la vie et de la grâce. Dans le second volume, « banal », le critique voit « un rapetissement moral ». Le charme de L’Histoire contemporaine – outrepassée – n’opère plus. S’il juge par comparaison, c’est parce qu’en dépit d’un style exemplaire :
[L]’histoire de L’Île des Pingouins est de telle nature qu’elle impose souvent, sans y gagner jamais, un parallèle avec d’autres écrivains, quand ce n’est pas avec l’auteur lui-même.
Drouin ajoute que s’il a maltraité L’Île des Pingouins, après avoir encensé l’inestimable Vie de Jeanne d’Arc, c’est parce que les origines de la propriété, de la noblesse, de la gendarmerie, n’ont pas été traitées avec tout le respect que méritent ces institutions… Nous pouvons en déduire – en esquissant un sourire – qu’il faut, sans nul doute, lire et Vie de Jeanne d’Arc, et L’Île des pingouins !
1909
Le 1er mars, Marcel Drouin se penche sur Nos Frères farouches, Ragotte (La NRF), de Jules Renard. Quand on ouvre Ragotte, écrit le critique :
[…] d’abord on s’émerveille qu’après Les Bucoliques, après Le Vigneron dans sa vigne, le même champ, déjà deux fois moissonné, livre encore des épis aussi drus, aussi lourds. Cependant, Jules Renard retient sa plume.
Le dessin est âpre, ardu, ciselé ; Marcel Drouin a aimé lire Nos Frères farouches, Ragotte ; il regrette juste que son auteur ne se livre pas totalement. Mais il suffit d’attendre…
Le 1er août, Marcel Drouin compare la double publication de deux romans laissés inachevés : « Taine et Renan, romanciers », ( Revue des Deux Mondes). Le volume de Taine a pour titre : Étienne Mayran ; le critique loue l’aisance et la spontanéité de son auteur, mais lui reproche de ne pas savoir « créer des êtres ». Le volume de Renan : Patrice, « ne peint que son milieu », faisant le bonheur des mémorialistes ! Drouin regrette que pour composer une œuvre réaliste, ce dernier se retienne trop !
Le 1er août, Marcel Drouin s’intéresse également aux Promenades littéraires (3e série) de Remy de Gourmont, « La NRF, n° 7 ». Si celui-ci a un goût sûr pour piocher, ici et là, sa substance littéraire dans « l’ancien et le nouveau », a contrario, il manque d’objectivité, et mêle « la biologie à toutes choses humaines », se satisfaisant du postulat, qui fait corps avec toute sa philosophie, classant les idées et les êtres. Et, si Remy de Gourmont :
[…] nous invite à placer l’Inconscient au-dessus de l’intelligence, comment lui dissimuler que l’estime et le goût le plus vifs pour sa lucide intelligence ne nous entraînent point jusqu’à sympathiser avec son Inconscient.
En octobre, Marcel Drouin critique Au théâtre. Réflexions critiques (2e série), par Léon Blum (La NRF). S’il complimente dans un premier temps l’auteur pour son excellence à narrer une action dramatique, rapidement, il se réfère à un ouvrage écrit précédemment, Du Mariage, stipulant que : « Les défauts d’une pièce à thèse se révèlent fort nettement à la lumière d’une thèse adverse. » Aussi, argumente-t-il qu’ une « situation psychologique n’est rendue possible et nécessaire que par un certain mécanisme social, il devient intéressant de savoir jusqu’à quel point le changement d’un seul rouage modifierait le résultat. Ainsi la plupart des conflits s’évanouissent, et ma principale objection à la méthode, c’est qu’il en est bien peu qu’elle ne supprime pas. »
Cependant, Drouin accepte le procédé mis en œuvre, précisant qu’en dramaturgie, l’on peut apprécier « les droits de la littérature ». Aussi, si Blum peut prôner la liberté des mœurs, espérant une tolérance « des infractions à la règle commune », le danger est grand que celles-ci ne deviennent une nouvelle ligne de conduite. L’exception deviendrait alors la règle.
1910
Le 1er mai, c’est sur La Vague rouge de J.-H. Rosny (La NRF, n° 17), avec pour sous-titre explicatif : Roman de mœurs révolutionnaires – Les Syndicats et l’antimilitarisme, que se penche Marcel Drouin. Il regarde ce roman balzacien uniquement du point de vue de l’art, lui reprochant sa profusion de mots, et une lourdeur de composition, qui fait oublier la profondeur de l’œuvre.
Le 1er juillet, c’est en lisant Dans la petite ville, de Charles-Louis Philippe, et Parmi les hommes, de Lucien Jean, (La NRF, n° 19), que Marcel Drouin songe à la production littéraire que Philippe aurait pu fournir encore s’il avait vécu, tant il a apprécié la délicatesse et la justesse du propos dans son récit. À propos de Parmi les hommes, il suggère que nous lisions ces Nouvelles chronologiquement, afin d’apprécier la progression du style de Lucien Jean.
Le 1er septembre, Marcel Drouin, rend compte de sa lecture d’Ann-Veronica de H. G. Wells, et de Notre Jeunesse de Charles Péguy (Cahiers de la Quinzaine) (La NRF, n° 21). Il apprécie la conception scientifique du monde de Wells qui détermine l’atmosphère du livre dans lequel se dégage « la psychologie d’un poète ». Notre jeunesse, est un manifeste pour la vérité, où Péguy narre un moment crucial de la vie française.
1911
Le 1er mai, Marcel Drouin statue sur L’Esprit de la Nouvelle Sorbonne d’Agathon (La NRF, n° 29). Il apprécie la critique dispensée par les deux auteurs, Alfred de Tarde et Henri Massis, sur les nouvelles dispositions prises par la Sorbonne, qui propose un enseignement qui tend moins vers la sauvegarde de la culture et des usages, et par là, efface tous les efforts de l’esprit que réclame un apprentissage intellectuel et scientifique.
L’éducation classique, c’est donc essentiellement un apprentissage de l’effort, une culture intensive de l’attention. Le bénéfice en demeure toute la vie à ceux qui ont subi sa discipline. Ils y ont pris l’habitude de la netteté intellectuelle…
1912
Le 1er novembre, Marcel Drouin met face à face les œuvres de J-H Rosny et H. G. Wells, de Rudyard Kipling et Pierre Mille (La NRF, n° 47). Il remarque que Rosny et Wells, « à force d’imaginer des êtres et des sociétés irréels mais vraisemblables, ont acquis ce qu’on pourrait appeler le sens des possibilités cosmiques ; et ce tour d’esprit se marque jusque dans leurs romans modernes ». Pour lui, Kipling et Mille sont indissociables, tant l’art de peindre de Kipling est puissant, et influence Mille. Kipling a le génie qui manque à Mille, qui possède un bel esprit, une langue franche, sans fioriture.
1914
Le 1er février, Drouin examine Quelques Juifs (Israël Zangwill, Otto Weininger, James Darmesteter), d’André Spire (Mercure de France) (La NRF, n° 62). Il éprouve un réel enthousiasme à la lecture de ce livre écrit avec « passion ». Il évoque tour à tour Darmesteter, « âme ferme et douce », Weininger, « âme ardente et tourmentée », et Zangwill, mesuré, qui soupèse ce qui attend le peuple juif s’il ne trouve pas une terre d’asile. Car « il a vu, dans les pays d’Occident, affluer la foule des fugitifs ; et, marqués comme ils sont du joug héréditaire, il sait bien qu’ils ne peuvent pulluler dans nos villes sans y soulever bientôt de nouvelles hostilités ». Drouin remet un bel article sur « cette thèse territorialiste [qui] a vraiment pour elle, à la fois, générosité, prudence et bon sens ».
Le 1er mai, Marcel Drouin réfléchit à l’écriture de L’Héritage d’Henri Bachelin, et de Mengeatte de Raymond Schwab (Bernard Grasset) (La NRF, n° 65). Il apprécie le talent d’Henri Bachelin qui se déploie dans L’Héritage, mais déplore qu’il ne sache séparer ses pensées de celles de son personnage. Dans Mengeatte, les qualités d’aisance, de chaleur et de vie de l’écriture de Raymond Schwab sont révélées, et marquent une rupture entre la personnalité de l’auteur et celle de son personnage.
Le 1er août, Marcel Drouin statue sur L’Abdication du poète de Maurice Barrès (Georges Crès) (La NRF, n° 68). Il restitue pour les lecteurs de La NRF de très belles pages écrites par Barrès sur le silence de Lamartine devenu nécessaire, lorsque « ses paroles n’étaient plus dispensatrices de bonheur… ».
1922
Le 1er février, Drouin étudie Le Caméléon, de Johan Bojer (Calmann-Lévy) (La NRF, n° 101). Il montre avec goût, « les variations de l’être intérieur », en harmonie avec l’extérieur. Il décèle dans le Caméléon, tout en subtilité : le garçon menteur qui devient escroc de haute volée, le faible cherchant sa force dans la ruse ; l’acteur heureux d’imiter les gestes, le poète heureux d’imiter les âmes, l’imaginatif accueillant aux rêves, et tout homme enfin, qui voudrait être plusieurs hommes et mener plusieurs vies.
1923
Le 1er août, Marcel Drouin examine longuement Dostoïevski d’André Gide (La NRF). Il n’est pas étonné que ce dernier, préoccupé par les ressorts de l’âme humaine, se passionne pour l’œuvre et l’écrivain russe, puisque ce dernier s’attache à décrypter les « mouvements de l’âme dont nous ne percevons, dans la vie ordinaire, que les faibles commencements ». Si Dostoïevski n’est pas le seul ni le premier explorateur de ces régions confuse, il s’agit « bien [chez lui d’] une psychologie d’exception ». Il note que Gide a le premier révélé Les Frères Karamazov, L’Idiot, Les Possédés ou L’Éternel mari. Il remarque que toute passion dans l’œuvre de Dostoïevski se met « en règle avec la pensée ». Le conflit moral y est sublimé ; la vérité même est grossie, souligne-t-il, conquis, qui veut, à l’instar de Gide, accueillir Les Belles Lettres étrangères.
II
ÉTUDES
« Sur quelques idées de M. P. Bourget », La Revue blanche, 1er février 1900
Marcel Drouin considère que Les Essais de Psychologie contemporaine contiennent l’image fidèle d’un moment de l’esprit français. Il conte comment Bourget, « jeune homme, ni trop philosophe, ni trop artiste, mais très cultivé, [qui] a le don de s’étonner », a conçu son étude, afin de tracer une psychologie de la jeunesse sous la Troisième République. Il apprécie « l’excellent livre, […]. Car, parmi ces cinq cents pages de psychologie, qui n’ont point changé, des phrases éparses, deux pages en tout, révèlent enfin le moraliste, le thérapeute social ». Néanmoins, il éprouve le besoin « d’exiger une prompte révision ». Il s’attache à rectifier certains propos de Bourget, conservateur, qui doit encore réfléchir à l’idée de démocratie.
« Réflexions », L’Ermitage, 15 avril 1905
Les auteurs de cet ouvrage précisent que ces « réflexions » à l’allure de dialogue (Vous me demandiez l’utilité de la critique. Cela revenait à me demander l’utilité de la Pensée) sont nourries de nombreuses citations des auteurs évoqués (Sainte-Beuve, Wilde, Flaubert, La Bruyère, Remy de Gourmont, Chamfort, Barrès, Renan) ou de leurs commentateurs (Renaud, Giraud, Lichtenberger, Schlegel, Montegut, Rivarol, Herr), constituant ainsi une longue chronique bibliographique qui illustre bien le goût de Drouin pour les idées. Grâce aux textes et extraits choisis, Stéphanie Bertrand, Pierre Masson, et Jean-Michel Wittmann, exposent les qualités de Marcel Drouin, qui témoigne d’une « conception exigeante, morale, qui préfigure l’esprit NRF ».
La critique naturelle devant chaque nouvelle œuvre pose des problèmes nouveaux. Plutôt que d’enserrer l’œuvre dans un déterminisme rigoureux, elle se plaît à tracer autour d’elle des cercles toujours plus vastes et s’efforce d’en élargir, d’en dilater la signification. Cette critique n’est pas une science ; mais elle est une philosophie.
« Le Voyage de Sparte et Maurice Barrès », L’Ermitage, 15 avril 1906
Drouin fait – avec douceur – l’apologie de Barrès :
Je savais trop que Barrès, même devenu l’Adversaire, ne cesserait pas de m’intéresser autant et plus qu’un ami. Le renier, c’eût été rompre avec une part, non la moindre, de ma jeunesse ; avec les joies d’art les plus neuves qu’aucun vivant, sauf Gide, m’eût fait goûter.
« Les “Cahiers” de Charles Péguy », La NRF, n° 10, novembre 1909
Marcel Drouin dresse un plaidoyer en faveur de Charles Péguy, ancien dreyfusard, qu’il encense pour ses Cahiers qui le conquièrent, le subjuguent :
À quoi bon signaler ici, pour les lecteurs ou pour Péguy lui-même, tout ce qui, dans ses opinions, excède mes jugements, tout ce qui, dans son style, outrepasse mon goût. L’essentiel, c’est qu’il faut le lire. […]. Rien de plus effarant que la composition d’un Cahier. Le mouvement total vous emporte, continu, irrésistible, on ne sait pas comment, on ne sait pas où.
Péguy, déçu par le socialisme, déçu par l’intellectualisme, a cru en l’homme et de son désenchantement sont nés ces précieux Cahiers, au sein desquels il épanche ses humeurs. Il devient écrivain.
« Du vers français », La NRF, n° 12, 1er janvier 1910
Marcel Drouin statue dans un premier temps sur les vers libres de Goethe, « dont nous ne possédons point l’exact équivalent de ce qu’on nomme vers libres en français », puis sur « les jeunes vers libres ». Il hésite, ne fixe pas son choix. En poète, le critique s’épanche, craignant de ne pas retenir les vers libres :
Combien je leur ferais volontiers confiance, s’ils s’imposaient au souvenir par une allure mieux assurée ! Mais la plupart d’entre eux pour moi ne vivent qu’à la façon des ombres incertaines, puisqu’ils retombent en néant dès que le livre est refermé.
Cependant, Drouin propose aussi de faire confiance aux poètes : Entre nos poètes, ceux-là seulement sont qualifiés pour dire comment les vers libres doivent être écrits, qui ne laissent point le lecteur douter comment ces mêmes vers doivent être lus.
« En relisant Colette Baudoche », La NRF, n° 22, 1er octobre 1910
Marcel Drouin compare dans Colette Baudoche, la brillante Alsace et la fière Lorraine écrasée[s], dont Colette est le symbole. Colette Baudoche, fait suite au premier livre de Barrès : Les Bastions de l’Est. Drouin imagine une fin différente pour ce roman, qu’il a apprécié, car il pense que cela pourrait « élargir le champ des expériences qui déterminent la direction de notre vie ». Il aimerait que Colette, la Lorraine, renonce à épouser, après la guerre franco-prussienne, un soldat allemand, non parce que « les antiques traditions de patriotisme et d’honneur » ont resurgi, mais parce que « la cause des morts est demeurée la sienne ». Il voudrait que l’on voie le contraste de ces deux cultures. La conclusion souhaitée par Drouin ne sied pas à Barrès, qui lui écrit quinze jours plus tard : « Non, non, non, mon cher Arnauld, le dénouement que vous me proposez est bien inférieur au mien. C’est moi qui là-dessus ai raison. […]. C’était mon devoir de tenir bien droit le sillon que je voulais tracer. »
« Études de psychologie littéraire, par Louis Cazamian », La NRF, n° 59, 1er novembre 1913
Marcel Drouin effectue l’analyse de l’ouvrage de Cazamian intitulé : Études de psychologie littéraire, il pense que celle-ci aurait pu s’intituler : L’Évolution intérieure du goût. Le critique trouve cette étude « trop chargée d’abstractions, trop dépouillée d’exemples » ; néanmoins, il concède que les thèses les moins neuves contribuent à préparer d’intéressantes conclusions. Et celles-ci lui paraissent : mieux fondées, mieux soustraites à toutes corrections futures. Ce rapport circonstancié entre la littérature et les identités nationales – de nature à interroger une saine curiosité sur l’évolution littéraire, marquée par « l’usure progressive des effets », n’avait gardé jusqu’ici que peu de place « aux conditions intérieures à l’esprit lui-même… » Drouin pense que ce texte, dans sa première partie, en dépit de ses qualités, aurait dû mieux poser la question de l’identité nationale, et que la volonté de « barbarie » observée, et revendiquée par Charles-Louis Philippe, pourrait provenir d’une exaspération de la culture, et d’une convulsion de l’esprit critique.
« Explications », La NRF, n° 70, 1er juillet 1919
En juin 1919, « Jacques Rivière, avait publié un long article aux allures de manifeste pour esquisser une vision de la littérature [où il] réaffirmait avec force le principe essentiel de l’autonomie de la littérature à l’égard du champ social ». C’est sur cette autonomie que revient Marcel Drouin, affirmant que l’Art n’est pas « indépendant », car il dépend de ce qui nous anime. Et, si la guerre est évoquée en cette année 1919, c’est pour souligner qu’un « malentendu reste à craindre : la guerre, avec tout ce qui s’y rattache, c’est “problèmes”, pourrait-on croire, c’est “discussions”, donc politique et journalisme. Le reste est “littérature” ; le reste appartient à l’art ; car l’art, c’est le naturel ; et le naturel c’est le gratuit. »
III
HOMMAGES
« Leconte de Lisle poète dramatique », Revue d’art dramatique, juillet 1894
Stéphanie Bertrand, Pierre Masson et Jean-Michel Wittmann présentent ici un des premiers articles écrit par Marcel Drouin – sous le pseudonyme de Gratian – dans la Revue d’art dramatique, en hommage au poète Leconte de Lisle, chef de file du Parnasse. Drouin s’attarde sur les Érinnyes, comme étant la seule vraie tragédie écrite par Leconte de Lisle, « attiré par ce théâtre grec, encore lyrique et tragique ». Cependant, les spectateurs de 1889, à l’Odéon, « s’en souviennent moins comme d’un drame que comme d’une fête poétique ». Est-ce la voix envoûtante de la cantatrice, ou le talent du metteur en scène qui conquit le grand public ? Quel que soit la réponse, ce succès ravit Leconte de Lisle, rapporte le critique.
« Émile Zola », La Revue blanche, 15 octobre 1902
Drouin est subjugué par la personnalité flamboyante d’Émile Zola, qu’il imagine le front dressé, la main tendue en un beau geste de défi. Son œuvre, harmonieuse, retient tout autant son attention. Il remarque que Zola fut « tenté de réduire l’homme à l’animal et de regarder comme illusoires toute idée, tout sentiment où l’influence du ventre ne se découvre point ». Pour un peu, dit-il, il aurait pu ne plus voir, dans le mouvement de l’humanité, qu’un grouillement de bas instincts. Mais peu à peu, sa conception évolua, devint naturelle, puis sociale ; « Sa soif de vie, transfigurée en amour de la justice, le force d’élargir sa notion du réel, au point d’y faire entrer le mieux, le possible, le futur… »
« Notes sur Brunetière », Antée, 1er février 1907
Marcel Drouin rend un profond hommage à Ferdinand Brunetière. Il fut l’élève de cet historien de la littérature, sans être son disciple. Il peint avec beaucoup de respect et de réalisme une personnalité contrastée, n’omettant aucun détail, de son allure à ses croyances dont Brunetière lui-même n’était pas dupe. Il fait « connaître ce qu’il y avait en lui de sensibilité souffrante, de doute, d’inquiétude, mais aussi de gaité courageuse, et – ce qu’on attendrait moins – de bonhomie presque familière ». Il décrit l’auditoire, dubitatif et néanmoins attentif, sinon admiratif de la Sorbonne, dont il fit partie :
Je vous assure qu’alors il était beau ; qui n’a pas entendu le monstre ignore jusqu’où pouvait aller la vigueur de cette action oratoire, la puissance de ce ressort toujours à nouveau tendu. Mais quand il parlait pour nous seuls, simplement, maladroitement, c’est alors que nous nous défendions mal de l’aimer.
« L’œuvre de Charles-Louis Philippe », La NRF, 15 février 1910
Marcel Drouin est un formidable ami et portraitiste de Charles-Louis Philippe. Ainsi, eut-il l’honneur de voir son hommage publié par La NRF, quand d’autres étaient refusés. Il a su redonner vie à Charles-Louis Philippe en décrivant l’écriture toujours égale et bien formée, le réalisme délibéré, la volonté d’âpre franchise, qui montre le fonds premier de son talent : une âme de pitié, de tendresse, de frémissante poésie. Il décrit chacun de ses livres, rappelant l’omniprésence de la pauvreté. Il analyse chaque œuvre, goûtant, tour à tour chacune d’entre elles, et leur préférant toujours, parmi ces chefs-d’œuvre, Bubu de Montparnasse.
« L’Œuvre de Jules Renard », La NRF, n° 19, 1er juillet 1910
Marcel Drouin évoque le deuil « profond et discret » qui suivit la mort de Jules Renard. Il rappelle le souci qu’avait ce dernier « d’exploiter les minutes les plus banales, et de tourner à l’étrange l’insignifiance de la vie quotidienne ». Il apprécie cette écriture où se côtoient la souffrance, l’humour, et où « les mots se rejoignent à travers les silences, et dessinent peu à peu le mouvement d’une émotion, la ligne d’un caractère ». Jules Renard affectionne les dialogues qui peu à peu le conduisent, avec bonheur, vers le théâtre.
« Clio, dialogue de l’Histoire et de l’âme païenne, par Charles Péguy », La NRF, n° 71, août 1919
Dix ans auparavant, Drouin avait consacré aux Cahiers de Péguy une étude élogieuse. Un an plus tard, Péguy évoquait dans Notre Jeunesse, « la voix grave et sereine, douce et profonde, […] à peine railleuse et prête au combat ». Dans Clio, Drouin retrouve le « regard d’ensemble sur la vie, cette fatigue et cette tristesse courageuse, ce renoncement sans amertume, cette religieuse acceptation, [de] Péguy, […] dernier témoignage […] avec pour thème principal : l’idée du Vieillissement : vieillissement de chaque homme, vieillissement de l’humanité. Cette disparition inéluctable, c’est la vieille Clio qui la conte en lieu et place de Péguy, et Drouin la conte à son tour, magnifiquement pour nous, nous conseillant d’« écouter comme il faut cette voix, l’une des plus pures, des plus chaudes et des plus graves qu’aujourd’hui l’on puisse entendre, alors qu’on cherche sa route aux premiers carrefours de la vie. »
« Jacques Rivière ou la vocation de sincérité », La NRF, n° 139, 1er avril 1925
Marcel Drouin rend hommage à Jacques Rivière, qui fut directeur de La NRF durant six ans. Cet hommage fut la dernière contribution de Drouin pour La NRF, qui parle ici, peu de littérature, mais beaucoup de l’homme, qui avait le souci de la Sincérité envers soi-même, et faisait :
Un perpétuel effort pour créer son âme telle qu’elle est. Telle qu’elle est, non pas telle qu’elle doit être. Car presque aussitôt surgit « le danger de l’intégrité de soi. [Pour Rivière,] Être honnête, c’est n’avoir que des pensées avouables ; mais être sincère, c’est avoir toutes les pensées ».
Rivière, critique brillant, doux et obstiné, a « un sûr instinct [qui] le dirige vers les choses qui seront pour lui d’une importance vitale ». Il prend du temps pour apprécier, et savoir ce que les choses signifient vraiment pour lui. Il a « une inflexible liberté de jugement ». Ce qu’il faut peut-être garder en mémoire, c’est que « ce qui domine toujours en lui, c’est le scrupule de choisir avant l’heure, et sans avoir tout éprouvé ».
Cet ouvrage passionnant ouvre le lecteur à la pensée de Marcel Drouin éminemment sensible à ce que la littérature dit du cœur de l’homme – Stéphanie Bertrand, Pierre Masson, et Jean-Michel Wittmann, dans une large introduction ont, avec moult détails, relaté sa carrière, englobant aux moments opportuns la pensée critique de Gide. Ils ont restitué avec finesse le contexte dans lequel ces critiques ont été écrites. Leurs notes de bas de page, leurs commentaires, et ceux de Marcel Drouin, au sens critique inépuisable, sont précieux, ils laissent entrevoir ce que peuvent offrir les œuvres et les critiques lues et relues au fil des siècles.