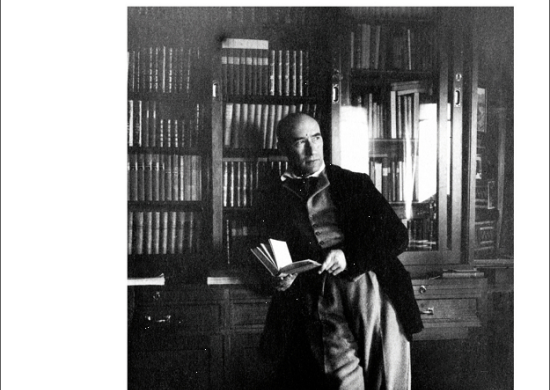Œdipe est l’une des pièces majeures de l’œuvre dramatique d’André Gide. Son processus d’écriture fut long et complexe, son projet très précis, à rebours des opinions de certains de ses plus proches amis (Roger Martin du Gard par exemple), et même des attentes éventuelles du public, au risque de subir un échec – ce qui fut le cas. Gide, qui s’explique volontiers sur sa pièce dans son Journal, feint d’abord, comme à son habitude, d’acquiescer aux critiques, mais c’est pour mieux rebondir, persister et assumer : « Le public (…), note-t-il en juin 1932, comprit que l’intérêt de ma pièce était ailleurs : dans le combat des idées, et que le drame se jouait sur un autre plan que celui de la tragédie antique. » Nous voici prévenus.
La première mention de la pièce dans le Journal apparaît le 7 mars 1927. « Je voudrais écrire également mon Nouvel Œdipe et un Dialogue avec Dieu. » La liaison des deux projets n’est sans doute pas fortuite, compte tenu de la problématique de la pièce à venir, et atteste que Gide a déjà mûri son sujet, avant même que de passer à sa rédaction. Le 10 mai, il poursuit : « Non pas : Le Nouvel Œdipe – mais bien La Conversion d’Œdipe. Le titre me paraît excellent. » Il en changera pourtant encore, finissant par adopter le simple Œdipe, sans épithète, complément ni sous-titre explicatif. Il se met alors à raconter sa pièce, en détail, à Roger Martin du Gard, ou à Julien Green. Et l’on suit, à travers le Journal, les affres de la création gidienne, portée par « une profonde exigence », avec ses périodes de doute, de découragement, où il laisse « dormir » son texte, puis ses redémarrages et sa persévérance, jusqu’à la fin de 1930. Le 9 novembre de cette année-là, il note, joliment : « Je crois bien avoir achevé Œdipe ; et je crois l’avoir bien achevé. » En effet : quatre jours plus tard, l’auteur reçoit les épreuves de son texte.
Œdipe paraît en volume en 1931, d’abord aux Éditions de la Pléiade, de Jacques Schiffrin, puis chez Gallimard. Le texte, en 1942, sera repris dans le volume Théâtre avec Saül, Le Roi Candaule, Perséphone et Le Treizième arbre. Pour une fois, le Journal ne s’arrête pas à la publication du texte, mais rend compte d’un certain nombre de réactions d’amis, puis de son destin scénique. Ainsi, le 18 janvier 1931, Gide raconte : « À la NRF, je rencontre Malraux qui me parle de mon Œdipe. »
« Oui, me dit-il en riant, Œdipe échappe au Sphinx : mais c’est pour se laisser enfin bouffer par sa fille… Vous devriez écrire un Œdipe à Colone, où Œdipe, avant de mourir, repousserait même Antigone. » L’anecdote est plaisante, et montre l’acuité amusée du regard qu’André Malraux, l’un des protégés de Gide chez Gallimard (où il est alors directeur artistique et bientôt auteur à succès), porte sur la pièce de son ami, aîné et « gourou ». Juste après, Gide ajoute : « Et j’imagine, en manière d’épilogue, un dialogue entre Œdipe et Thésée. Je songe à une vie de Thésée (oh ! j’y songe depuis longtemps), où se placerait (…) une rencontre décisive des deux héros, se mesurant l’un à l’autre et éclairant, l’une à la faveur de l’autre, leurs deux vies. »
Un paragraphe intéressant à plus d’un titre. D’abord, il nous confirme la profusion de ses idées de livres, dont nombre n’ont jamais vu le jour. Quant aux autres, ceux qui ont été écrits, ils ont pu subir une longue et lente maturation, parfois de plusieurs dizaines d’années. Gide n’oubliait rien. Dans le cas du Thésée, l’un de ses chefs-d’œuvre et son « dernier écrit », il faudra patienter jusqu’en 1946. Et, au chapitre douzième et dernier, figure bien une rencontre entre Thésée et Œdipe, à Colone, où le roi triomphant, accompli, accueille avec respect son ami « disgracié », « misérable », « chassé de Thèbes sa patrie », aveugle errant en compagnie de ses deux filles, Antigone et Ismène. Un long et noble dialogue s’instaure entre eux, au terme duquel Thésée salue la sagesse d’Œdipe, mais en sort renforcé dans sa propre fierté. Lui a « rempli » son destin, il a édifié une cité, Athènes. « Pour le bien de l’humanité future, conclut-il en forme de testament – et comment ne pas entendre là, en même temps, la voix de Gide âgé ? – j’ai fait mon œuvre. J’ai vécu. »
Gide signale également, en février 1931, la réaction à sa pièce, par lettre, de Roger Martin du Gard, lequel estimait qu’elle manquait d’« ampleur et de développement », et que sa fin était bâclée, comme une pirouette. Dans un premier temps, en raison de sa propension à abonder dans le sens de ses contradicteurs, il répond à son ami pour lui exprimer son accord avec ses critiques. Puis il se reprend, relit sa pièce devant une amie (Agnès Copeau), et son épouse (Em. alias Madeleine), et fait machine arrière toute. Il écrit, avec une grande fermeté, rare chez cet esprit toujours enclin au doute : « Tel qu’il est, je crois que mon drame est ce qu’il devait être et ce que je voulais qu’il soit (qu’il soit, non qu’il fût). Il répond à mon exigence ; me satisfait. Une fin plus ample l’eût déséquilibré. » Plus tard, il assumera, revendiquera même, non sans esprit de provocation, les passages « comiques » (et familiers) qui figurent dans sa pièce et ont choqué certains.
En septembre 1931, Gide revient sur son Œdipe, toujours dans le Journal, avec un paragraphe assez énigmatique. Il accuse un certain M. A. de l’avoir traité de « comédien », ce qui, même avec l’épithète « magnifique » ajoutée, semble l’avoir vexé. Le M. A. en question, selon Gide, se serait lui-même vexé parce que, dans sa pièce, il fait du jeune Etéocle, l’un des fils d’Œdipe, l’auteur d’un livre intitulé Mal du siècle, titre d’un livre du M. A. en question. Il lui reproche surtout de l’avoir « plagié naguère », pour mieux le « (renier) aujourd’hui ». Derrière les initiales M. A., on identifiera l’écrivain Marcel Arland (1899-1986), qui deviendra à partir de 1953 le grand ponte de la NRF (La Nouvelle NRF), avec Jean Paulhan. Son premier livre, Terres étrangères (1923), lui avait valu les éloges de Gide, entre autres. On ne voit pas bien à quel « plagiat » il est fait ici allusion. En revanche, Arland était bien l’auteur de Sur un nouveau mal du siècle, paru aux Éditions de la NRF en 1924.
Œdipe publié, avec les réactions que l’on sait, restait à le faire représenter. Le 30 octobre 1931, Gide en personne donne lecture de son texte devant Georges Pitoëff et sa troupe, sur la scène du théâtre Tristan-Bernard, et ressort enchanté de la puissance de sa voix. La pièce étant assez courte, trop pour « remplir la soirée », il est décidé de lui adjoindre, en lever de rideau, Die Geschwister, une courte pièce de Goethe, sur les conseils de « Groet », alias Bernard Groethuysen (1880-1946), philosophe d’origine allemande, et ami proche de Gide. En 1947, lui rendant hommage après sa mort, il dira de lui : « Il y avait du sourcier en lui ; et du sorcier. » Groethuysen, lorsque Gide l’avait informé de son idée d’écrire un Œdipe, s’en était fait un peu « l’accoucheur ». Ce pour quoi l’auteur lui avait dédié sa pièce, « en témoignage de (sa) reconnaissance ».
Après un « rodage » en Belgique, en Italie et en Suisse à la fin de 1931, Œdipe fut représenté à Paris pour la première fois le 18 février 1932, au théâtre de l’Avenue, dans une mise en scène, des décors et des costumes de Pitoëff. Le Journal n’en parle pas. En revanche, peu de temps auparavant, le 22 janvier, Gide commente longuement un article d’un certain Haraucourt consacré à sa pièce. Le critique y voyait, « surtout, l’opposition du libre arbitre et de la prédestination », ce que Gide ne conteste pas, mais qui lui paraît « moins important, moins tragique, que la lutte (…) entre l’individualisme et la soumission à l’autorité religieuse ». Il fournit ici quelques clefs de compréhension de son œuvre, et éclaire le lecteur sur ses intentions, mettre en scène des « problèmes moraux » (c’est lui qui souligne). Il revient encore une fois sur le sujet, le 9 février 1932, à propos d’un article italien consacré à Œdipe, qui aurait dénaturé son texte et sa pensée. Ainsi, pour lui, « l’individualisme bien compris » ne doit pas être opposé au communisme. Rappelons que, en ce début des années 30, face aux fascismes qui montent un peu partout en Europe, Gide, comme Malraux et nombre d’autres, faisait partie de ces intellectuels français mobilisés pour la défense des valeurs de liberté, combat qu’incarnaient alors les communistes, dont ils s’étaient fait les « compagnons de route ». On sait ce qu’il adviendra, dans le cas de Gide et de ses camarades, de cette « illusion lyrique », confrontée à la réalité de l’URSS sous la tyrannie de Staline.
En juin 1932, Œdipe fut joué à Darmstadt, en Allemagne, dans la Hesse. Gide assistait à la dernière représentation, et la commente. Il loue la mise en scène de Hartung, qui a accentué un certain nombre des effets comiques, des « plaisanteries plus ou moins incongrues qui émaillent » la pièce. Pitoëff, pour Anvers, avait demandé une espèce de préface à l’auteur, afin de prévenir le public de ses intentions, de peur qu’il « n’osât pas rire ». Pour Paris, la précaution était tombée à plat. Et Gide en tire le bilan, disons contrasté :
Les plaisanteries d’Œdipe déplurent, en général, et rebutèrent même certains des mieux disposés. (…) Je crois que c’est à ces « effets faciles » que je dus en grande partie l’insuccès de la pièce (en dépit de l’enthousiasme de certains).
Plus de six mois après, le 2 janvier 1933, Gide traite une ultime fois de son Œdipe, dans un paragraphe qui poursuit son autoplaidoyer en faveur des « plaisanteries, trivialités et incongruités » qu’il y a mises : il n’a jamais voulu écrire un « Œdipe, et sublime, et de grand style », plus proche de l’antique en somme, et ce même si cette formule « eût pu prétendre sans doute à quelque succès », dit-il. Ce qui le requérait, dans cette entreprise, n’était point de se poser en rival de Sophocle, mais de « laisser voir l’envers du décor », de démythifier le mythe et son héros, dirions-nous aujourd’hui. Gide se revendique d’une vision résolument moderne, pour son époque, et prend à partie son lecteur / spectateur : « C’est à votre intelligence que je m’adresse. Je me propose, non de vous faire frémir ou pleurer, mais de vous faire réfléchir. » On ne saurait s’exprimer plus clairement. Nous sommes bien là dans un théâtre d’idées, où les personnages incarnent des concepts, et consacrent une grande partie de leur temps de parole à s’analyser, à commenter les événements, les réactions des uns ou des autres. Un théâtre intellectuel, expérimental, exigeant, et, partant, pas très populaire.
Gide tirera les leçons de ces expériences dans ses dernières productions.
Œdipe se présente comme un drame en prose, en trois actes, chacun d’entre eux étant introduit par une citation d’un auteur antique. Sophocle : « Beaucoup de choses sont admirables ; mais rien n’est plus admirable que l’homme » (Antigone) ; Euripide : « Œdipe, ô imprudemment engendré ! fils de l’ivresse » (Les Phéniciennes) ; Sophocle à nouveau : « Ne me prenez pas, je vous en conjure, pour un contempteur des lois » (Œdipe à Colone). Les deux premières sont claires, rappelant deux éléments majeurs du mythe d’Œdipe : sa réponse à l’énigme posée par le Sphinx, et sa naissance illégitime, fils adoptif de Polybe, bâtard du roi Laïos, qu’il a plus tard assassiné sans savoir qui il était, avant d’épouser sa veuve, Jocaste (laquelle est au courant de tout), avec qui il aura quatre enfants. Deux filles, Antigone et Ismène, deux garçons, Polynice et Etéocle, encore adolescents. Ce qui fait de lui, devenu roi de Thèbes, à la fois un parricide, un mari et un père incestueux, dont les filles et les fils sont à la fois ses sœurs et frères. Quant à la troisième citation, elle est plus ambiguë, se plaçant sur le plan, non point de la vie du héros, mais de ses idées « politiques », pourrait-on dire.
Tout en s’affranchissant de la convention dramaturgique classique qui veut que chaque personnage entrant ou sortant induise une nouvelle scène (là, chaque acte constitue un ensemble à lire – et jouer – d’un seul trait), Gide respecte le mythe illustre d’Œdipe tel que les Anciens l’ont conté, mis en scène, interprété. Nous sommes à Thèbes, dans le palais royal où Œdipe règne depuis vingt ans (il en a quarante), en tyran orgueilleux, égoïste (comme Saül ou le roi Candaule), obnubilé par son bonheur insolent, alors que son peuple souffre le martyre, victime d’une épidémie de peste. Mais Œdipe est aussi intranquille, insatisfait de sa fortune, et se doute que nombre de secrets dans sa destinée lui ont été celés. Il pourrait interroger Tirésias, le devin aveugle, mais il ne l’aime pas, se montrant même grossier à son égard. C’est réciproque : celui-ci, respectant et craignant les dieux (ou dieu, ou le Dieu, selon les moments), considère son maître comme un impie. Comme le chœur, reflétant « l’opinion du plus grand nombre ». Tandis que Créon, le frère de Jocaste, incarne la tradition, les convenances, Œdipe se veut lui, auteur de son propre destin. En tant que bâtard, il y a, selon lui, « tout à créer, tout à inventer ». Mais on sent une obscure menace planer sur ce fragile équilibre. En effet, Créon, de retour de l’oracle d’Apollon, à Delphes, prévient : « Il y a quelque chose de pourri dans le royaume. »
Les événements vont alors s’enchaîner avec leur logique implacable, puisque voulue par les dieux, qui conduira Œdipe à la révélation de la vérité, puis à la catastrophe : suicide de Jocaste après ses aveux, automutilation puis bannissement de Thèbes, en compagnie de ses seules filles. Antigone, la bigote, qui songeait à se faire vestale, trouve sa rédemption en se sacrifiant au service de son père infirme. Ismène la suivra. Entre temps, les principaux personnages, comme des Allégories médiévales, débattront de ces grandes « idées » dont Gide parlait à propos de sa pièce : un roi doit-il s’incliner devant la puissance d’un ou des dieux ? l’homme qui a vaincu le sphinx est-il tout-puissant ? comment gouverner pour le bien du plus grand nombre ?... Une problématique à la fois religieuse et politique, au cœur des réflexions de Gide en ces années 30, on l’a dit.
Mais la grande originalité de la pièce de Gide, à nos yeux, consiste dans la place qu’il accorde à ses jeunes personnages, les quatre enfants d’Œdipe et de Jocaste. Les garçons surtout, beaux, forts, intelligents, « des tourmentés », estime le père, en qui il se reconnaît et dont il est fier. Il en a fait des poètes. Polynice est l’auteur d’odes. Etéocle de deux traités, Le Mal du siècle (au grand dam de M. A. !) et Notre inquiétude. Les chats ne font pas des chiens, oserait-on écrire, encouragé en cela par Gide, qui recourt dans sa pièce, à plusieurs reprises, à un style familier, voire cru. « Et si je te foutais mon poing sur la gueule ? », lance à un moment Polynice à Etéocle, les deux frères se querellant à propos de leurs sœurs. Pour « plaisanter », chacun a avoué à l’autre sa flamme : Etéocle pour Ismène, Polynice pour Antigone, qu’il voudrait épouser. Créon, représentant de la morale et de la société, se montre scandalisé de cette éventuelle reproduction d’incestes, dans une famille, la sienne, qui en compte déjà un d’envergure. « Je refoule », conclut plaisamment Etéocle, qui aurait quand même bien voulu coucher avec Ismène. Rien d’étonnant, sitôt leur père disgracié, chassé du trône et de la ville, que les lionceaux montrent leur appétit pour le pouvoir. On peut imaginer qu’ils ne tarderont pas à se déchirer.
Quatre-vingt-dix ans ayant passé depuis la publication d’Œdipe, puis sa création, à sa lecture, c’est paradoxalement ce qui a fait son insuccès à l’époque – les clins d’œil, anachronismes, « plaisanteries » dont Gide l’a truffé, et à qui il attribue le four de sa pièce – qui nous séduit, nous, modernes. Parce que son style se trouvait plus en harmonie avec la « jeune génération », ces deux fils d’Œdipe, à la fois poètes, « polissons », bagarreurs, ambitieux, libres et probablement guère religieux, qu’il a placés au cœur de son intrigue, que les tirades quelque peu ampoulées et convenues des autres personnages, les adultes : Créon, Tirésias, Jocaste. Même Antigone est ennuyeuse. Et parfois Œdipe lui-même. L’Œdipe de Gide est une pièce riche, compliquée, tourmentée, bien dans l’air du temps où elle a été écrite. À ce titre, ses problématiques, ses tentations peuvent parler aux jeunes gens d’aujourd’hui.