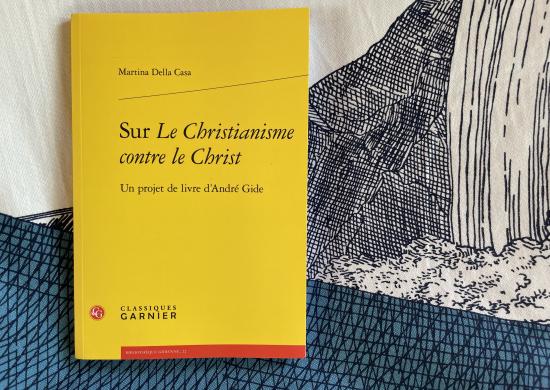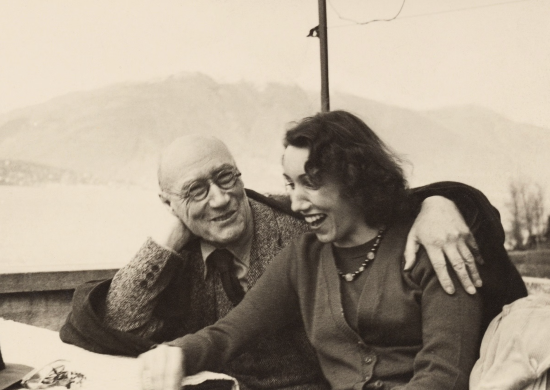Retour sur le colloque s’étant tenu à la BnF à l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de l’écrivain.
Toutes les conférences sont disponibles sur le site de la BnF.
Gide le dissident. Gide le généreux. Gide l’Européen. C’est une image à trois facettes qui ressort de la première moitié de la journée consacrée à André Gide à la Bibliothèque nationale de France le 22 novembre 2019. Pierre Masson explore, dans son intervention, le concept de dissidence chez un auteur qui a dit que « le monde ne sera sauvé, s’il peut l’être, que par des insoumis ». Une dissidence qui traverse toute l’œuvre de l’écrivain, à partir des chaînes cassées du Prométhée mal enchaîné jusqu’à Lafcadio.
Cependant, Gide n’invite pas au conflit : il exprime le besoin de s’affirmer en opposition à son contexte, sans pour autant en arriver à la provocation. De cette attitude naît son intérêt pour le système judiciaire, ainsi que son engagement politique ; sur le plan littéraire, ce besoin de remise en question se traduit dans une propension à mettre les textes en opposition avec leurs modèles anciens : Gide vise à concevoir des narrations ouvertes, où le lecteur est obligé à remettre en cause ses certitudes. Martine Sagaert se penche, ensuite, sur le concept de « générosité » chez Gide, en mettant en valeur le rapport ambigu de l’écrivain avec l’argent. Son éducation bourgeoise influence sûrement ses habitudes économiques : il alterne des moments de grande générosité avec des moments de modération des dépenses. Gide, pourtant, culpabilise de sa condition bourgeoise et soutient la cause d’une meilleure justice sociale contre les privilèges des héritages. En raison de ce rapport problématique, les actes de générosité présents dans ses œuvres littéraires sont très rarement désintéressés : le plus souvent, ils semblent être un moyen d’auto-affirmation.
Mais il y a une forme de partage à laquelle l’écrivain est entièrement voué : le partage de la beauté. Pendant toute sa vie, il essaie de partager avec ses proches les lectures qui l’ont marqué ainsi que les paysages qui l’ont conquis, en démontrant ainsi son ouverture à l’autre. La réflexion s’achève par l’intervention de Paola Codazzi, qui explore le rapport de Gide avec l’idée d’Europe. Après la catastrophe de la Première Guerre, l’écrivain conduit une réflexion sur cette « heureuse proportion de terre et d’eau » (L’Avenir de l’Europe, 1923) qui l’amène à définir les contours d’une Europe multiforme, qui vit de la multiplicité de ses identités, dans l’esprit de l’« union dans la différence ». Si cette idée d’Europe est très proche de cette « in varietate concordia » qui est la devise actuelle de l’Union Européenne, il est vrai aussi que l’Europe d’aujourd’hui, dominée par les intérêts financiers, s’éloigne décidément de l’Europe des Lettres souhaitée par Gide. Convaincu que l’entente européenne ne pouvait se rétablir que par la reprise des contacts entre les anciens ennemis, après la guerre, Gide prend part à toutes les occasions de dialogue (Colpach, Pontigny), en établissant de multiples relations et correspondances, dans le but de reconstruire une Europe « à mesure d’homme ». Après un échange ardent avec le public, en clôture de matinée, Thomas Cazentre, conservateur à la BnF, montre à ce dernier les précieux manuscrits des Faux-monnayeurs et de Si le grain ne meurt, conservés par la Bibliothèque. Le premier, constitué de cinq volumes (un volume de brouillons et notes, le manuscrit en trois volumes, une dactylographie corrigée) a été cédé par Gide à un collectionneur avant l’achèvement du roman et constitue le seul manuscrit de l’œuvre.
La journée, très riche, se poursuit dans l’après-midi. Jocelyn van Tuyl enquête sur le rapport de Gide avec les réfugiés pendant les deux Guerres mondiales, à l’aide de l’analyse de deux articles de presse. Le premier, un article titré « Réfugiés », écrit par Gide en 1915, reflète l’engagement de l’auteur et de Maria Van Rysselberghe dans le Foyer franco-belge et essaie de susciter la solidarité des lecteurs pour cette initiative humanitaire qui marque profondément l’écrivain. Au cours des années trente, Gide poursuit son engagement en visitant les champs de réfugiés dont il déplore les conditions de vie ; en 1939, dans une pseudo-interview, il conteste le traitement réservé par la France aux réfugiés qui fuient le nazisme et le fascisme. Finalement, Jocelyn van Tuyl met en valeur la présence des États-Unis dans l’aide aux réfugiés européens : si Gide a toujours refusé de profiter du sauf-conduit qui lui est proposé pour s’échapper au-delà de l’océan, il aidera néanmoins plusieurs de ses amis à se servir du dispositif. Ces amis, dont par exemple Jacques Schiffrin, fondateur de la maison d’édition « Pantheon Books », seront les phares de la littérature française en exil : à travers ces intellectuels qu’il aide à sauver, et qui travailleront pour garantir la parution des œuvres françaises malgré les limitations imposées par la guerre, Gide se sauve également lui-même et, surtout, la diffusion de son œuvre. Généreux envers les innocents, mais aussi empathique envers les coupables, « Gide e(s)t le criminel » rebondit Jean-Michel Wittmann dans la communication suivante. L’empathie que l’auteur éprouve envers ceux qui ont commis un délit, démontrée par ses nombreux écrits sur le sujet juridique, dérive du fait qu’il a pu se considérer, lui aussi, coupable de sa position vis-à-vis de son contexte, notamment au cours de sa jeunesse : en parlant des individus criminels, Gide revient donc sur un aspect qui, toute proportion gardée, lui a été familier à un moment de sa vie. Dans ses œuvres de fiction, les criminels ne sont pas nombreux ; souvent l’auteur leur accorde le bénéfice du doute : les mots crime et criminel dans Les Caves du Vatican sont écrits en italique, pour amortir leur poids, et les délits — intentionnels, involontaires ou fautifs — des personnages de Gide invitent à la réflexion sur la nature du crime lui-même. La question posée n’est pas seulement d’ordre moral, mais également psychanalytique et social : les criminels mettent en question les valeurs partagées, ils s’écartent de la route, ce qui les rend intéressants aux yeux de Gide le dissident. Le criminel est un individu qui accomplit des actes individuels et non reconductibles aux règles dictées par la société, mais qui, paradoxalement, peut être considéré comme coupable seulement par rapport à ces mêmes règles : il est coupable par rapport à son contexte, à sa contingence. Et la question de la contingence est au centre de la communication de David Walker, qui achève la journée. Si Gide, dans ses premiers ouvrages, considère avec ironie le poids de la contingence, il est porté au fur et à mesure à en mesurer les effets sur la réalité. Dans sa jeunesse, il n’accepte pas l’état des choses comme définitif, mais envisage une perpétuelle évolution de l’homme et du monde. L’acte gratuit est la clé de voûte, dans ce qu’il a de profondément contingent : la gifle de Prométhée aurait pu ne pas se produire, tout comme le meurtre de Fleurissoire. Gide insère dans ses textes des disjonctions, des expectatives qu’il déçoit par la suite : tout aurait toujours pu se passer différemment. Dans son refus de la contingence, tout comme dans sa façon de l’affronter, Gide représente le monde comme le prisme de tous les mondes possibles.