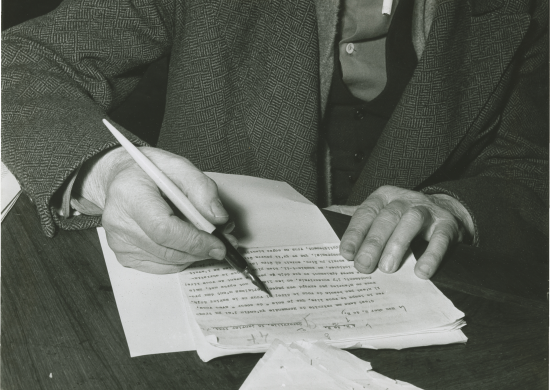Cette pièce demeurée inachevée (un seul acte en quatre scènes) a été écrite par André Gide en 1899, durant sa formidable effervescence créatrice de la toute fin du XIXe siècle, quand il consacra une partie importante de son travail à l’écriture théâtrale.
À l’origine, il devait s’agir d’un « opéra-comique » composé par Raymond Bonheur (1861-1939). Issu d’une famille d’artistes, le musicien fut l’ami de toute l’intelligentsia de son époque, dont Francis Jammes (qui lui dédia deux poèmes), Claude Debussy (qui lui dédia son Prélude à l’Après-midi d’un Faune), ou Gide, avec qui une collaboration fut donc envisagée. Bonheur était coutumier de mettre en musique des textes littéraires, par exemple de Jammes ou de Maïakovski. Mais il semble, d’après des lettres échangées entre les deux « associés », que ce soient des divergences esthétiques qui aient fait capoter le projet. Gide, s’il avait bon caractère, était aussi conscient de sa valeur et, notamment pour la scène, avait une idée très précise de ce qu’il souhaitait. On verra par exemple, plus tard, dans l’aventure de Perséphone, que sa collaboration avec d’autres créateurs (Stravinsky en l’occurrence) a pu devenir orageuse.
Son texte, resté totalement inédit et jamais joué, n’a été publié qu’en 1946, par Richard Heyd chez Ides et Calendes, accompagné d’un « In memoriam » pour Raymond Bonheur (disparu sept ans plus tôt) et des lettres que Gide lui avait adressées.
Par rapport à ses pièces précédentes, Le Retour présente deux originalités : il est écrit en vers libres, et c’est la première fois que Gide situe son intrigue de nos jours.
Nous nous trouvons dans une maison bourgeoise de province, où vivent un grand-père avec ses petites-filles Marthe et Lucile. Marthe, l’aînée, est mariée avec Horace. C’est une femme austère. Sa sœur cadette, présentée comme fragile, relevant de maladie, est sortie du couvent où elle a dû étudier. Avec leur servante, Rose, tous attendent le retour d’Horace, parti depuis trois ans en Égypte, à Assouan, où il dirige une sucrerie. Bien sûr, ils sont impatients, mais Marthe se réfrène : pas question, par exemple, de se mettre en frais, d’accueillir son époux dans une tenue nouvelle, affriolante. Elle a décidé de porter la même vieille robe grise qu’elle avait le jour où il est parti. On sent une certaine tension entre les deux sœurs. Lucile ne cesse de taquiner Marthe, de lui faire sentir leurs différences d’âge, de caractère, de charme.
Lorsqu’Horace arrive, c’est un grand souffle d’air qui entre dans la pièce. Il décrit l’Égypte comme un paradis, se dit régénéré, aguerri, rayonnant de santé. Il exprime son amour à sa femme, partagé, dans un jeu subtil d’alternance de tu et de vous. Mais l’on comprend vite que Lucile est amoureuse de son beau-frère, lequel lui a rapporté en cadeau « un petit écureuil des îles jaune et noir » et qu’il est probable qu’Horace succombera à sa jeunesse, à sa beauté, à son espièglerie, plus en accord avec son propre caractère que celui de sa sinistre épouse. Ce ne sont là que suppositions, mais, à la fin de sa scène 4, Gide instille une palpable ambiguïté dans les rapports entre Horace et Lucile.
On notera que, lorsqu’il écrit sa pièce, Gide ne connaît pas le « paradis » d’Horace, Assouan. On se serait plutôt attendu à ce qu’il envoie son héros en Algérie, son Éden à lui, qu’il avait découvert dès 1893 et où il était retourné presque chaque année depuis. Pour visiter l’Égypte, il attendra 1939, au cours d’un long périple en Orient. Puis ilrécidivera à la fin de 1945. Mais on ignore si, dans le reste de sa pièce, il aurait placé dans la bouche d’Horace des descriptions plus précises d’Assouan, de son pays d’adoption, des gens, à qui Gide, par-dessus-tout, se montrait sensible. Toutes choses qu’Horace s’engage « à demi-voix » à raconter à Lucile, en ouvrant ses malles, la musique (censément composée par Raymond Bonheur) couvrant parfois ses paroles. On ne saura jamais non plus pourquoi Horace était parti travailler au loin, pourquoi sa femme ne l’y avait pas accompagné, et si son retour à la maison n’est que provisoire, ou définitif. Il est vraiment dommage que Gide, si bien parvenu à piquer la curiosité de son lecteur, n’ait pas terminé sa pièce. Elle aurait pu se suffire à elle-même, sans musique.