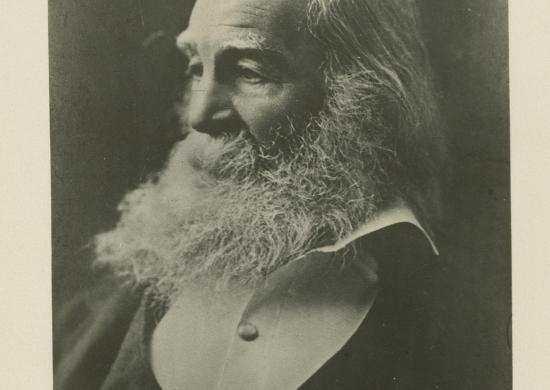Akie Nishimura est enseignante-chercheuse à la faculté des relations internationales de l’Université de Shizuoka. Elle s’intéresse depuis 2010 à André Gide. Elle a remporté en 2023 le Prix d’encouragement Shibusawa-Claudel pour son livre André Gide et le christianisme (アンドレ・ジッドとキリスト教, Sairyusha, 2022), dans lequel elle examine de près les notions de mal (悪), de maladie (病) et du diable (悪魔) dans l’œuvre gidienne.

Ambre PHILIPPE : J’aimerais d’abord vous interroger sur la façon dont vous avez découvert l’œuvre de Gide. Quel est le premier livre de Gide que vous avez lu ? Qu’est-ce qui a retenu votre attention dans son écriture et comment en êtes-vous arrivée à choisir la littérature française comme terrain de recherche ?
Akie NISHIMURA : Le premier livre de Gide que j’ai lu était La Porte étroite. C’était en 2008 et en ce temps-là, j’étudiais à Paris dans le cadre d’un programme d’échange universitaire. Un jour, je suis allée voir un spectacle de ballet à l’Opéra de Paris et, en parlant avec une dame assise à côté de moi, j’ai mentionné que j’étudiais la littérature française à l’université, au Japon, et elle m’a recommandé Gide. J’ai tout de suite acheté La Porte étroite, qui était peut-être l’œuvre gidienne la plus connue au Japon. En lisant Gide, j’ai eu l’impression de trouver dans ses romans des idées religieuses similaires à celles de Shūsaku Endō[1], mon écrivain préféré. Ainsi, j’ai choisi Gide comme sujet de recherche.
AP : En 2013, vous avez soutenu un master intitulé « L’Étude comparative du communisme d’André Gide avec le socialisme d’Oscar Wilde » à l’Université Paris 7. Vos recherches ont-elles changé le regard que vous portiez alors sur les liens entre littérature et politique ?
AN : J’ai appris que non seulement il existait une relation entre la politique et la littérature, mais que pour des écrivains comme Wilde et Gide, la religion était également fortement impliquée. Aujourd’hui, de nombreux Japonais n’ont pas beaucoup d’occasions de réfléchir aux relations entre la religion, la société et la politique. Cependant, pour les écrivains français de l’époque, leur position religieuse avait un impact important sur la façon dont ils considéraient la politique et créaient la littérature. J’ai trouvé très intéressant d’analyser les œuvres et de découvrir ce que les écrivains essayaient de transmettre à la société de l’époque, y compris la situation religieuse.
AP : Vous concluez ce travail de recherche en ouvrant à d’autres liens : ceux entre littérature et médecine, à partir du fait que Gide a écrit ses Faux-Monnayeurs dans le sillage de sa lecture de Freud. Est-ce ce qui vous a conduit au livre suivant, André Gide et le christianisme : autour du mal, de la maladie et du diable ? Pouvez-vous nous parler plus précisément de cet essai, pour le présenter aux lecteurs français qui ne lisent pas le japonais ?
AN : Lorsque j’écrivais mon mémoire de master, j’ai découvert Les dégénérescences de Max Nordau. J’étais intéressée par le fait que ce médecin, qui avait étudié à l’école de la Salpêtrière auprès de Jean-Martin Charcot, parlait de la façon dont étaient « malades » les écrivains de l’époque comme Mallarmé, Zola et Wilde. Mallarmé et Wilde ont tenté de réfuter Nordau. Tout a commencé lorsque j’ai également voulu réfléchir à cet échange entre littérature et médecine chez Gide. En fait, les œuvres de Gide représentent de nombreuses « maladies », et j’ai voulu savoir ce que chacune d’elles signifiait et comment la façon dont les « maladies » étaient représentées variait selon les époques. C’est devenu le sujet de ma thèse.
Chez Gide, la « maladie » était étroitement liée non seulement au discours médical de l’époque, mais aussi à ses pensées religieuses. Ce travail révèle que les changements dans sa propre pensée sont liés à la façon dont la « maladie » est décrite dans ses romans.
AP : Avez-vous connaissance du livre que Martina Della Casa a publié en même temps que vous sur le projet de livre que Gide n’a jamais terminé, Le Christianisme contre le Christ[1] ? Il me semble qu’il y aurait là encore des liens à tisser avec votre travail. La question de la religion qui vous occupe conduit naturellement à penser celle du corps, de la sexualité, mais aussi de la maladie et du diable. Ce sont des questions qui, étant les plus intimes, ont aussi une portée universelle. Pouvez-vous nous dire ce qu’évoque pour vous cette passerelle entre l’individuel et la communauté humaine et si le débat autour d’une « foi nouvelle[2] » vous semble toujours actuel ?
AN : Oui, j’ai lu son livre. En le lisant, j’étais heureuse de savoir qu’il y a une chercheuse qui partage les mêmes intérêts que moi.
Je ne suis ni chrétienne, ni française, ni européenne. Cependant, je crois que les questions que Gide a traitées dans ses œuvres, comme la sexualité, l’hypocrisie de la religion ou « le mal et le bien », ont une universalité qui transcende les frontières du temps, des régions et des religions.
Mais en même temps, je ne pense pas qu’il soit facile pour les Japonais d’aujourd’hui de comprendre l’œuvre de Gide. C’est pourquoi, en tant que chercheuse gidienne, je souhaite transmettre son intérêt et son universalité de manière simple à comprendre, et je souhaite également que les gens découvrent l’influence positive que la littérature et les écrivains peuvent avoir sur la société.
AP : En 1935, André Gide écrit : « Je prétends rester profondément individualiste, en plein assentiment communiste et à l’aide même du communisme. Car ma thèse a toujours été celle-ci : c’est en étant le plus particulier que chaque être sert le mieux la communauté[3]. » Il me semble que cette idée se rapproche de ce que Soseki a pu dire lors de sa conférence à l’École des Pairs en 1914, publié en France sous le titre Mon individualisme. Avez-vous déjà pensé à établir des liens entre Gide et ses contemporains japonais ?
AN : Je pense que l’on peut dire que Gide était un écrivain qui a eu une influence importante sur la littérature japonaise. Des exemples bien connus incluent Jun Ishikawa (1899-1987) et Hideo Kobayashi (1902-1983). Cependant, à ma connaissance, personne ne semble avoir étudié cette relation en profondeur. J’aimerais travailler sur ce sujet un jour et je crois que cette recherche apportera de nouvelles connaissances à la fois à la recherche gidienne et à la recherche sur la littérature japonaise.
AP : Masahiko Nakayama écrivait en 1970 : « Tant que notre pays n’aura pas résolu les questions qui lui sont posées depuis un siècle, André Gide restera pour nous un écrivain actuel. Ainsi, malgré la curiosité qu’ils ont de connaître les productions plus récentes de la littérature européenne (on a traduit en japonais presque tous les romans de Robbe-Grillet, de Sollers), les Japonais n’ont pas encore résolu tous les problèmes gidiens ». Comment commenteriez-vous cette phrase en 2024 ?
AN : Au Japon, il est vrai qu’il reste encore des problèmes soulevés par Gide qui ne sont pas résolus. Je n’ai cependant pas l’impression que Gide continue d’être perçu comme un écrivain actuel. Je pense que cela est dû au fait que Gide est reconnu, dans le Japon contemporain, comme un écrivain étranger appartenant au passé, ce qui rend difficile la perception de sa modernité.
Cependant, comme je l’ai mentionné plus haut, l’œuvre de Gide me semble avoir une universalité qui transcende le temps et les lieux. C’est pour cette raison que je pense que les travaux de Gide offrent l’occasion d’approfondir notre compréhension et de connaître divers points de vue sur les enjeux actuels de la société japonaise.
AP : Votre collègue Yukio Nishimura a pu me dire lors de notre entretien que vous vous intéressiez au féminin chez André Gide, tout en supposant un lectorat gidien plus féminin que masculin au Japon. Qu’en pensez-vous ?
AN : Je ne pense pas que la réception de Gide au Japon soit liée aux questions féminines ou au féminisme. Pour ma part, j’ai discuté de la sexualité de Gide dans mon mémoire de Master présenté au Japon, en me concentrant sur la question de la féminité et de la masculinité dans le triptyque gidien. Cependant, ce triptyque [L’École des femmes, Robert et Geneviève ou La Confidence inachevée] n’est pas ce qui est le plus lu de l'oeuvre gidienne au Japon, et je pense que la sexualité (autrement dit l’homosexualité) de Gide est mieux connue et étudiée que les questions liées au « féminin ».
AP : Quels sont les sujets qui vous intéressent actuellement ?
AN : Je m’intéresse actuellement à la question de la réception de la littérature étrangère par Gide, à la question de la réception de Gide au Japon, ainsi qu’aux caractéristiques des pensées politique et religieuse de Gide, qui s’est à un moment rapproché de l’Action française. Je souhaite élargir mes recherches non seulement à Gide, mais aussi aux écrivains et penseurs français contemporains et aux écrivains japonais.
Publications d’Akie Nishimura
Articles :
« L’École des femmes, Robert et Geneviève ou La Confidence inachevée », The Komaba Journal of Area Studies, n° 15, 2011, p. 253-277. (FR)
西村 晶絵. ジッドの『贋金つかい』における「悪魔」 [ジッド小特集]. « Le “diable” dans Les Faux-Monnayeurs de Gide » [Dossier spécial Gide], Stella, no 38, 2019, p. 279-296. (JP)
« André Gide and Charles Maurras: The Specific Aspects of Their Approach and Separation », Annual Memoirs of the Otani University Shin Buddhist comprehensiv research Institute, n° 38, p. 39-52, 2021. (EN/JP)
« L'action française et les intellectuels chrétiens : autour de Maurras, Maritain et Gide », 盛岡大学紀要(Bulletin de l’université de Morioka), no 39, p. 39-50, mars 2022. (FR)
西村 晶絵. ジッドにおける「神」と「キリスト」(« Dieu » et « Christ » chez Gide). Stella, no 42, 2023, p. 113-125. (JP)
Mémoire de Master 2 :
L'Étude comparative du communisme d’André Gide avec le socialisme d’Oscar Wilde, Paris 7, 2013. (FR)
Monographie :
アンドレ・ジッドとキリスト教 : 「病」と「悪魔」にみる「悪」の思想的展開 (André Gide et le christianisme. Autour du mal, de la maladie et du diable), Tokyo, 彩流社 (Sairyusha), 2022, 438 p. (JP)
[1] Shūsaku Endō (1923-1996) est un écrivain japonais catholique connu pour son travail sur la foi et les conflits culturels. Il a connu le succès au Japon avec son livre Shiroi hito (白い人, L'Homme blanc), qui a reçu le Prix Akutagawa en 1955. En France, son oeuvre la plus connue demeure Silence (沈黙, Chinmoku), adaptée au cinéma par Martin Scorsese en 2016.
[2] Sur Le Christianisme contre le Christ. Un projet de livre d’André Gide, Paris, Classiques Garnier, 2022 (Prix 2014 de la Fondation Catherine Gide du Centre André Gide-Jean Schlumberger de la Fondation des Treilles).
[3] Cf. Martina Della Casa, ibid. : « Dans Si le grain ne meurt, Gide fait remonter l’idée et la naissance de ce projet [Le Christianisme contre le Christ] à la période de ses aventures en Afrique du Nord et plus spécifiquement de son deuxième voyage en Algérie avec Oscar Wilde (janvier-avril 1895). En concomitance avec son initiation à l’homosexualité et en contraposition radicale avec sa formation religieuse, l’écrivain élabore à cette époque une sorte de foi nouvelle fondée sur la découverte des lois du désir, dont ses Nourritures terrestres (1897) rendent bien compte. »
[4] André Gide, « Défense de la culture », 22 juin 1935, dans Littérature engagée, Paris, Gallimard, 1950, p. 85.