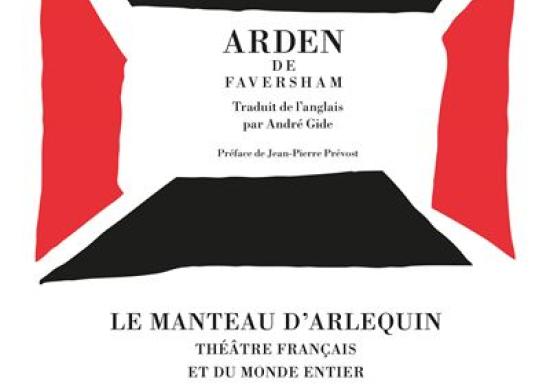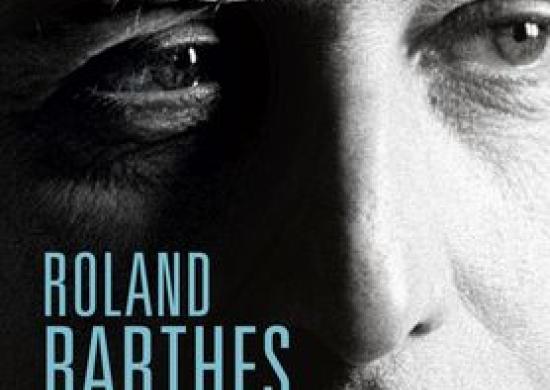Les mots des mères
« Ô maman, maman, que cela est effrayant de se sentir tellement aimé ! quelle obsession morale, que ce perpétuel désir d’être digne ! »
Lettre d’André Gide à sa mère, 31 octobre 1894.
Martine Sagaert et Yvonne Knibiehler ont publié, dans la collection « Bouquins » de Robert Laffont, Les Mots des mères, où la relation entre Juliette Rondeaux et son fils, André Gide, est relatée sur quelques pages.
Longtemps, les hommes ont défini la maternité à leur manière : succédant aux prêtres, les philosophes, les médecins, les politiques ont prescrit des règles de conduite aux « filles d’Ève ». Les femmes n’avaient pas leur mot à dire, à l’exception des mieux nanties ou des plus combatives. Progressivement, l’instruction des filles s’est généralisée, les femmes ont osé revendiquer leurs droits. Puis, grâce aux progrès scientifiques, elles ont pu limiter leur fécondité, devenir mères selon leur volonté et non plus selon leur « nature ». Et en gagnant leur vie, en accédant à l’espace public, elles ont pris la parole de plus en plus librement.
Que disent les femmes, qu’écrivent-elles sur la maternité, sur la relation entre mère et enfant ? En leur donnant ici la parole, en mettant en valeur leurs dits et leurs écrits, présentés dans leur contexte historique et social, cet ouvrage, qui inclut une anthologie littéraire — du XVIIe siècle à nos jours —, offre une histoire passionnante et originale.
D’une grande diversité (lettres, billets d’abandon, conseils de nourrices, traités d’éducation, poèmes, journaux, romans, autofictions, écrits pour la jeunesse, bandes dessinées, blogs...), les textes proposés émanent d’écrivaines célèbres ou d’anonymes. En abordant des thèmes aussi divers que le déni de grossesse, les nouvelles configurations familiales, la transmission maternelle ou la conciliation maternité-travail, ils illustrent des évolutions de la société contemporaine et les nouvelles façons d’être mère.
Avis sur Télérama.
Et nunc manet in vobis : André Gide, aujourd’hui et plus que jamais
Évelyne Méron vient de publier son ouvrage, André Gide, aujourd’hui et plus que jamais. Et nunc manet in vobis, dans la « Bibliothèque gidienne » des Classiques Garnier.
Ce livre, fait d’articles rédigés au cours de plusieurs décennies, vient éclairer en André Gide le moraliste, le gourou sans doctrine. André Gide écrivit, et vécut, orienté par le souci de ses lecteurs. Il incite à l’autonomie morale, et s’avère étonnamment utile pour notre temps, et pour tout temps.
Retrouvez l’ouvrage et toutes les informations sur le site de l’éditeur.
« La Villa Aublet, maison-atelier de Théo Van Rysselberghe »
Une contribution écrite par Jane Block, « The Villa Aublet: A new Parisian home and atelier for Théo and Maria Van Rysselberghe » sera publiée en novembre 2018 dans le Liber Amicorum (p. 26-39) dédié à Françoise Aubry, conservatrice en chef du Musée Horta à Bruxelles, à l’occasion de son départ en retraite. En novembre 1901, Théo Van Rysselberghe s’installait dans une maison de trois étages qu’il avait louée sur une voie privée du 17e arrondissement dans le nord-ouest de Paris, et qui comprenait un atelier énorme construit spécialement pour lui. Ils devinrent sa résidence et son atelier principaux pendant quinze ans. Le grand atelier, une commission jusqu’ici inconnue de l’architecte Louis Bonnier, permit à Théo Van Rysselberghe de peindre des grandes toiles telle qu’Une Lecture et servit de cheville ouvrière dans son développement artistique. En effet, « Le Laugier » devint “un point de passage obligé du “circuit” pour les amis du cercle d’André Gide[1]. Les détails concernant la maison et l’atelier étaient restés ignorés jusqu’à présent, les recherches étant rendues d’autant plus difficiles que le bâtiment de location fut démoli en 1976.
En utilisant les photographies de l’époque, des lettres échangées entre les Van Rysselberghe et leurs amis, et des documents d’archives, l’auteur a réussi à identifier parmi les différents bâtiments de la voie privée, Villa Aublet, qui sont tous numérotés « 44 rue Laugier » celui qu’habitaient les Van Rysselberghe.
Pour des renseignements complémentaires, contactez Benjamin Zurstrassen (b.zurstrassen[at]hortamuseum.be)(éd.), Liber amicorum Françoise Aubry, Bruxelles, (sans éditeur), 2018.
[1]Auguste Anglès, André Gide et le premier groupe de La Nouvelle Revue française, Paris, Gallimard, 1978, p. 47.
Anthologies du Bulletin des Amis d’André Gide
Pierre Masson vient d’éditer, dans la collection « Bibliothèque gidienne » des Éditions Classiques Garnier, le premier tome des Anthologies du Bulletin des Amis d’André Gide : Textes inédits et pages retrouvées.
Ce recueil rassemble tous les textes de Gide, inédits ou oubliés dans des revues inaccessibles, que le Bulletin des amis d’André Gide a publiés en 50 ans d’existence. Ils sont ici présentés en quatre catégories, souvenirs, engagements, essais, fictions, accompagnés de notices détaillées.
Gide & les jardins
La Fondation Martin Bodmer et Metis Presses se sont associées pour aboutir à la publication d’un très bel ouvrage, Des jardins et des livres. Gide y trouve sa place grâce à l’article de Jean-Pierre Zubiate, qui nous parle du « promeneur-lecteur » que fut André Gide, et notamment de son « texte charnière », Les Nourritures terrestres.
« On ne saurait trouver meilleur creuset de contradictions. Logiquement, Les Nourritures terrestres font du jardin le lieu de réflexion sur l’intégration des contraires dans un monde où la nature et la culture, la sensation et le signe, l’intimité et l’altérité, le donné et la création n'existent que de ne pas s’exclure. »
Il faut donc ouvrir ce beau livre et ne pas oublier de revenir aussi à l’édition de référence : Les Jardins d’André Gide, paru aux Éditions du Chêne en 1998.
André Gide, une question de décence
Pierre Lachasse vient de publier aux Éditions Classiques Garnier, dans la collection « Bibliothèque gidienne », André Gide, une question de décence.
Les onze essais réunis dans ce livre étudient quelques pratiques de la poétique gidienne (traitement des genres, ironie narrative, intertextualité) et situent l’écriture de Gide sous le signe de la décence, qui consiste à créer l’équilibre parfait entre la pensée et la forme qui lui convient.
André Gide et l’aphorisme
Dans la collection « Investigations stylistiques » des Éditions Classiques Garnier, Stéphanie Bertrand, maître de conférences en langue et littérature françaises à l’Université de Lorraine, a publié André Gide et l’aphorisme. Du style des idées.
Elle a reçu, pour cet ouvrage, le Prix de thèse de l’Université de Lorraine 2016 (école doctorale Fernand Braudel).
Comment comprendre l’omniprésence du style aphoristique chez un auteur soucieux de tenir à distance toute posture de moraliste et, plus encore, toute intention moralisante ? L’étude de l’œuvre d’André Gide (fictionnelle, critique et personnelle), considérée dans sa spécificité, mais représentative, aussi, d’un style d’époque, permet de dépasser, de trois manières complémentaires, cet apparent paradoxe. Parangon d’un idéal stylistique défini par la concision, la fermeté et la précision, l’aphorisme contribue aussi, comme mise en scène d’une idée générale, à renouveler les genres ; enfin, il reflète et questionne la problématique question du rapport de l’écrivain à la construction d’une position et d’une autorité en littérature.
André Gide et l’aphorisme. Du style des idées, Paris, Classiques Garnier, « Investigations stylistiques », mai 2018, 588 p.