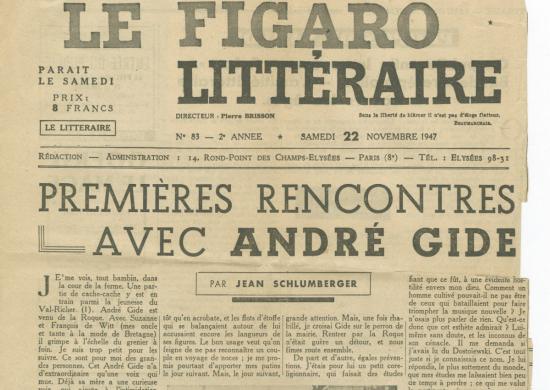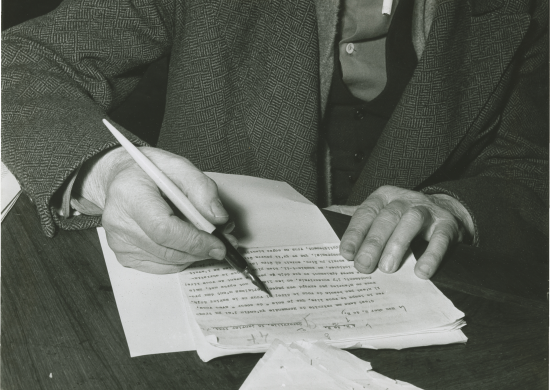Dans le cadre des activités de l’Institut de recherche en Langues et Littératures Européennes, s’est tenu, les 8 et 9 juin 2023, à l’Université de Haute-Alsace, à Mulhouse – dans la salle de réunion de la Faculté des Sciences et Techniques puis dans la salle Nizami Gandjavi de la Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines – le colloque « Amitiés épistolaires entre littérature et politique ».
Organisé par Régine Battiston (la directrice de l’Institut de recherche en Langues et Littératures Européennes), Nikol Dziub (Prix 2019 de la FCG) et Augustin Voegele (Prix 2017 de la FCG), le colloque a réuni dix-huit chercheuses et chercheurs venus de Paris, Évry, Rennes, Brest, Caen, Porto et Lisbonne. Les sept sessions – « Le possible et le dicible », « Réseaux épistolaires », « Correspondances de crise », « La politique dans les marges de la littérature », « Écrivains et politiques », « Le cas lusitanien » et (last but not least !) « Le cas Gide » – ont été l’occasion de découvrir des corpus parfois inattendus : des cas d’épistolographie datant du VIe siècle de notre ère, des exemples d’écriture épistolaire en vers au Portugal au XVIe siècle, ou encore les lettres échangées entre Hermann Hesse et le président de la RFA, Theodor Heuss. Les intervenants comme les auditeurs ont remarqué que certaines questions traversaient l’ensemble des communications – en particulier celle de la hiérarchie entre gens de Lettres et gens d’État, et de ses conséquences sur la rhétorique épistolaire de l’amitié, le protocole interdisant bien souvent aux désaccords de se formuler, et les écrivains étant nombreux à se complaire dans une posture d’incompétence politique.
La session gidienne – soutenue, les organisateurs l’ont rappelé plus d’une fois, par la FCG – était particulièrement attendue, et elle a été particulièrement appréciée. Peu avant qu’elle commence, Ruth Amossy, venue en auditrice (de marque !), s’exclamait : « On est impatients : on l’aime bien, nous, Gide ! » Elle a été l’occasion de vérifier, une fois de plus, que les écrivains aiment à se faire, politiquement, plus bêtes qu’ils ne sont. Combien de fois Gide affirme-t-il ne rien entendre à la politique – allant, dès 1895, jusqu’à faire le vœu, dans une lettre à sa mère, de « garder » sur les événements de la politique « un silence systématique », faute d’être compétent en la matière ! Et pourtant, rares sont, parmi les hommes de littérature, ceux qui peuvent se targuer d’avoir été (du moins après avoir voyagé) plus lucides que lui sur la question coloniale ou sur le problème soviétique.
Trois communications gidiennes se sont donc succédées : la première, de Jürgen Siess (professeur émérite à l’université de Caen), portait sur la correspondance Gide-Blum ; la deuxième, d’Hélène Baty-Delalande (maîtresse de conférences à l’université Rennes 2), était focalisée sur le trio Gide-Coppet-Martin du Gard ; la troisième, enfin, d’Augustin Voegele, avait pour objet d’analyser les « moments politiques » dans la correspondance Gide-Rouart. Jürgen Siess a montré comment, des lettres de jeunesse à celles de la maturité, Gide construit le personnage de son ami Léon Blum en jeune homme de Lettres puis en éminence politique ; et comment, en retour, Blum fait le portrait de Gide en écrivain d’influence – mais sans pour autant lui prêter une véritable dimension politique, car il semble vouloir respecter le désir de retrait de Gide en la matière. Hélène Baty-Delalande, de son côté, a mis en valeur un Gide généreux autant que courageux – et dangereux ! Un Gide qui veut aider son ami Marcel de Coppet dans sa carrière ; un Gide qui veut exprimer publiquement l’« immense plainte » qui l’habite – celle des autochtones opprimés, maltraités par les colons en Afrique ; mais un Gide dont les prises de position politiques mettent parfois en péril l’avancement de Marcel de Coppet, qui pour autant ne renie pas l’amitié qui, de notoriété publique, le lie à l’auteur du Voyage au Congo et de Retour du Tchad. Quant à Augustin Voegele, il a invité l’assistance à suivre dans ses méandres et dans ses métamorphoses politiques l’amitié de quelque quarante-cinq ans qui lie Gide à Rouart : une amitié d’abord mise à mal, au moment de l’Affaire Dreyfus, par des conceptions divergentes de ce que doit être la relation d’un homme de Lettres à la chose politique ; une amitié, ensuite, renforcée par la sollicitation des réseaux politiques de Rouart dans le but – généreux – de soutenir professionnellement ou financièrement des amis comme Maurice Quillot, Daniel Schlumberger ou Jules Iehl (parmi de nombreux autres) ; une amitié, enfin, suffisamment ancienne et profonde pour survivre à la dernière métamorphose de Rouart, qui, devenu un personnage officiel, reproche à Gide, non pas de continuer à pratiquer l’homosexualité (Rouart, en effet, ne se « convertira » jamais comme Ghéon), mais de la défendre et de l’illustrer publiquement, avec Corydon notamment.
Mais surtout, comme l’a bien résumé Régine Battiston dans les conclusions du colloque – dont les actes seront publiés en 2024 aux Éditions et Presses Universitaires de Reims, dans la continuité de deux autres recueils, « Amitiés vives ». Littérature et amitié dans les correspondances d’écrivains (2022) et L’Inimitié dans les correspondances d’écrivains(sous presse, 2023) –, cette session a été l’occasion de se rappeler (l’avait-on oublié cependant ?) qu’avec la complexité politique non synonyme de souplesse morale qui le caractérise, Gide est bien l’un de ces « maîtres » dont nous avons besoin pour déchiffrer un monde qui, sans de tels « phares » (pour emprunter la métaphore attalienne), pourrait paraître parfois bien obscur, bien illisible.