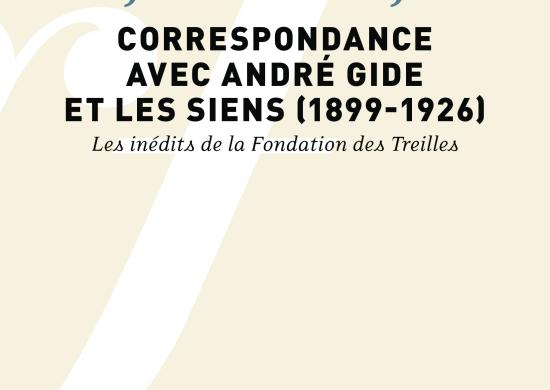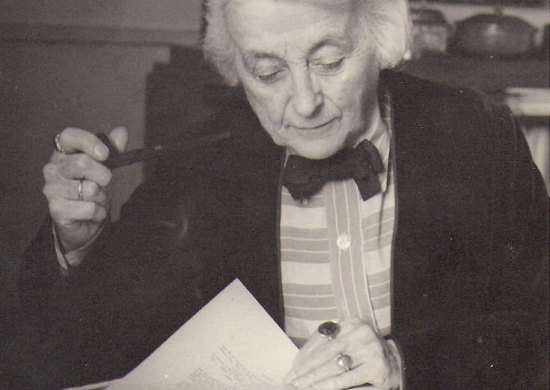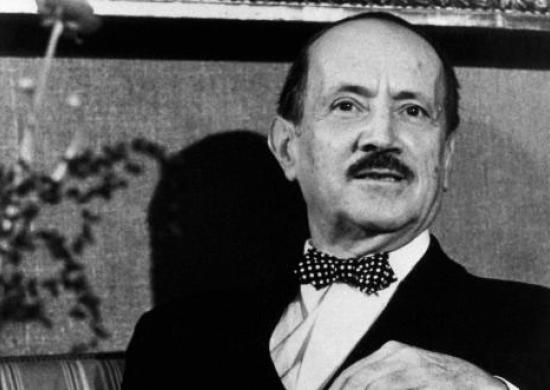Paola Codazzi publie, chez les Classiques Garnier, un ouvrage collectif consacré à la critique gidienne des années 50 et 60. Le volume se propose de réexaminer les mouvements d’idées d’une époque où l’écrivain continue de vivre à travers la parole des témoins, en même temps que son œuvre commence à être étudiée de manière rigoureuse par une première génération de chercheurs, en France comme à l’étranger. Les essais de Jean Delay, de Germaine Brée et de tant d’autres, au-delà de leur intérêt spécifique, reflètent l’esprit de leur temps et invitent à une réflexion sur le rôle de la critique et sur les rapports entre littérature et société.
Dans son ensemble, l’ouvrage vise à faire émerger un portrait aux multiples facettes, tant de Gide lui-même – l’écrivain et l’œuvre – que des travaux parus au lendemain de sa disparition. L’année 1951 représente un tournant dans la critique gidienne, comme le souligne Claude Martin : « Le soir du 19 février […] un autre Gide naissait : ou, plus exactement, une nouvelle façon de le lire. » La même idée est reprise par Michel Raimond dans l’anthologie Les Critiques de notre temps et Gide, dans laquelle il rassemble des extraits d’essais et d’articles publiés du vivant et après la mort de l’auteur. Il s’agit d’un petit livre, mais très instructif, puisqu’il nous montre aussi à quel moment cette première période se conclue et la critique emprunte une autre direction.
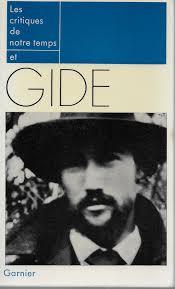
Un événement important est en effet survenu en novembre 1969 : le centième anniversaire de l’écrivain. Grâce à l’initiative de plusieurs personnes, dont Catherine Gide et Claude Martin, les études gidiennes ont alors franchi une nouvelle étape de leur histoire, avec la fondation de l’Association des Amis d’André Gide ainsi que la création du Bulletin. Grâce à d’importantes thèses universitaires, et à la mise au point d’index et bibliographies de ses écrits et des travaux qui les concernent, la recherche scientifique prend de l’élan et Gide s’impose comme un véritable sujet d’étude.
Ce qui frappe également en cette fin de décennie, c’est l’importance accrue de Gide au regard du grand public. Cela ne veut pas dire qu’avant il était ignoré, mais sa présence devient visible en dehors du cercle restreint des spécialistes et des lecteurs passionnés. Des timbres à son effigie sont mis en circulation par le ministère des Postes et des Télécommunications.
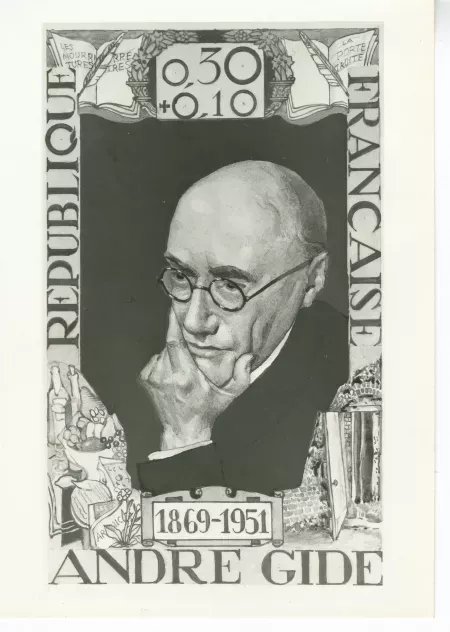
Nombreuses sont les expositions organisées à l’occasion du centenaire, en France, en Belgique, en Suisse et ailleurs. La télévision – moyen de communication que Gide n’a pas eu l’occasion de connaître, lui qui sans nul doute figure parmi les écrivains français les plus entendus, photographiés et interviewés de son temps – transmet le portrait-documentaire, en deux parties, de Roger Stéphane. Certes, les recensions ne sont pas très positives, et il faut dire que l’émission est reléguée à 22h10… Il reste qu’il s’agit d’un document précieux en ce qu’il fait le lien entre une certaine époque – le réalisateur, Jacques Demeure, décide de montrer des extraits du film de Marc Allégret et des entretiens à la radio avec Jean Amrouche – et le présent, grâce aux voix de Catherine Gide, Pierre Naville, Jean Delay, Claude Mauriac et Jean Vilar .
C’est bien à cette date que s’arrête la réflexion que nous proposons dans cet ouvrage, où sont réunies une vingtaine de contributions de spécialistes et jeunes chercheurs, français et étrangers. Ce sont des travaux qui s’articulent autour de questions théoriques et méthodologiques ainsi qu’autour de quelques figures d’importance (Jean Schlumberger, André Breton, Jules Romains, Pierre Herbart). Le volume contient également des articles qui portent plus généralement sur l’accueil de Gide en dehors des frontières de sa patrie, avec une attention particulière pour l’Allemagne, l’Angleterre, les États-Unis et l’Italie. Le focus principal de la réflexion est représenté par les essais et témoignages parus en volume au cours des deux décennies étudiées, mais des incursions dans le domaine de la presse et des revues spécialisées permettent d’ouvrir des nouvelles perspectives.
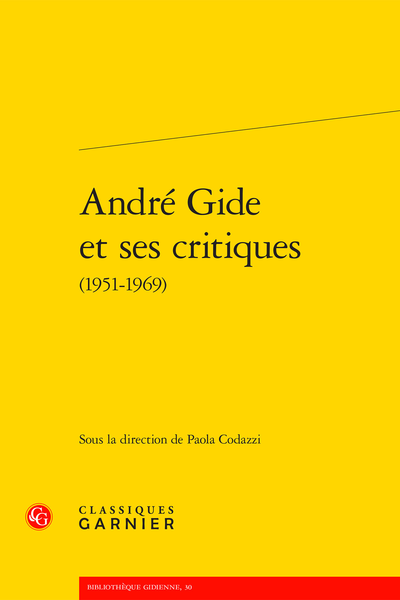
« Être futur », tel était le vœu de Gide, qu’il faut considérer en parallèle avec le désir toujours affirmé de s’adresser « à plusieurs pays à la fois ». Parcourant le volume, il nous semble qu’il a effectivement atteint son but. Dans le prolongement du travail de Raimond, nous espérons que cet ouvrage contribuera, bien que de manière modeste, à un regain d’intérêt pour la « chose » critique. Rendre hommage à Gide et à ses commentateurs, c’est aussi s’interroger – en tant que critiques de notre temps – sur les frontières vers lesquelles on s’achemine.