
Beyrouth, la nuit
J’avance à tâtons. Les avenues pas plus que les ruelles ne sont éclairées ; seuls les phares des voitures donnent la possibilité menaçante d’y voir plus clair. Je traverse, comme un renard, furtif et incertain, ébloui par ce que l’électricité des batteries donne encore de lumière intermittente à la ville. Des lumières filantes, blanches ou rouges, dans des esprits de tôle. Je traverse, animale, face à ces rangées de carcasses bruyantes dont l’âme s’exprime par klaxons. Une langue parfois aussi précise que celles des oiseaux – c’est ma file, à moi de passer, je double, à ton tour, non, oui, à toi, à moi, avance, recule, je suis là, moi aussi (tut, tut tut, tut tut tut, tuuuut, tut – du morse). Comme dans tout ballet, il y a une chorégraphie, un certain ordre qui mélange l’improvisation et la connaissance parfaite des mécanismes, qui confère à l’ensemble une sensation de fluidité. Les phares font danser sur les murs mon ombre bipède avec celles des hérissons anti-chars. Je devine le visage des militaires assis dans leur boite de béton à la lumière bleue de leur smartphone, mais à vrai dire voir ne compte plus vraiment. Sentir, écouter, ont pris le relais. Au cœur d’une capitale privée de feux de signalisation et d’éclairage public, je fais l’expérience de mon animalité.
Maintenant, j’avance par ruées, le pas plus sûr, d’un morceau de trottoir à ce qu’il reste d’un autre, l’habitude du noir se prend vite. Et c’est ici que se produisent de nouvelles rencontres, auditives, olfactives. À la nuit tombée, au lieu des groins des sangliers venus fouiller la terre en tribu, faisant remonter avant la rosée l’odeur du sous-bois, ce sont des enfants qui habitent le ventre sombre et pestilentiel des poubelles, leur font cracher capsules et papiers. Aucune voix. Seulement des froissements, des tintements, et l’agilité qu’il faut pour déplonger d’un bac ; ce sont des rongeurs ailés ; des ombres plus claires dans la nuit noire ; des Syriens, me dira C. Ces enfants n’ont rien. Absolument rien. Pas même un pays. J’ai tout à apprendre de Beyrouth.
Je viens de quitter S., auteure de Noir Liban1. Chez elle, pas de générateur, donc pas d’électricité du tout. « J’avais fait installer un boitier, mais il a disparu à mon retour. Je pense qu’il est chez mes voisins, mais je ne le réclame pas. Ils en ont plus besoin que moi. » Petit à petit, le soleil descend l’escalier du monde, vers la nuit, le noir Liban, pour aller briller ailleurs. Je distingue de plus en plus difficilement les traits de son visage, la couleur de sa tunique, qui me paraissait quelques minutes plus tôt encore si bleue. Plus d’Université américaine, plus de rectangle de mer, plus de têtes de palmiers, plus de fenêtres, plus de table, plus de livres, plus de tasse de thé, plus de S., plus même mes propres pieds. La lumière perd progressivement son appétit des formes pour entrer dans le grand jeûne des couleurs. « C’est la dernière pièce, au fond. » Je marche derrière mon téléphone jusqu’aux toilettes comme dans ma vie, le posant en équilibre sur l’évier pour voir où je pose mes fesses, tout en pensant que cette heure rend absurde les miroirs et plus vives les ombres, et que de dehors, les appartements doivent donner l’impression d’être cambriolés. À mon retour, S. a allumé deux bougies. On dirait que ce n’est plus la même année, à Beyrouth. Le corps se fait assez bien à ces changements : il réduit sa fréquence cardiaque, chaque mot se pose sur l’autre avec plus de poids et de douceur, par flocons. Alors que S. me raconte la diaspora libanaise en Côte d’Ivoire, les lieux de passage entre les religions, l’amour et ses fractures, la guerre collective et la paix individuelle, je me dis qu’il existe un lien mystérieux entre deux femmes qui parlent dans le noir, à la lumière de deux flammes, qui fait des mots des cordées au-dessus de la vallée des temps.
Maintenant, j’écris depuis une autre nuit, électrique. Ici tout est néons. Parfois, ça coupe, et alors il y a une interruption millimétrée des voix, une fraction de seconde se fait connaitre dans le silence, suivie d’une clameur, d’un hérissement du groupe dans les fractions suivantes, jusqu’à ce qu’on retire à nouveau le voile qu’on a lancé sur la cage, et que les sifflements des rires et des histoires reprennent parfaitement droits et homogènes, c’est-à-dire parfaitement tordus par l’alcool et l’excitation d’être ensemble. Je lève les yeux et je le vois, qui attend au seuil de l’immeuble, comme ici tant de chats.

Beyrouth, le jour
Au lever du jour, la ville se révèle dans ses teintes, ocres, douces, et prépare déjà aux contradictions. Paisible, tout y indique la guerre, barbelés, enceintes, trous d’obus, traces de tirs, présence militaire, ruines et amoncellement de ruines, comme des corps couchés les uns sur les autres, une vision de la mort qui ne veut pas passer. Il y a une esthétique du malheur : les cotonnades de béton rêches, enfilées comme des perles à un collier aux fers tordus qui servaient à l’armer, pourraient être directement transportées de la rue au musée. Les humains prennent des cafés, hommes et femmes en mélange, tout type de chevelures et de regards confondus, ce vieux monsieur encense des images sous plastique, scotchées à un arbre, en gardant contre ses lèvres des mots que je ne comprends pas et qui suivent le chemin de la fumée, c’est la queue devant les banques, les enfants des rues ne sont plus dans les poubelles mais à côté : certains négocient avec les attablés un billet, un bout de pain, ou s’amusent simplement à fuir et à rencontrer, comme ces chats encore, qui semblent avoir pris le cœur de la ville, allaitant, courant, jouant, se battant, dormant et s’étalant, prenant naturellement place sur les genoux élus, miaulant aux portes ; d’autres sont assis, duo de crânes ébènes, au pieds des containers, excités d’avoir déniché un magazine militaire, pointant de leurs petits doigts déjà râpeux et toujours sales des images d’avions de chasse. Ils décollent ; la piste est de papier glacé. Derrière eux, le mur d’une école sur lequel on a peint une maîtresse avec sa classe, disant en français qu’il faut respecter la religion de chacun. Dans ce quartier chaque heure est différente mais revient identique le jour suivant. L’enfant pioche et triture la nuit, erre et court le jour, tend des roses assoiffées contre des billets qui ne valent plus rien2, aux couples, aux amis, à la jeunesse beyrouthine en apparence insouciante, le soir. Immédiatement, Beyrouth parle de ce qu’il reste, de ce qui a tenu et résisté, de ceux qui sont restés, de ce qui est mort à tout jamais et de ce qui a réussi à naître des décombres. Aux doigts des kapokiers aux troncs hérissés de crocs, les fleurs continuent d’éclore, éclatant littéralement à la gueule de tous les soucis, imposant sur fond d’avenue terne et polluée le rose le plus intense, le blanc le plus subtil. La fleur plus que tout autre chose fait sa loi.

Beyrouth, les survivants
Survivors of the 4th of august, indique sur un tableau noir, à la craie, une pancarte dans le premier bar ayant réouvert après l’explosion du port le 4 août 2020. Joyeux lurons, on se prend en photo là-dessous. C’est une phrase-talisman, qui rappelle que la vie comme la mort sont des refrains. J’admire Beyrouth, de toute ma naïveté, quand bien même son portrait donnerait l’image d’un pays rachitique, ondulant sous les pressions et s’effondrant avec les abandons, des traits éboulés, flous comme l’anxiété, précis comme des trous, plaies béantes, os brisés. Oui mais un corps encore, un corps malgré tout, malgré les rues qui n’existent plus, malgré le cratère, les amputations, un corps à la Egon Schiele qui expose la beauté singulière de son nu, un corps chaud comme une personne qui réclame une attention particulière et fait revenir à mon oreille la phrase de F. sur un tout autre sujet, alors que nous marchons au milieu des ruines de l’une des plus anciennes cités du Liban3 : « Au Brésil, l’arrivée d’un enfant porteur de handicap dans une famille n’est pas un malheur, ils pensent que c’est l’enfant qui choisit le parent et non l’inverse, et que le père et la mère qui accueillent cet enfant spécial, spécial au sens d’extra-ordinaire, ont été élus parce qu’ils sont capables de porter cette différence. »
Beyrouth est un ancêtre qui force le respect. Rien n’y reluit, sauf les carrosseries des voitures de luxe dans les quartiers ayant rétréci au lavage de la catastrophe. Dans le centre vide de Beyrouth, où les rideaux de fer des anciens souks ont été soufflés par l’explosion, bombant désormais leur ventre vers l’intérieur, la seule enseigne « Hermès » me semble un scandale. Beyrouth n’est pas une ode à la jeunesse et à la nouveauté que clament certaines villes du Moyen-Orient, elle n’use d’aucun leurre. Tout a vieilli, des canalisations aux façades. Tout peut y paraitre sale, sauf les cafés et les cuisines dont arrivent toute sorte de plats merveilleux, honorant le plus petit brin de salade. On sent que ce n’est pas la façon d’y vivre qui a précipité le pays dans l’inquiétude et l’insalubrité, mais la politique soliloquant avec la finance, que ce n’est pas d’un savoir vivre que souffre le Liban mais d’un savoir penser de ses dirigeants. Beyrouth est un exemple. « Je ne suis pas d’accord avec ce que disent certains », me dit la jeune S., 20 ans, le regard en feu. « Que le Liban est une erreur. Que ce pays n’aurait jamais dû exister. Je pense tout le contraire. Le Liban ne serait pas sans la pluralité qui le constitue. Il est unique. Je ne me sens même pas Arabe, nous sommes autre chose encore que des Arabes… Je parle français, libanais, arabe, espagnol, j’apprends l’allemand, mon frère qui est Libanais ne comprends pas bien l’arabe, et lui qui pensait se sentir plus proche des Français vient de découvrir en arrivant à Paris qu’eux non plus ne sont pas comme lui. » S. et son frère sont le résultat de deux êtres s’aimant, mais aussi celui de ce que ce pays est capable d’engendrer, sur fond d’une guerre interminable et d’un chaos constant : la beauté et l’espoir, la réconciliation des contraires, le rêve en marche. « Je pars poursuivre mes études en France, mais je reviendrai ici. » Dans la voiture, son père me disait s’inquiéter de ce que ses enfants ne reviendraient plus une fois partis4. Est-ce qu’un effet de surprise pourrait sauver le pays ? Dernier ressort d’une boite usée – un trésor.
Les Libanais, entre cette mer qui rejette à leur corniche les déchets, et cette Montagne par laquelle leur arrivent les réfugiés, doivent compter sur des forces uniques pour sans cesse réinventer leur pays. Que de tant de clivages religieux soit déjà né un pays relève du miracle. Il faut se plonger dans son histoire complexe pour comprendre ; la géographie même de la ville, en apparence plus simple, répartissant de part et d’autre de la rue de Damas chrétiens et musulmans, donne une idée pour le visiteur de la façon dont les choses fonctionnent, dont elles peuvent fonctionner, dans une constante réévaluation des liens, des rapports, des besoins, discussions et négociations avec l’Autre mais aussi avec soi-même, comme appellent tant de diplomates du Vivant à le faire aujourd’hui avec le monde dans son ensemble : les rivières et les montagnes, les animaux et les végétaux... En un sens, ce que me raconte C. au sujet de son pays alors qu’il coupe le moteur de son véhicule devant les silos effondrés du port, n’a aujourd’hui de frontière que les limites de notre planète : « Non, je n’ai pas la sensation que nous ayons touché le fond et soyons prêts à remonter à la surface, je pense que nous avons traversé le fond, que nous avons été plus loin que le fond, que nous sommes entrés dans une zone inconnue, de laquelle aucun retour n’est possible, mais où tout reste à faire. »
De l’irresponsabilité précisément des élites politiques est née la responsabilité des élites intellectuelles – la voix des sans-voix.

Beyrouth, la culture
Avant de me retrouver ici, je ne savais rien du Liban, ou presque : comme trop de Français de ma génération, Beyrouth se remet à exister pour moi sur une carte au moment où elle explose, le 4 août 2020… Dans son journal, Beyrouth 2020, Charif Majdalani note : « Le hasard a quelque chose de romanesque, voire de tragique. C’est il y a cent ans exactement, en 1920, que l’État libanais a été fondé, et on ne peut que rester rêveur devant l’ironie du sort qui fait advenir la ruine d’un pays à la date même de sa naissance, et au moment même où l’on s’apprête à en célébrer le centenaire. Jusqu’où remonter sur ces cent années, dans la généalogie du désastre ? » Comment se fait-il que je n’aie aucune idée de cette généalogie, moi qui suis depuis tant d’années penchée sur les archives d’un écrivain français ayant prononcé ici même une de ses conférences les plus célèbres, dont les premiers mots étaient les suivants :
De me trouver parmi vous, Libanais, d’où vient que mon émotion soit si vive ? C’est que je sens, de toutes parts, ici, combien le Liban participe à notre culture. Et rien de plus naturel, car notre culture a pris élan sur votre passé. Et, comme il advient dans cette sorte d’échanges mystiques, l’on ne distingue dès lors plus bien ce que la France doit au Liban ou ce que le Liban doit à la France.
Je me sens terriblement idiote : je n’en ai aucune idée, aucune idée de ce que ces pays « se doivent ». Je ne sais même pas que le Liban, dans sa forme actuelle, est issu de la chute de l’Empire Ottoman et d’un accord avec la France, qu’il rassemble dès lors populations maronites, musulmanes sunnites et chiites, alaouites et druzes sous un même drapeau. Je ne sais pas non plus à quel point Beyrouth a compté dans la grande histoire du papier, des journaux, de la littérature. Je suis terriblement Française aussi, c’est-à-dire dans une relation au monde trop souvent unilatérale. Tandis que tous les Libanais que je rencontre parlent indifféremment l’arabe et le français, je ne sais pas un mot d’arabe, cette langue qui pourtant, à l’entendre circuler entre les passants, dans les postes de radio puis dans les casques fournis dans les lieux d’exposition, me parait un fleuve quand elle s’emporte, une rivière qui rencontre des pierres quand elle s’écoule lentement, les mots se séparant autour de ponctuations invisibles et se retrouvant pour former la longue phrase ininterrompue d’un lit commun.

À celle que l’on surnomme « la Maison jaune », emblème de la guerre civile transformée en lieu d’art et de mémoire, j’écoute en arabe et je lis en anglais le cours de Rawane Nassif suivre la vie des balcons à mesure que sont diffusées des plans fixes sur ce qui se cache ou se montre derrière les gigantesques rideaux qui s’accrochent aux immeubles. Je traduis : « Même ma position géographique dans la ville était du balcon. Mon rapport à la ville est vertical. Je vois la vie du 8e étage. Il n’y avait pas beaucoup de grands immeubles, alors je pouvais voir la ville, la montagne, et la mer. Avec le temps, notre bâtiment a rétréci et j’ai commencé à voir les balcons, les toits, et les voisins vivants les uns au-dessus des autres. Mais quand je suis retournée chez moi, je me suis rappelée à quel point le 8e étage est haut, quand il faut monter par les escaliers… Et j’ai imaginé qu’à mon retour, une charge de souvenirs me tomberait dessus, mais à l’inverse, je me suis mise à m’ennuyer. Et je suis entrée dans un état d’attente prolongé. J’attends, et je ne sais pas ce que j’attends. J’attends la machine à laver, j’attends l’ascenseur, j’attends le générateur, j’attends que le mois s’achève pour aller retirer de l’argent à la banque, j’attends que l’eau bouille, j’attends des choses sans importance et quand elles arrivent, je ne me réjouis pas. Des choses inutiles autour desquelles ma vie est programmée. Fumer une cigarette au balcon, comme mon père. Regarder la rue et attendre que quelque chose se passe. N’importe quoi. » Mais elle ajoute qu’elle aime ce balcon, parce qu’elle y est à la fois « à la maison et pas à la maison ». Ce qui fait écho à ce que Charif Majdalani disait de son lieu de prédilection la veille : que sa terrasse, longue et fine, située au 3e étage, était idéale, parce qu’elle n’était ni trop haute, ni trop basse, lui permettant d’être à la fois chez lui et en dehors, « d’entendre la rue », de faire remonter sous ses pages durant le jour la vie beyrouthine, le son des gamins portant sur leur dos des hottes de déchets, en bandes étrangement organisées, la nuit. Le balcon, pour cette réalisatrice et cet écrivain, est un point de convergence entre le dedans et le dehors, avec lequel ils finissent par se fondre. Mais l’écrivain n’est pas tant la terrasse de laquelle il écrit que, comme le dit Michaël Ferrier penché sur le journal de Charif Majdalani – « la brise tiède qui souffle avec conviction5 » (sur la terrasse comme sur la rue).
À parcourir Beyrouth, de ses avenues arborées à ses décharges, de ses intérieurs somptueux ou fatigués à ses sous-sols regorgeant de merveilles, comme cette collection de sarcophages anthropoïdes face auxquels on sent, étrangement, vibrer la puissance de vie des morts, ou celle de ces roches précieuses qui enseignent la puissance infinie de la créativité, ou encore celle de ces fossiles qui sont des tableaux du Vivant aussi impressionnants dans la beauté de leurs lignes que les lavis chinois6, je ne peux que comprendre pourquoi il faut empêcher les liens de se défaire, entre les hommes, les langues, les cultures, les pays, je ne peux que comprendre pourquoi des Français et des Libanais se battent pour que perdurent ces liens, notamment à travers, et c’est ce qui m’a conduite ici, le festival du livre de Beyrouth.


Beyrouth, le monde
Regarder le monde depuis le Liban. Il me semble que c’est ce que Beyrouth invite à faire. Chercher des solutions précises, en se penchant sur des problèmes communs. Charif Majdalani a imaginé la rencontre, à travers la Maison des écrivains de Beyrouth et avec le soutien de l’Institut français du Liban, entre des écrivains ayant pensé, de leurs pays de résidence ou d’origine, « la catastrophe ». Tsunamis, tremblements de terre, explosions, dictatures, crises économiques : la catastrophe peut être naturelle, l’erreur est toujours humaine. Erreur dans l’évaluation des problèmes, dans les réponses absurdes données aux forces telluriques et nucléaires, dans l’éclatement au grand jour de toute l’incompétence pour laquelle Beyrouth a payé le prix fort, incalculable, le prix sans prix, des vies et de la perpétuation du traumatisme. Peu importe le pays : ce sont nos façons de prévenir et nos façons de réparer ce qui nous arrive7 qui provoquent ou empêchent d’éviter les catastrophes. Il y a dans toutes ces situations la présence de cercles vicieux. Cercles auquel la jeune S. elle-même me dit ne pas pouvoir échapper, dans cette échelle minuscule qu’est celle d’une discussion aux chandelles d’un restaurant dans lequel nous venons d’accoster comme sur une île édénique au cœur d’un centre-ville submergé : « On ne peut pas ne pas utiliser ses privilèges dans un système défaillant. Plus de trois heures d’attente à la pompe, tu hésites entre attendre et utiliser une carte qui te permet de passer avant tout le monde, tu l’utilises, tu ne vas pas attendre trois heures avec les autres, mais si un ami est là tu le fais monter avec toi, tu fais profiter d’autres personne de cette carte… » Comment agir dans un monde corrompu ? Comment ne pas utiliser soi-même les rouages des privilèges ? Quels sont les refus utiles et ceux qui ne conduisent à rien ? « On vient échanger et boire des verres, une centaine de personnes vont marcher aujourd’hui dans Beyrouth, alors qu’on est dans le pire septennat que le Liban n’ait jamais connu », dit C., alors que le festival Beyrouth Livres bat son plein, derrière les hauts murs de l’ambassade de France comme dans divers lieux publics de la ville et du pays, apportant à la fois soulagement et questions. Ch. m’interroge : pourquoi est-ce que je compare le film Triangle of sadness8 à la soirée que nous passons à l’Albergo, hôtel de luxe proposant sur son toit une piscine tandis que l’eau courante ne circule plus nulle part en ville et que nos verres et nos assiettes ne cessent d’être remplis par le personnel surattentif du restaurant, alors que nos soifs et nos faims depuis longtemps sont étanchées et rassasiées ? Je réaliserai plus tard que ces réserves de charmes sont sans doute ce qui permet de tenir, et de maintenir en lien et en vie ceux qui sont encore capables de se charger de ce pays, ceux qui ont tout à la fois le courage et la chance de l’habiter, d’en faire partie et d’y rassembler. Beyrouth demeure par bouffées, vit par poches. « Cela fait trois ans que je n’avais pas ressenti ça, on revit ! », lance N., alors que nous passons d’un bar à l’autre. À table, je lui demande si elle prend de la salade : « Non, merci, je préfère éviter le choléra. » Je lui demande si elle est sérieuse. « Oui, l’épidémie se propage. » Je lui dis que je suis un peu comme une vache devant un pré, que je peux difficilement m’empêcher de goûter à tout ce qui est vert… « Oh, et puis mince, tu as raison, passe-moi le plat. On rincera avec de l’Arak. » Nous ruminons. Nous buvons. Trois ans depuis la dernière manifestation littéraire. Les bouffées devraient se transformer en souffle.

L’accueil des intervenants de Beyrouth Livres est parfaitement orchestré, la programmation est une réussite, je suis impressionnée par la qualité des manifestations qui permettent aux Libanais et aux Français de partager un repas, une danse, une pièce de théâtre, de mener ensemble une réflexion. J’en garderai de nombreux souvenirs, à commencer par celui de tant de mains d’enfants levées à la fin de la projection du film de Michel Ocelot, Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse qui, on ne peut plus énergiques, demandaient à tout savoir non pas des jolis personnages mais de la façon de réaliser un film, des inspirations et des choix de leur auteur, bref de ce qu’est un élan et ses réponses concrètes. Les enfants veulent comprendre. Les politiques à la tête du pays n’ont quant à eux levé aucune main à l’occasion de ces rencontres. Il n’est jamais bon signe que le « pouvoir » tourne le dos à la culture. En 1946, c’est le président de la République libanaise lui-même, Béchara el-Khoury, qui recevait André Gide à Beyrouth.
Qu’est-ce qui a changé ? Impossible à mon niveau de répondre à cette question, mais de l’angle qui a été le mien avant d’arriver à Beyrouth, c’est-à-dire une plongée dans ce que les archives Gide avaient à me dire du Liban9, je peux simplement dire que le rôle de la littérature demeure le même. Le livre est un pont, comme le montre bien Ce qui nous arrive en réunissant dans un même objet le Japon, le Liban, la Grèce et Haïti. La force de ce livre est aussi de porter un décentrement, magnifiquement illustré par Camille Ammoun et l’« objective minéralité » de son narrateur : le silo.


Aux cinq écrivains ayant été invités à parler de la catastrophe en ses différents lieux (Camille Ammoun, Michaël Ferrier, Makenzy Orcel, Ersi Sotiropoulos, Fawzi Zebian), Charif Majdalani demande, en guise de clôture du festival : « Et dans tout ça, quel espoir ? » Si à cet instant précis, qui arrive après tout ça, après avoir parlé des morts sans corps parce qu’étant les évaporés de la dictature, des morts sans corps parce que déchiquetés dans l’explosion d’un hangar de stockage, des morts sans corps parce qu’avalés par un tsunami ou pulvérisés par un accident nucléaire, des morts avant la mort de nos sociétés en crise, de tous les morts pour lesquels personne ne veut se porter responsable, si à cet instant précis un silence se dépose sur scène comme dans la salle, laissant l’espoir en suspens, c’est peut-être pour laisser parler quelques minutes les fantômes auxquels chacun de ces auteurs rendent un corps, digne et unique, c’est peut-être aussi parce que le livre que ces auteurs ont écrit à la fois ensemble et séparément constitue la plus belle réponse à ce que peut la littérature en temps de catastrophe, c’est-à-dire à chaque instant, c’est peut-être enfin parce que l’inquiétude joue une partie serrée avec l’espoir.
Il y a 76 ans, un jeune étudiant de Bagdad écrivait déjà à André Gide : « En ces temps d’angoisse et de détresse, qui n’ont fait que commencer, accepter l’espoir ce serait déchoir, car même si nous devons voir des jours meilleurs de notre vivant, ce n’est sûrement pas en nous contentant d’espérer que nous les trouverons. Non, il ne faut pas avoir espoir, mais rester perpétuellement inquiets. » Je ne peux m’empêcher de penser que ces écrivains inscrivent leur travail, d’abord individuel, puis nécessairement collectif, dans la continuité de la réponse qu’André Gide donnait alors à Beyrouth à l’inquiétude de ce lecteur : « Le monde sera ce que vous le ferez. »


> Lire la conférence complète donnée par André Gide en 1946 à Beyrouth (particulièrement intéressante en réponse aux questions posées par ces rencontres à partir de la seconde partie, "Puis la guerre est venue. Une guerre énorme, apocalyptique, et qui mettait en jeu, en péril, tout ce qui nous tient le plus à cœur : la dignité même de l’homme et ce qui fait notre raison de vivre. Sur des bases nouvelles, il faut reprendre, recommencer tout cela. Je dis : sur des bases nouvelles – car j’ai la conviction que nous ne pouvons trouver le salut dans un simple retour et rattachement au passé. Tout doit être remis en question...")
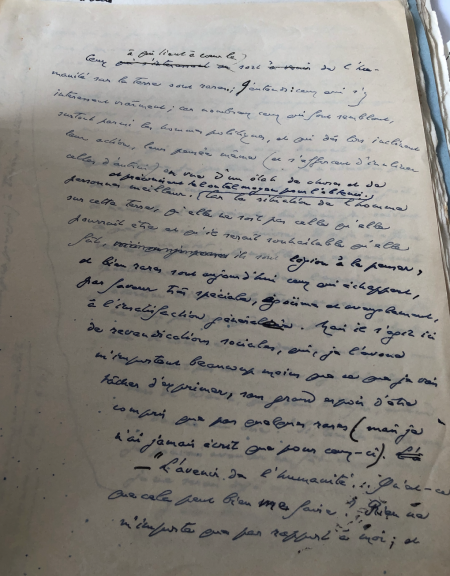
[1] Salma Kojok, Noir Liban, Paris, Erick Bonnier, 2022. Son récit traite du racisme, à travers l’histoire d’une enfant née en Côte d’Ivoire se retrouvant livrée à elle-même au Liban.
[2] « Il existe 4 taux de change en ce moment… Le taux officiel est de 1$ pour 1600 livres, mais dans les commerces on pratique 1$ pour 40000 livres. Ne retirez pas d’argent et ne payez pas avec la carte » est l’avertissement que nous recevons en arrivant à Beyrouth.
[3] Byblos, à 40 km au nord de Beyrouth, âgée de 8000 ans, témoigne des origines de la civilisation phénicienne. Le musée National de Beyrouth abrite les objets qui ont été trouvés sur son site : une merveille.
[4] Il me dit plus exactement : « Il y a trois sortes de violences subies par la crise : il y a ceux qui ont été touchés physiquement par l’explosion, il y a ceux qui ont été touchés dans leur vie quotidienne, c’est-à-dire que, réellement, leur salaire a été dévalorisé et qu’ils n’avaient pas d’autre apport, et il y a ceux, et ça c’est la majorité, dont nous, qui sont violemment touchés psychologiquement. Tu as vécu, tu as construit, tu as voulu un pays pour tes enfants, pour toi, et il n’y a plus rien. Le plus dur c’est que tu sais que tes enfants ne vivront pas dans ce pays. »
[5] Le passage est retranscrit avec justesse par la journaliste Lena Bopp dans son article « Eine Brise mit Überzeugung ». Elle rapporte l’échange ayant eu lieu entre Charif Majdalani, Michaël Ferrier et Salma Kojok dans la crypte de l’université le 28 octobre 2022, « Fukushima-Beyrouth : écrire le désastre au jour le jour » : « Comment écrire sur une catastrophe ? Que dit l’expérience personnelle du traumatisme collectif ? C’étaient ses [Salma Kojok] questions. Jusqu’à ce qu’en toute fin de soirée une personne du public demande ce que les écrivains peuvent faire face à de tels événements. Alors Michaël Ferrier a haussé les épaules, pris le livre de Majdalani, et l’a ouvert à l’une de ses dernières pages. Il a lu : “J’écris ces lignes assis sur la terrasse. Il fait très chaud mais une brise tiède s’est levée et souffle avec conviction.” Ferrier a fermé le livre et a dit : “je pense que nous, les écrivains, sommes comme cette brise.” » (Je traduis ; le texte dans sa version originale est en ligne : https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/literaturfestival-in-beirut-balsam-fuer-die-buecherszene-im-libanon-18435502.html.)
[6] Voir les collections du musée National et du musée des Minéraux de Beyrouth.
[7] Titre du passionnant ouvrage collectif ayant donné lieu à cette rencontre, publié aux Éditions Inculte, 2022.
[8] Palme d’or 2022, ce film de Ruben Östlund est une satire de nos sociétés capitalistes.
[9] Seront bientôt mises en ligne, à la page "Archives", toutes les lettres que Gide a reçues du Liban, ainsi que les coupures de presse relatant son passage à Beyrouth.


