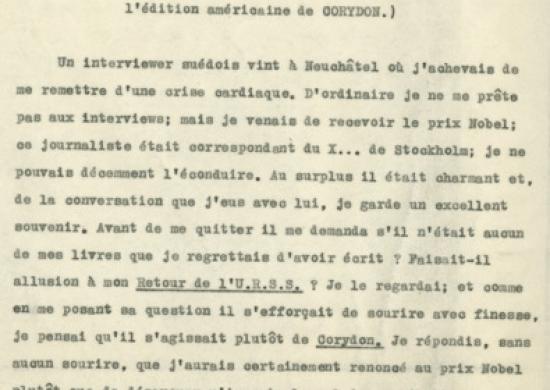Composée en 1902, Bethsabé (que Gide, contrairement à l’usage, orthographie sans –e final) peut être considérée comme un appendice à Saül. Même univers biblique, réapparition d’un même personnage, David, et semblable problématique psychologique et morale autour du désir, du pouvoir, de la transgression, et de la mort.
Cette courte pièce, I acte en trois scènes, en vers libres, eut un écho plus rapide que sa devancière. Les deux premières scènes furent publiées dans les numéros de janvier et février 1903 de L’Ermitage. L’intégrale parut ensuite dans Vers et Prose, de décembre 1908 à mars 1909.
Le texte complet fut publié en édition originale dans La Bibliothèque de l’Occident en 1912, puis, la même année, chez Gallimard, dans un volume collectif, intitulé Le Retour de l’enfant prodigue précédé de Cinq autres traités. Ce qui semble indiquer le genre dans lequel Gide rangeait son œuvre, plus proche du traité que du théâtre stricto sensu. La même édition fut reprise Au sans pareil en 1922.
En revanche, contrairement à Saül, Bethsabé ne fut jamais jouée du vivant de Gide.
La pièce est dédiée par l’auteur à « Madame Lucie Delarue-Mardrus ». Le « Madame » marque son respect. Et la dédicace, sans doute sa reconnaissance. Bien oubliée aujourd’hui, Lucie Delarue-Mardrus (1874-1945) fut une femme tout à fait exceptionnelle. Son œuvre est considérable. Poétesse, romancière, historienne, journaliste, grande voyageuse, dessinatrice, sculptrice, elle mena, quoique mariée (jusqu’en 1923), une vie extrêmement libre, affichant ses liaisons homosexuelles, notamment avec Natalie Barney ou Germaine de Castro. Elle s’essaya aussi à la critique littéraire. Ainsi, la première qu’elle signa, dans La Revue blanche du 15 juillet 1902, était-elle un « Essai sur L’Immoraliste », placé sous l’angle de la liberté de l’individu, et fort élogieux. Elle y écrivait, notamment : « Jamais, pensons-nous, même avec Candaule (Gide) ne nous a entraînés dans le drame de la complication et de la soif[1]. » L’Immoraliste, rappelons-le, venait de paraître au Mercure de France.
Retournant à la Bible et à Samuel (qui raconte l’épisode dans son Livre II, XI-XII), Gide s’empare de l’histoire de Bethsabé(e). Femme d’une très grande beauté, elle était l’épouse d’Urie, le héros des armées d’Israël. « Le plus vaillant de mes hommes », dit de lui David dans la pièce. Mais le roi ayant aperçu la jeune femme, nue, se baignant, il la désire, l’enlève et l’épouse, non sans avoir fait périr le mari, au grand scandale du prophète Nathan, ami d’Urie. Bethsabé(e) donnera quatre fils à David, dont Salomon.
Comme à son habitude, Gide ne raconte pas l’histoire dans son intégralité, ni avec exactitude. Il la réinterprète, et la centre autour des problématiques qui le taraudent, dans sa tentative de rendre compte du plus profond de la psychologie de ses personnages. Son David, successeur de Saül sur le trône d’Israël, est un homme vieillissant, qui a pour confident et exécuteur des basses œuvres Joab, son général en chef. Lequel se révèle dès la première scène jaloux d’Urie le Hétien (ou Hittite). Le roi, lui, redoute le prophète Nathan, dont le guerrier est proche. David, tout en invitant Urie à sa table en gage de sa reconnaissance, doute de lui-même et des autres, et se sent abandonné par Dieu. Dans une espèce de songe, il a vu et suivi un oiseau, lequel l’a conduit dans un jardin, tout proche des murailles du palais, où une femme d’une grande beauté se baignait nue dans une fontaine. Urie, par humilité, décline l’honneur royal, d’autant qu’il a encore à achever le siège de la cité de Rabba. C’est donc David qui se rendra chez lui, dîner en toute simplicité.
Le lendemain, David raconte sa soirée à Joab. Le repas s’est déroulé dans le petit jardin de ses hôtes. Bethsabé lui a servi du vin. « Tout rayonnait d’amour et du bonheur d’Urie », dit le roi. Après qu’il a raconté à Urie son rêve, celui-ci est parti combattre, laissant son épouse seule avec leur hôte. « Eh ! Roi David ! qui te retient ? Prends cette femme », l’interrompt Joab. « C’est ce que j’ai fait tout aussitôt », avoue-t-il. En proie à son désir, David s’empare de Bethsabé, l’emmène au palais, où il se comporte comme un despote, jaloux, non point de ce que l’autre possède, mais du fait même qu’il possède quelque chose : un modeste jardin, une épouse, alors que, souverain, il règne sur des palais, peut avoir toutes les femmes qu’il désire… Mais il se lasse vite de sa proie, et demande à Joab de raccompagner Bethsabé chez elle. La scène finale montre David condamné à l’insomnie, bourrelé de remords, seul face à sa conscience. Il voit Urie lui apparaître, comme un spectre, muet. Puis, Nathan qui lui raconte la parabole du riche envieux de l’unique brebis que possède le pauvre, et l’accable sous ses anathèmes. « Ton riche a mérité la mort », reconnaît David. Enfin, paraît Joab. Il a accompli la mission dont son maître l’avait chargé : Urie a été tué sous les murailles de Rabba, par traîtrise. Alors qu’il chargeait au premier rang, tous les autres soldats se sont enfuis. Derrière Joab, apparaît Bethsabé, dans ses voiles de deuil. « Va t’en ! Remporte-la ! Je t’ai dit que je ne veux plus la voir… » lance-t-il à son homme à tout faire. Comme si Bethsabé n’était qu’un objet. Avant de conclure sur cette phrase terrible : « Je la hais ! »
La pièce est dure, sa fin abrupte. À aucun moment Gide ne mentionne l’union de Bethsabé avec David, ce qu’on suppose être leur bonheur, leurs enfants. Il préfère terminer en pure tragédie sur le mépris, le caprice qui s’ajoutent à l’injustice, à la concupiscence, à l’envie, à la tyrannie, à la traîtrise et au crime… presque tous les péchés capitaux du christianisme. Tous les démons de Saül ne sont pas convoqués dans Bethsabé, pièce plus courte et plus sobre, mais ils sont bien présents dans l’esprit de l’écrivain, et à l’œuvre dans le cœur de son triste héros. Un de plus.
[1] Voir Bulletin des Amis d’André Gide (BAAG) n° 19.