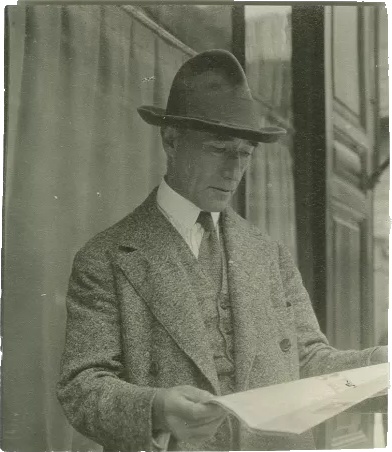Jean Lambert
L’appartement de la rue Vaneau vu par un témoin rapproché
On sait qu’il n’était pas un sédentaire. Où s’est-il arrêté plus de trois mois ? Aussi rien, rue Vaneau, n’indiquait-il la résidence organisée. Pour commencer, il n’avait pas de bureau. Je compte cinq, six tables où je l’ai vu écrire au cours d’une journée. Le goût de l’inconfort est un sentiment assez puissant pour transformer en rien de temps une pièce ou un appartement entier, et Gide possédait cet art d’une façon naturelle et active. Oui, il avait le don de transformer les lieux et les choses par une modification inattendue de leur emploi. D’une manière générale, il les préférait incongrus, incommodes, et il pouvait travailler n’importe où. C’est une grande force pour qui a l’esprit sans cesse occupé.
[…] J’ai connu d’abord l’appartement sans son maître. J’y vins en 1939, à mon retour de Berlin. Thomas campait alors dans ce qui avait été le studio de Marc Allégret, communiquant avec la bibliothèque par une double porte destinée a étouffer les bruits. Denis de Rougemont y avait précédé Thomas. Catherine [Gide] devait suivre, puis Albert Camus, avant qu’Élisabeth et Pierre Herbart ne fissent du studio leur pied-à-terre parisien. Je devais y revoir Thomas en 42. C’est peu après qu’on m’offrit d’occuper, au même étage, mais de l’autre côté de la cour, l’appartement de Mme Van Rysselberghe.
[…] J’en finis avec le studio. Il était suffisamment haut pour qu’on ait pu accrocher au plafond un trapèze qui pendait au milieu de la pièce, et pour qu’une galerie l’encercle sur trois côtés, le quatrième étant formé par une énorme baie vitrée qui donnait sur la cour. Quand elle occupa le studio, Élisabeth Herbart utilisa, pour faire des rideaux, des mètres d’une toile assez rude, de couleur violine, qui avait servi pour la création de Saül au Vieux-Colombier, et qu’elle alla chercher dans la maison de Copeau, à Pernand-Vergelesse. Elle avait aussi transformé en cuisine le petit réduit, sur la galerie, que Marc utilisait pour développer ses films et ses photos. Au-dessus de la cheminée, conçue dans le style dénudé des Arts décoratifs, une longue glace, jumelle de celle qui ornait la cheminée de Gide, servait de fond à un cavalier de bronze dont je ne saurais préciser l’origine (chinois, selon les apparences). Chinois ou japonais, en tout cas, le lampion qui pendait au-dessus du divan, comme aussi, du moins d’inspiration, un tableau de tons bruns représentant une pipe d’opium. Je ne sais plus s’il y avait déjà, ou si elle fut apportée par Élisabeth, la chaise paillée très basse qui avait été celle de Toulouse-Lautrec.
Pour ajouter à l’aspect labyrinthique de l’appartement, je propose de retourner dans l’entrée. […] L’entrée était sombre, éclairée seulement par la lumière d’une porte vitrée ou d’une ampoule que réduisait à rien une lanterne en cuivre découpé, de provenance turque ou africaine, unique tentative du côté de l’éclairage, avec le lustre hollandais. Un grand coffre de bois sculpté, au couvercle tendu de tapisserie, disparaissait sous des journaux, des revues et des livres — ceux qu’on ne voulait pas garder. Au mur, et faisant face à une grande peinture de Simon Bussy représentant un coq aux couleurs glorieuses, un long porte-manteau exposait toute une série de capes et de chapeaux dont les formes insolites sont fameuses.
[…]
La pièce assez vaste et très claire où l’on pénétrait d’abord était séparée par une porte vitrée de la petite pièce où j’avais attendu le premier jour. Le plafond élevé épousait la pente du toit. La vue était belle sur les toits gris, la Tour Eiffel, le dôme des Invalides. Le balcon qui bordait ces deux pièces et se continuait sans coupure au long de l’appartement voisin, offrait une vue assez lointaine sur la rue et les cours de quelques vieux hôtels plantées de marronniers ou nichaient des chouettes. Cette pièce était tendue d’une matière dont je ne sais si elle était paille ou toile, mais que la poussière avait encrassée sans retour. Les meubles étaient ceux d’une salle à manger d’acajou que Theo Van Rysselberghe avait dessinée pour la maison d’Auteuil. L’ex-buffet servait de placard aux manuscrits — à ceux que Gide appelait les « manuscrits d’autrui » — et de réserve à tout un bric-à-brac de papeterie, tandis que les tiroirs abritaient encore une argenterie qui n’avait plus été nettoyée depuis vingt ans. Sur la table ronde s’entassaient les derniers livres reçus et les revues, avant qu’un tri ne les répartisse entre les rayons du couloir et le coffre des rebuts. Livres, journaux débordaient aussi sur les chaises. La secrétaire, quand il y en avait une, travaillait sur une table aux pieds vaguement gothiques. Les dossiers des affaires en cours étaient rangés dans un classeur américain.
Parmi les ornements : au-dessus du buffet, un des plus sombres Walter Sickert, représentant le pont du Rialto (dans l’entrée, outre le coq de Bussy, un autre Sickert, très grand : la façade de Saint-Marc) ; sous un rayonnage surmontant la table ronde, une série de pastels de Bussy : un gros lézard vert dont la queue, faute de place, avait été dessinée en deux morceaux, un crapaud, un poisson vert sombre aux taches d’or. Près de la fenêtre, sur une haute sellette, un de ces meubles qui figuraient obligatoirement dans tout intérieur français vers 1900, un buste de Gide, œuvre de la sculptrice allemande Renée Sintenis, œuvre à peine ébauchée au cours d’une visite a Berlin, mais vigoureuse, où l’on voyait la marque des doigts dans la glaise, était curieusement coiffé d’un chapeau de paille aux larges bords rapporté du Congo : Gide préférait ses bustes ornés, ou cachés. Un troisième, qu’il ne voulait plus voir, fait d’un plâtre jaunâtre, avait été sauvé plusieurs fois de la corbeille à papiers. Ç’aurait pu être le portrait d’un vieil Américain puritain de Boston. Il me doit son dernier sauvetage. J’ignore qui l’avait fait.
Passant devant Saint-Marc, qui surmontait, dans l’entrée, une console d’acajou faisant partie du même ensemble, on abordait le couloir long, étroit et sombre, qui menait vers la bibliothèque, mais débouchait sur la salle de bains. Trois pièces ouvraient sur ce couloir : la cuisine et les deux petites chambres qui formaient toute la partie privée de ce curieux appartement. Des rayons, installés assez haut sur les murs du couloir, abritaient les auteurs modernes, sans les préserver de la poussière grasse, noire et tenace qui décourageait toute curiosité. Quatre gravures ornaient ce passage, représentant quatre moments d’une danse espagnole. Je fus très amusé de retrouver les mêmes dans l’escalier de Jouhandeau.
[…]
Une des petites chambres avait dû lui [Madeleine Gide] être destinée. Elle ne l’occupa qu’une fois, quand elle vint à Paris pour se faire soigner. J’ai déjà parlé de cette chambre. Les meubles devaient lui en être familiers : le lit d’acajou aux formes lourdes, la commode où des bronzes manquaient, surtout le secrétaire d’Anna Schakleton, étaient des rescapés de plusieurs domiciles. Mais leur présence dans celui-ci, où elle était si peu chez elle, devait moins la rassurer qu’aviver son sentiment d’y être comme une étrangère, par le contraste des souvenirs. Comme ces meubles qu’on transporte avec soi de place en place, quelques changements qui se soient produits dans votre vie, et qui, venus eux-mêmes de lieux divers, s’intègrent à l’ensemble formant le fond de votre vie nouvelle, de combien d’éléments disparates cette vie nouvelle n’est-elle pas constituée ! Mais les disparates se fondent, au point qu’on ne les perçoit plus. Au lieu que la permanence des choses est un rappel continuel et des lieux ou elles furent, et de ce que nous avons été. Je ne crois pas que Gide fût du tout sensible à cette emprise. Il conservait les choses par indifférence, parce qu’elles étaient là. D’où, tout autour de lui, autant d’hétéroclite que dans sa propre vie, mais un hétéroclite qu’une pensée unique ne se souciait pas d’harmoniser.
[…]
Sur la tablette de marbre du secrétaire trônait une pendule assez laide, où une jeune créature aux traits exotiques se lamentait sur la fuite du temps.
Les rideaux de la fenêtre, comme ceux de la chambre voisine, étaient faits d’une grosse toile beige, avec des applications de galons plus clairs. Ils dataient, eux aussi, de bien plus loin que l’installation rue Vaneau, et avaient dû servir dans toute une série d’appartements. J’ai déjà dit qu’il y avait dans cette chambre le paravent décrit dans Si le grain ne meurt, que Paul Gide avait implacablement refoulé de son bureau dans le salon. Ses motifs japonais s’apparentaient à ceux d’un petit fauteuil bas de style Second Empire, dont la tapisserie représentait, au milieu de fleurs et d’oiseaux, un pont arqué au-dessus d’une rivière ; les noirs, les verts, les bleus — certains bleus éclatants qui auraient dû crier d’être en compagnie — s’accordaient au contraire et formaient un assez joli motif, que des taches rouges rehaussaient. Les deux lits, celui d’acajou et celui, en cuivre, de la chambre voisine, étaient recouverts du même tissu un peu rêche que les rideaux.
La chambre au lit de cuivre était celle de Gide. Elle n’aurait pu être moins plaisante, ni plus nue. Un papier grisâtre ne faisait rien pour l’égayer, ni le peu de lumière venant de la cour, ni, au mur, une reproduction en noir de l’Hiver de Breughel. Il y avait aussi une gravure japonaise représentant un vieux mendiant, ou un voyageur, au crâne dénudé, qui ressemblait d’ailleurs assez à Gide. D’autres gravures japonaises ornaient la chambre voisine, vestiges d’une vogue qui avait fleuri vers 1900.
Que la mémoire est infidèle ! Je ne trouve rien d’autre à dire sur cette chambre, où Gide devait mourir. C’est que j’ai peine à me la représenter sans lui ; et, lui présent, c’était partout des livres, des vêtements, des cravates sortant des tiroirs, la table de nuit surchargée de fioles, de tubes, de boîtes de pilules, car il a toujours aimé expérimenter.
On passait, de là, dans une étroite antichambre qui séparait le long couloir de la salle de bains. C’est là que se trouvaient les œuvres complètes de Jean-Sébastien Bach, aujourd’hui en la possession de François Valéry à qui Gide les a léguées. Au-dessus du meuble qui les contenait étaient rassemblés les livres consacrés à Gide ou dans lesquels son nom était cité. Ils se sont considérablement accrus depuis sa mort, sans que j’aie d’ailleurs réussi à en former une collection un peu complète. […] Sur ces rayons aussi étaient rangées les traductions de ses œuvres. Allemagne et Japon y tenaient une grande place ; la Russie également qui entreprit vers 1935 de publier les œuvres complètes, mais qui changea d’avis en 1936.
Ce passage était éclairé par la fenêtre de la salle de bains d’où l’on dominait la cour de l’Hôtel Matignon ; c’est pourquoi, lorsque je logeai là pendant l’occupation, je reçus la visite de policiers chargés de la sécurité de Laval.
[…]
Deux marches, enfin, donnaient accès à la bibliothèque. Et là, ma mémoire est plus fraîche, parce que nous [Jean Lambert et Catherine Gide, devenue son épouse] avions tenu à garder cet endroit tel quel, sauf que la peinture rougeâtre de certaines boiseries avait fait place à une teinte moins agressive, et que nous avions dû y loger deux enfants. C’était une très belle pièce, qui justifiait le choix d’un logement assez incommode par ailleurs.
Les armoires et les rayonnages, de chêne clair, avaient été dessinés par Auguste Perret. Tout ce qui n’était pas bois était livres. Le soleil du matin mettait une jolie lumière sur les reliures, et le silence incitait au travail, même lorsqu’il était troublé par la voix de Maria Férès, une des rares cantatrices capables de chanter le rôle de l’Orphée de Gluck, qui faisait ses exercices quelques étages plus bas. Deux fenêtres éclairaient cette bibliothèque ; l’une, très haute, donnait sur la cour, l’autre sur les jardins de Matignon. Devant la plus grande, une vaste et lourde table à l’italienne était en général encombrée de papiers ; ses dimensions autorisaient tous les désordres. Un autre grand meuble était le piano, un Steinway un peu plus clair que les boiseries, sur lequel je n’ai jamais entendu Gide jouer. On connaît ce piano par le film d’Allégret [Avec André Gide].
À gauche, quand on entrait, se trouvaient les classiques grecs, latins et français (ceux-ci dans l’édition des Grands Écrivains) qui avaient appartenu à Paul Gide et lui devaient leurs reliures. Gide lui-même n’eut jamais grand souci de faire relier ses livres, sinon la collection de la N.R.F., mais c’était plutôt pour la commodité. Tout le panneau qui faisait face était garni de vitrines. Là se trouvaient soit des éditions un peu rares, soit les Italiens, les Anglais et les Allemands. Sous les vitrines, la série des dictionnaires. Le plus utilisé de tous, le Littré, auquel on faisait appel jusqu’au milieu des repas, se trouvait sous une banquette assez dure où Gide se tenait volontiers, dans le recoin que formait un escalier. Celui-ci, qui avait son départ à droite de l’entrée, passait devant les Français du XVIe au XIXe siècle, ceux du XXe subissant le purgatoire poussiéreux du long couloir. Quelques volumes de Balzac au cuir racorni portaient les traces d’une inondation, venue de je ne sais plus où, qui fit que Gide nous réveilla un matin de l’hiver 46-47 pour annoncer que ses livres flottaient et me demander de venir à leur secours.
On arrivait ensuite sur la galerie, où se trouvaient encore des Anglais — dont Conrad, dans l’édition de ses œuvres complètes qu’il avait offerte à Gide — des Allemands et des Russes. Venaient ensuite ceux qui, dans sa jeunesse, étaient ses contemporains : Barrès, Bourget, Zola, France, Loti, et quelques-uns de ceux qui furent ses amis : Ghéon, Claudel, Jammes, Charles-Louis Philippe. Péguy aussi se trouvait là, avec ses œuvres complètes, un certain nombre de « Cahiers », et surtout un bel exemplaire de sa Jeanne d’Arc portant une longue dédicace aux lignes très espacées qui s’étirait sur plusieurs pages. On s’étonnait de certaines absences, et précisément parmi les amis. Un petit fascicule à couverture bleue, dans une des vitrines du bas, aurait pu expliquer ces absences, un fascicule ayant pour titre : Vente de la Bibliothèque de M. André Gide, et pour date 1922. Cette année-là, ayant fait le projet de partir pour le Congo, et se plaisant à imaginer que, peut-être, il n’en reviendrait pas, et qu’il avait besoin d’argent pour le voyage, Gide vendit tous les livres dédicacés d’écrivains qui avaient été ses amis, mais avec qui ses relations n’étaient plus tout à fait aussi cordiales. Elles ne s’améliorèrent pas. Mais voilà pourquoi certains noms ne figuraient plus, ou seulement en éditions courantes, parmi les livres de Gide, pourquoi il ne possédait plus une seule œuvre dédicacée de Claudel, quand il avait gardé jusqu’à la moindre plaquette de Valéry. On sait qu’un des auteurs exclus, Henri de Régnier, se vengea de façon élégante en envoyant à Gide son nouvel ouvrage avec, pour dédicace : A André Gide, pour sa prochaine vente.
Dans un coin de cette même galerie, d’où la vue était magnifique sur le parc de Matignon et un vaste paysage de toits du côté de Sèvres-Babylone, était rangée la correspondance ; elle était même bien rangée, grâce, en grande partie, aux soins de Maurice Saillet, qui servit un temps de secrétaire. C’est là aussi que se trouvait le petit lit de fer de couleur verte qui servit pendant le voyage au Congo, et sur lequel on devait exposer Gide après sa mort.
Aussi bien, tout le décor de la bibliothèque était-il plutôt africain. Des lances, des défenses d’ivoire, des masques se détachaient sur le fond sévère des boiseries ; la statuette d’une divinité africaine, un petit crocodile naturalisé, des anneaux d’ivoire, erraient de place en place. Il y avait aussi des ornements moins exotiques Un long bas-relief de Jean Goujon, représentant une nymphe couchée, occupait un grand panneau du côté des classiques. Au-dessus du piano était accroché un masque au nez fort, aux pommettes proéminentes, qu’on prenait pour celui de Pascal, mais qui était celui de Leopardi. Il y avait aussi un moulage de Goethe, fait sur le visage du poète vivant et très âgé, car la chair y paraissait flasque, au contraire du beau masque sec de l’Italien. Une photo de Chopin, le dessin de Severn représentant Keats sur son lit de mort, témoignaient assez bien des préférences de Gide en musique et en poésie. Des gravures flottantes : un petit palmier de Simon Bussy, dressé sur un ciel d’un bleu vif, une allégorie de Marie Laurencin avec, dans un coin, la tête bandée d’Apollinaire ; un portrait de Melanchton. Enfin, parmi d’autres objets épars, outre des pierres curieuses et des coquillages, deux œuvres de Simone Marye : un canard, que son poids retenait posé sur la grande table, et un poisson qui circulait à la surface du piano ; une statuette de bronze, cadeau de Jef Last, représentant un jeune garçon maigre ; un enfant de plâtre dodu ; et le sablier ancien qu’Adrienne Monnier avait donné à Gide et que celui-ci retournait ostensiblement lorsque son visiteur s’attardait trop.
Si je me suis moi-même attardé à cet inventaire de l’appartement vide, c’est que, pendant plusieurs mois, je l’ai connu ainsi. J’occupais, sur la recommandation de Jean Schlumberger, l’appartement voisin, en l’absence de Mme Van Rysselberghe, qui vivait alors à Nice et à Cabris. Il me suffisait de pousser la porte séparant les deux vestibules, et je me trouvais dans ce domaine encore plus mystérieux pour être inhabité.
[…]
Oui, les humains dérangent. Et certains par-delà leur mort, surtout lorsque leur souvenir est si vivant qu’ils semblent n’avoir pas quitté les lieux. Il me fallut des mois, en 1951, pour me persuader que ce grand vide, rue Vaneau, n’était pas simplement le fait d’un déplacement prolongé, mais une absence interminable. A de certains indices, on pouvait douter si Gide ne s’amusait pas encore à nous surprendre, par exemple quand à deux reprises les scellés apposés sur les portes de ses deux chambres furent brisés : on avait beau savoir que Gilbert la première fois, la fille de Béatrice Beck la seconde, avaient ouvert les portes par inadvertance, comment ne pas voir dans ces infractions et effractions le divertissement d’un esprit enfin libre de tout respect pour les défenses conventionnelles ? Et je crois que ce même esprit devait trouver encore plus de joie à contempler le prodigieux désordre de la bibliothèque durant cet été-là. Nous y avions transporté tout ce qui encombrait les pièces de la rue ; toujours à cause des scellés, la porte demeura fermée durant des mois ; l’été vint et nous trouva sans courage pour rien changer à cet amoncellement. Jamais, avec toute sa science du désordre, Gide n’aurait pu réussir une pareille juxtaposition d’objets aussi hétéroclites ; et la poussière qui, malgré les fenêtres fermées, les doubles portes, les rideaux, s’était déposée sur ces choses, piano, table, chaises gothiques, fauteuils Restauration, masques d’Afrique et masque de Léopardi, piles de livres, crocodile, et sablier qu’on ne retournait plus, comme si le temps s’était arrêté de couler un soir de février, la patiente poussière de Paris donnait à cette pièce l’air d’un décor pour la dernière scène des Grandes Espérances, sauf que la mort, non la déception amoureuse, avait tout abandonné dans cet état.
Puis, les scellés ôtés (légalement, cette fois, mais par un personnage que Dickens aurait aimé), et les peintres étant passés, la pièce retrouva son air paisible et confortable, assez pareille à ce qu’elle avait été pour qu’on s’attende à trouver Gide logé dans le recoin sous l’escalier, assis de biais sur la banquette dure qui servait de niche aux cinq volumes du Littré. Ou bien, il allait apparaître dans l’embrasure de la porte, tenant un livre dont son doigt marquait la page qu’il fallait qu’on goûte avec lui… Une autre des raisons pour lesquelles j’ai décrit l’appartement, et surtout la bibliothèque, avec un soin qu’on pourra trouver fastidieux, c’est qu’ils n’existent plus, tels qu’ils étaient, que dans le souvenir de ceux qui les ont habités, ou de ceux qui venaient voir Gide, ou de ceux qui, plus tard, ont encore eu la chance de les visiter. Aujourd’hui, pas plus que dans l’appartement qui ouvrait sur le Luxembourg, ou celui de la rue de Comailles, ou celui du boulevard Raspail, ou la villa d’Auteuil, l’ombre inquiète de Gide ne peut se retrouver chez elle rue Vaneau. Croyons que c’est une ombre incapable de regrets et qui, pas plus que le vivant qu’elle remplace, n’aime à se sentir installée nulle part.
Sur l'auteur :
Né le 31 décembre 1914, Jean Lambert effectue ses études secondaires au Collège Honoré de Balzac à Issoudun (Indre). Après quatre années de khâgne au Lycée Henri IV, et deux années d’études à l’Université de Berlin, de 1936 à 1938, il conclut une licence, suivie d’un Certificat d’études supérieures d’allemand. Du séjour allemand témoigne les Lettres d’une autre Allemagne [1937-1938], publié dans Fontaine et ensuite en plaquette (1953, 46 pp.).
Ses premières collaborations littéraires vont aux Cahiers du Sud — son premier texte publié : Les Nourritures célestes —, à Fontaine — Remarques sur l’œuvre de Jean Schlumberger —, et à La N.R.F. notamment.
Il épouse Catherine Gide en 1946. De 1951 à 1956, vie de famille dans l’appartement du 1 bis, rue Vaneau, qu’il décrira dans son Gide familier. Après son divorce, en 1956, il part pour les États-Unis, où il va passer plus de vingt ans, dont dix-sept à Smith College (Massachusetts), après divers séjours d’enseignement universitaire (Haverford College, San Diego State College) ; plusieurs tournées de conférences à travers les États-Unis.
Parmi ses publications : L’Art de la fugue (Gallimard, 1945), Les Vacances du cœur (composé de trois récits, Gallimard, 1951), Tobiolo (Gallimard, 1956), Gide familier (Julliard, 1958), Le Plaisir de voir (Gallimard, 1969), Histoire véritable (Fayard, 1979, 448 p.), ample roman, inspiré par son séjour américain. Revenu en France, il effectue de nombreuses traductions de l’allemand — Thomas Mann, Heinz von Cramer —, et de l’anglais — Patrick Shite, tous les romans de William Humphrey, les études historiques de Lesley Blanch, et son livre de souvenirs sur Romain Gary.
Il a tenu son Journal depuis l’époque du lycée. Toute la partie concernant sa vie dans l’entourage de Gide et ses amis pourrait faire l’objet d’une publication, ainsi que les pages du séjour en Amérique, dans les îles du Pacifique et en Australie, au Mexique et en Italie, — qu’il considère comme sa seconde patrie. Des fragments ont paru dans diverses revues. L’ensemble offre un tableau personnel de la vie littéraire française pendant près de cinquante ans.
Décédé à Paris le 6 août 1999, et inhumé dans le caveau familial à Souvigny-en-Sologne, le 10 août.
Consulter également l’In Memoriam paru dans le BAAG, n° 126-127, juillet 2000, pp. 215-232, présentant une bibliographie complète des œuvres de l’auteur (231-232).
Texte extrait de : Jean LAMBERT, Gide familier, Julliard, 1958, extraits du chap. III, pp. 48-65. Rééd. Presses Universitaires de Lyon en 2000.
Ce texte est la propriété intellectuelle de son auteur. La reproduction à des fins personnelles est autorisée. Toute citation doit être effectuée dans le respect de l’auteur et conformément au code de la propriété intellectuelle (mention du nom, du titre, de la référence bibliographique et de la page). À cette fin, la pagination de l’imprimé a été conservée dans la présente transcription, entre crochets droits, sur le modèle : [5] indiquant le début de la p. 5 dans l’édition originale.
Maurice Sachs
Gide, la taille haute, les épaules tombantes, le corps osseux, porte une tête depuis longtemps chauve à la peau sèche et tannée de paysan. Il est comme sculpté dans le bois sain d’un arbre rude. Ses yeux, qui tirent tantôt sur le gris, tantôt sur le bleu comme certaines ardoises, comme sous certain jour, les feuilles de peuplier, donnent un regard lucide, franc et perspicace. Ses lèvres, dont Wilde disait qu’elles “sont droites comme celles de quelqu’un qui n’a jamais menti”, coupent net le visage d’un trait plus réticent que voluptueux. Une mâchoire forte et carrée marque de volonté une figure qui n’est alourdie par aucune passion épaississante. Le visage de Gide nous présente la réunion réussie du paysan, de l’homme d’étude et de l’homme raffiné. Bref, celui d’un homme qui s’est donné la peine d’être ce meilleur homme qu’un homme puisse être, ce meilleur de soi qui est en chacun, mais que si peu d’entre nous réalisent.
Extrait de : Maurice Sachs, André Gide, Denoël et Steele, 1936, 124 p., p. 13-14.
David Steel
Gide à Cambridge, 1918
Un des regrets de ma vie […] c’est de ne pas avoir passé quelques années de ma jeunesse dans un collège d’Outre-Manche.
Ce beau pays que tu traverses, vas-tu le dédaigner, te refuser à ses blandices, à cause qu’elles te seront bientôt enlevées ? Plus rapide est la traversée, plus avide soit ton regard ; plus précipitée est ta fuite, plus subite soit ton étreinte ! 1
Tant dans sa vie que dans ses livres, Gide était un homme de voyages. Savourant également le « Mieux vaut être nomades imprudents que prudents sédentaires » de Keats et la boutade de Charles-Louis Philippe : « Les maladies sont les voyages des pauvres », il prisait l’expérience fictive ou réelle à la mesure de la mobilité qu’elle permettait 2. Dès sa jeunesse il s’était systématiquement immergé dans l’art, la pensée et la littérature non seulement de sa propre patrie, mais de l’Europe tout entière. Il possédait les moyens financiers, le loisir et les capacités intellectuelles d’absorption et de discrimination propres à amasser et à évaluer les richesses de la culture internationale, y apportant également l’abondante contribution originale qui était la sienne. Ses vastes lectures ne représentaient qu’un aspect de l’insatiable appétit personnel qu’il nourrissait avec méthode : dans les livres il puisait plaisir et profit.
Il traversait les frontières avec un pareil enthousiasme et des objectifs semblables : recueillir de nouvelles expériences. La France, l’Espagne [12] (peu attrayante), l’Italie, l’Afrique du Nord, la Suisse (d’une réserve trop glaciale), l’Allemagne, l’Angleterre, la Turquie, le Congo, le Tchad, la Russie soviétique furent tour à tour des champs d’exploration 3. Ses Nourritures terrestres, son Immoraliste préfiguraient le filon de cosmopolitisme présent dans bon nombre de textes littéraires français dans les deux premières décennies du siècle. Le voyage permettait la découverte de soi et son ressourcement. Loin du bruit et de la fureur de Paris, il représentait aussi tout simplement une occasion d’écrire. Gide devint celui pour qui la sédentarité n’était qu’une phase entre deux départs : sa malle entr’ouverte, une attitude d’esprit — Gide, la valise et la plume. « Nomadisme » et « déracinement » devinrent des articles de foi, « passer outre » (terme pour lequel sa traductrice anglaise, Dorothy Strachey-Bussy, s’évertua, sans résultat vraiment satisfaisant, à trouver un équivalent anglais), un mot clef. L’incident romanesque le plus notoire de toute sa production littéraire a lieu dans un train en marche. Bien qu’habitant fort souvent presque à portée de vue de la Manche et tout près de Dieppe, il n’était pas précisément, à la différence de plusieurs d’entre ses amis, tels Valery Larbaud, Jacques-Émile Blanche, un anglophile. À son ami Roger Martin du Gard qui, lui, devait un jour écrire : « L’Anglais est vraiment pour moi le type de l’Étranger, plus que le Noir, autant que le Tibétain ou le Japonais », il confia : « Je me sens mieux outre-Rhin qu’outre-Manche », secret que, pour ménager la sensibilité de bons amis en Angleterre, il lui demanda de ne pas ébruiter 4.
Enfant, il n’avait pas appris l’anglais, ses parents l’en ayant écarté afin de pouvoir converser en cette langue sans qu’il les comprît. Gide le déplorait, citant volontiers le mot du M. Jourdain de Molière : « Oh ! mon père et ma mère, que je vous veux de mal 5 ! ». Il dut cependant en acquérir quelques bribes auprès d’Anna Shackleton, la dame de compagnie écossaise de sa mère, de quelques-unes des « misses » aussi, qui vivaient à Paris pour parfaire leur éducation ou celle de leurs élèves français, de même qu’à la fréquentation d’œuvres littéraires ou d’écrivains anglo-saxons. Se trouvant, quelque peu contre son gré, en la compagnie d’Oscar Wilde et d’Alfred Douglas, à Alger, au mois de janvier 1895, il entama une lettre à sa chère mère par un « My swith mother », indication [13] d’enthousiasme linguistique plutôt que de compétence orthographique 6. Madeleine Rondeaux, sa cousine et future femme, semble, en revanche, avoir eu, vers cette époque, une assez bonne connaissance de l’anglais.
Pendant l’hiver 1904-05, profitant de leçons d’anglais qu’à son initiative Copeau donnait au jeune Paul Gide, son neveu, il essaya, mais sans trop d’application, d’acquérir quelques fondements de la langue 7. Bien plus tard, au début de 1909, il fit de sérieux efforts pour progresser. « On my fortieth birthday to be exact... I deliberately shook off this shameful acceptance of my ignorance and said to myself : ‘It is too stupid. I cannot do without English.’ Yes, I applied myself to it suddenly, resolutely, and for months and months I allowed myself no other study and no other reading 8. » Au début de 1910, il s’inscrivit donc, avec Ghéon, à des cours d’anglais à l’École Berlitz de Paris9. En 1911 et 1912, encouragé à s’aventurer dans la lecture d’œuvres littéraires anglaises par Henry-D. Davray, l’éminent spécialiste de littérature anglaise au Mercure de France, et par Edmund Gosse, avec qui il correspondait, il s’acquit en outre les services d’un professeur, d’une culture quelque peu limitée, un nommé Walter Walker, qu’il dépassa rapidement et qui eut peine à accepter que son inhabituel élève vînt de terminer la lecture de Paradise Lost dans l’original 10. L’apprenant s’enquit en conséquence de la possibilité de cours à la Sorbonne. Vers la fin de sa vie, il se souvint : « Je ne me suis mis à l’anglais que très tard ; mais résolument, et n’eut de cesse que je ne puisse lire couramment tant d’auteurs de toutes sortes qui font de la littérature anglaise la plus riche du monde entier 11. » De pareils progrès, pourtant, ne se manifestaient pas dans sa pratique de l’anglais parlé. Arthur Symons, rapportant une visite qu’il lui rendit dans le Sussex en 1911, note que son invité pouvait lire l’anglais, mais ne se sentait pas de compétence à le parler 12. Au printemps de 1918, revenant du Havre à [14] Paris, dans le train, si inadéquat était son anglais parlé qu’il ne put répondre au « A very nice country to fight for » de l’officier britannique manchot assis en face de lui… que par des larmes 13. Bien plus tard encore, il décrivit ainsi son incursion dans la littérature anglaise : « Just as Aladdin entered the gem-filled cave, so did I enter, child-like, an enchanted and enchanting world, where everything was a source of surprise to me... Thanks to intensive study, I was soon able to read English almost as easily as French ; but as for speaking it, that was another matter and I soon had to give up any pretensions in this respect14. »
Gide visita relativement peu l’Angleterre. Dans sa jeunesse, en 1888, il fit une excursion d’une huitaine de jours à Londres, chaperonné par son ami-mentor, le pasteur Élie Allégret. Son seul souvenir de cette expédition : être allé, au Metropolitan Tabernacle, écouter un sermon du célèbre prédicateur Charles Haddon Spurgeon, suivi d’un baptême collectif dans une piscine ad hoc, il attendit presque la fin de sa vie pour en commettre le récit sur papier. Abordé par une jeune évangéliste des plus respectables, il eut recours à l’une des rares expressions anglaises qu’il connaissait… « No, thank you », ce qui amena son compagnon à expliquer qu’elle s’était seulement enquise s’il voulait être sauvé. « Le reste du voyage s’effectua prudemment à la muette 15. » N’y a-t-il pas plus qu’une curieuse coïncidence dans le fait qu’en 1918 Gide soit retourné à Londres avec le fils adolescent d’Élie Allégret, dans des circonstances qui ne pouvaient que confirmer ce refus involontaire de passage par la porte étroite ?
Il projeta un court séjour à Londres avec ses amis Fedor Rosenberg et Paul-Albert Laurens en juin 1900, mais l’initiative échoua 16. Passons sur les trois semaines à Jersey en la compagnie, à Saint-Brelade, d’un Copeau convalescent et, brièvement, Ghéon et Van Rysselberghe — le peintre y fera le portrait de Gide — aux mois d’août-septembre 1907. Ce fut un an plus tard, vingt ans après sa première visite, que Gide retraversa véritablement la Manche. Il s’agit d’un bref raid impromptu, les 7, 8 et 9 septembre 1908, avec Copeau, Ghéon, Jean et Suzanne Schlumberger, du Havre à Southampton (avec nuit sur le pont), puis à Londres, où visite obligatoire au British Museum et soirée dans un music-hall, ensuite embardée-éclair [15] à Oxford17.
Entre-temps, Gide avait trouvé des lecteurs parmi les francophones anglais. Arnold Bennett avait écrit à son sujet dans The New Age et, en 1911, les deux hommes se rencontrèrent à Paris et commencèrent une correspondance 18. Son intérêt pour l’Angleterre était également aiguisé par sa récente amitié avec Valery Larbaud19, qui, en sa qualité d’angliciste, travaillait à un doctorat sur Chesterton. Ardent anglophile, Larbaud vivait de façon intermittente à Londres et connaissait fort bien la matière de Grande-Bretagne. Désireux de cimenter ses contacts britanniques et poussé par son désir de faire de la publicité, non seulement pour ses propres œuvres (ce qu’Edmund Gosse avait déjà commencé dans un retentissant article, « The Writings of M. André Gide », dans la Contemporary Review de septembre 1909), mais également pour celles des écrivains attachés à La Nouvelle Revue française qu’il avait aidé à fonder deux ans plus tôt, Gide descendit au Curzon de Londres du 7 au 21 juillet 1911 en la compagnie de Larbaud. Il espérait par la même occasion améliorer son anglais. Maria Van Rysselberghe se souvient l’y avoir vu, coiffé d’un canotier d’allure très bourgeoise — expérience qu’il n’allait pas répéter 20. Il déjeuna avec Gosse à la Chambre des Lords le 10 juillet et, le dimanche 16 juillet, accompagné de Larbaud et d’Agnes Tobin, se rendit, en la voiture de cette dernière, à Capel House, Ormeston, dans le Kent, faire la connaissance, chez lui, de Joseph Conrad, aux côtés de qui ils passèrent après-midi et soirée en discussions animées, avant de coucher à l’auberge du village. Le lendemain, retour pour le petit déjeuner chez le romancier anglo-polonais, qui parlait un excellent français avec une pointe d’accent provençal, prise de photos dans le jardin, puis visite au poète Arthur Symons à Island Cottage, Wittersham, près de Rye dans le Sussex. Symons avait rencontré Gide dans les années quatre-vingt-dix à Paris, admiré son Immoraliste (de même que, plus tard, il devait apprécier ses Caves du Vatican) et, par la suite, échangea une correspondance avec lui. Ils passèrent là l’après-midi à converser en français. Dans son journal [16] Symons nota : « Gide est curieux, aussi bizarrement étrange qu’il est étrangement fascinant, et d’un charme particulier 21. » Après une mystérieuse visite à Harwich, le voyageur quitta Londres pour Cuverville le 21 juillet.
Dix-huit mois plus tard il était de retour pour de nouveau faire connaître La N.R.F., mais aussi en partie afin de remercier Gosse en personne pour son essai louangeur dans Portraits and Sketches (1912) que le critique anglais lui avait envoyé. L’idée d’échapper à l’ennui que ne manquait de susciter en lui la perspective d’un Noël passé à Cuverville lui souriait également. Il descendit cette fois au Charing Cross Hotel et partagea le dîner de Noël de Gosse avec Henry James22. Ce n’était pourtant qu’une évasion partielle, car une lettre de Madeleine, expédiée de Cuverville, le pria de se joindre à elle en pensée le jour de Noël, en récitant un « Notre Père 23 »… Le 30 décembre il fut invité à dîner de nouveau, cette fois par Edith Sichel et Georges Moore. Ceci suivi d’une autre visite aux Conrad à Orleston. Après le précédent séjour avec Larbaud et Agnes Tobin, les deux écrivains avaient correspondu et Gide, aidé d’Henry Davray, s’efforçait d’organiser la traduction des œuvres de Conrad en français. Cette fois Gide récompensa l’hospitalité du romancier par le cadeau d’un meccano offert à son fils puîné John24. Arnold Bennett, à [18] cette date, était à Paris, où il passait les fêtes de Noël.
En dépit de l’effort requis par l’achèvement des Caves du Vatican, l’intérêt de Gide pour la chose anglaise ne cessait de croître et commençait à s’immiscer dans la concentration qui lui était nécessaire pour d’autres tâches 25. Au début de septembre 1913, il avait une fois de plus en tête le projet d’un séjour, soit à Londres, soit dans une station balnéaire anglaise qui ferait antidote à Cuverville26. Ce ne fut pas avant la fin de cette année que survint un répit dans son programme actif de lectures anglaises et la tentation, de nouveau, de passer Noël en Angleterre27. Un gros rhume l’en dissuada, mais le projet était seulement remis à juillet, date à laquelle la perspective d’un séjour dans la ville de Cambridge commençait à l’attirer. Larbaud, consulté, approuva, tout en recommandant le printemps plutôt que l’été :
Je comprends très bien que vous choisissiez Cambridge, mais c’est maintenant qu’il faut venir. En juillet ce sera bien morne et bien étouffant. C’est en ce moment qu’il faut y aller. Je préfère Cambridge à Oxford. Les bâtiments sont plus simples, les perspectives plus claires, avec des petits temples des belles-lettres, pseudo-classiques, tout à fait engageants. Ce qu’il y a de mieux ce sont the Backs, c’est-à-dire les pelouses, parcs et jardins qui sont derrière les collèges, et que traverse la Cam, divisée en un grand nombre de petits canaux, avec des ombrages placés là exprès pour qu’on vienne passer des journées, couché dans un bateau. On y rencontre Phédon, Alcibiade et Ménexène étendus sur des coussins de velours, lisant — qui sait ? — Les Nourritures Terrestres, tandis que les rames abandonnées pendent dans l’eau 28…
Une telle évocation de plaisirs gréco-anglais ne pouvait manquer de tenter Gide. Ils pourraient se rencontrer à Cambridge, suggéra Larbaud, après quoi, lui-même entreprendrait de satisfaire une de ses vieilles tentations : la circumnavigation des Îles Britanniques, de port en port, en steamer.
Gide, cependant, passa le printemps en Turquie en compagnie d’Henri Ghéon et de Mme Mayrisch. L’Angleterre ce serait après tout pour l’été. Dès le 28 juillet 1914, après quelques jours passés chez les Blanche à Offranville, ses valises s’empilaient sur le quai à Dieppe, rendez-vous était pris pour août avec Bennett et Jacques Raverat et un télégramme expédié à Larbaud à Hastings. Hélas, pour reprendre les propres termes de Gide « l’homme propose et le Kaiser dispose29 ». La nouvelle de l’ultimatum en route d’Autriche en Serbie et de l’amoncellement des nuages de la guerre l’obligèrent à annuler son voyage à la dernière minute.
Dans cette attirance qu’exerçait l’Angleterre sur Gide, Copeau entrait pour une part. Y ayant accompagné son père en voyage d’affaires, il connaissait et aimait Londres, depuis son enfance presque. L’un des moteurs psychiques de sa vie sensuelle s’était allumé là 30. Il y refit de fréquents séjours, y trouva en partie l’inspiration pour la fondation du Vieux-Colombier, connaissait Shaw, Isadora Duncan, Edward Gordon Craig, Granville Barker, et y emmena faire une tournée théâtrale, dans la dernière semaine de mars 1914, sa toute jeune troupe avec, comme chroniqueur de l’occasion, Roger Martin du Gard31. Il avait tôt fait, préparant ainsi le terrain pour Gide en 1918, d’amorcer des rapports avec le groupe de Bloomsbury en les personnes de Duncan Grant, auquel, en 1914, il fit appel pour les costumes de La Nuit des Rois, comme avec Clive Bell, chez qui il songea, en l’été de 1914, à évacuer sa femme et ses enfants. Sans doute servit-il de boute-en-train, si l’on ose dire, pour les départs outre-Manche, faux ou vrais, de son ami anglophone — et anglophile — débutant.
Quatorze mois après sa tentative avortée de juillet 1914 Gide se prépara à nouveau, cette fois pour un voyage en la compagnie d’Edith Wharton. Henry James, Bennett et Raverat avaient été prévenus. Une fois de plus les obstacles se révélèrent insurmontables, en l’occurrence la bureaucratie militaire et Gide, de nouveau, dut se contenter de savourer le piètre plaisir du renoncement au voyage. Ce n’était, promit-il à Bennett, qu’un recul proverbial « pour mieux sauter, un peu plus tard 32 ». Cambridge demeura un rêve interdit par la guerre.
Pour Gide, pendant ces années de guerre, le charme de Cambridge, si [19] idylliquement évoqué par Larbaud dans sa lettre de 1913, fut entretenu en sourdine par son amitié croissante et sa correspondance avec Jacques Raverat, qui habitait à proximité de la ville et maintenait des liens étroits avec ses cercles intellectuels et artistiques. Raverat, pianiste et peintre de talent, était le fils d’un industriel du Havre, l’un des principaux financiers, avec son ami Paul Desjardins, des Entretiens de Pontigny. Ancien élève du collège de Bedales et de la Sorbonne, Jacques Raverat était revenu en Angleterre, à Cambridge, afin d’y pousser plus avant ses études de mathématiques. Il s’était affilié au groupe cambridgien des Neo-Pagans et était devenu l’ami le plus proche du poète Rupert Brooke. Plus tard il abandonna les mathématiques, étudia la peinture à la Slade School à Londres, épousa la petite-fille de Charles Darwin, Gwen Darwin, le peintre-graveur et futur auteur de Period Piece et s’installa près de Cambridge. Sa première rencontre avec Gide datait de l’été de 1910 à Pontigny, alors qu’il assistait aux décades de cette année, moins par les bons offices de son père qu’en tant qu’associé de C. J. St. John Hornby qui, à la tête de l’Ashendene Press, était soucieux d’établir des liens avec des écrivains et des éditeurs français et tout particulièrement avec l’embryonnaire « comptoir d’éditions » de la jeune Nouvelle Revue française. Sa future épouse Gwen et St. John Hornby l’accompagnèrent à la décade. Après la mort de Brooke en 1914, Raverat se distancia des cercles Bloomsbury de Cambridge, en partie à cause de sa santé de plus en plus précaire, mais également par désapprobation de leur pacifisme et aussi en raison de l’antipathie qu’il éprouvait envers certains membres du groupe. Avec Virginia Woolf, cependant, il continua à entretenir une importante correspondance jusqu’à sa mort prématurée, de la sclérose en plaques, en 1925.
Paradoxalement, malgré — ou à cause de — sa nationalité française, Raverat représentait pour Gide un lien anglais plus personnel que des fréquentations professionnelles telles que Gosse et Bennett. Gide l’aimait beaucoup. Il admirait sa sensibilité et son intelligence. Leur amitié s’intensifia au cours de séjours à Florence au printemps et à Cuverville à l’automne de 1914. Ce fut sa lecture, avec le jeune homme, de Milton, qui fut à l’origine du développement chez Gide du concept du Diable, notion qui joue, dans sa vie et dans son œuvre, un rôle considérable et problématique 33. À Florence, Raverat parla à Gide de Rupert Brooke et de sa poésie. Par une étrange coïncidence, non seulement Gide avait déjà entendu parler de Brooke, mais les vies de deux hommes, ou leurs destins, allaient encore plus bizarrement s’entrelacer intimement.
Au début de 1911, le poète avait rencontré à Munich Élisabeth Van [20] Rysselberghe, la fille des amis très chers de Gide, Théo et Maria Van Rysselberghe. Élisabeth et Rupert commencèrent une liaison amoureuse et, pendant un certain temps, continuèrent à se fréquenter en Angleterre où Élisabeth étudia l’horticulture à Swanley Horticultural College, aux côtés d’Ethel Whitehorn, qui elle-même devait être accueillie dans le cercle intime de Gide34. En janvier 1912, Brooke partit pour Cannes pour se remettre d’une période d’extrême tension mentale. À Paris, Beth vint l’accueillir et il dormit huit heures dans l’appartement de ses parents, pendant qu’elle changeait des devises pour lui et organisait la réservation de son billet pour Nice. Chez les Van Rysselberghe, « près du feu, il parcourut un manuscrit d’André Gide qu’il avait emprunté à Raverat ». Maria Van Rysselberghe maintient que ce fut parce qu’elle avait confié à l’écrivain le profond regret de sa fille de n’avoir pas eu d’enfant de Brooke que Gide, loin d’être lui-même insensible aux charmes de Beth, nourrit le projet de lui faire porter son propre enfant, conçu, apparemment, sur une plage méditerranéenne, un dimanche de juillet 192235. En un sens et assez curieusement Gide s’interposait ainsi pour Brooke, dans la mesure où sa fille remplaçait l’enfant que le poète n’avait pas eu le temps d’engendrer.
En dépit des affirmations de Christopher Hassall, Gide et Brooke ne se rencontrèrent jamais. Certainement il était dans leur intention de le faire, chez Raverat, à Croydon, à côté de Royston, où il habitait à l’époque du séjour projeté par Gide au cours de l’été 1914. La guerre empêcha le voyage. Ce fut Gide, informé par une lettre de Raverat, qui communiqua à Beth la nouvelle de la mort de Brooke. Il n’y a pas trace de la réponse de Gide à Raverat ; elle ne lui parvint jamais, mais il fut profondément affecté par la mort du poète anglais et l’associa à celle de Pierre Dupouey, jeune lieutenant de vaisseau féru de littérature anglaise et française, qui correspondait avec lui depuis 1903 et qui trouva la mort sur le front belge le 3 avril 191536. À l’occasion de la mort de Brooke, Gide écrivit un poème, jamais publié et dont on a perdu la trace, en guise d’hommage. Au début de juin 1915, il avait en sa possession le récit circonstancié des derniers jours du poète et de son enterrement, dont il conçut l’intention de faire une traduction française pour accompagner celle des derniers sonnets, [21] « les seuls vers guerriers acceptables qu’aient produits ces derniers événements. Je doute si rien dans cette guerre saura m’émouvoir autant que ces deux fins, de Rupert Brooke et de Dupouey, également belles 37 ».
Le projet prit de l’importance. La N.R.F. envisagea la publication d’un volume in memoriam, comprenant des traductions de poèmes choisis, d’articles et de lettres. Raverat communiqua à Gide le nom d’Edward Marsh, l’exécuteur testamentaire de Brooke, et lui offrit sa propre collaboration et des copies de lettres que Brooke lui avait envoyées. Plus tard, Gide pensa utiliser comme préface une traduction d’un article d’Henry James sur Brooke, dont il avait entendu parler et qu’il essaya d’obtenir par l’intermédiaire d’Edith Wharton38. Gosse, ignorant les liens indirects qui, par l’entremise de Raverat, s’étaient tissés entre Gide et Brooke, lui écrivit, lui aussi, à propos de la mort du poète 39 ; dans sa réponse, Gide réitéra son intention de traduire les derniers sonnets. Gosse était un autre vecteur en direction de Marsh à qui Gide écrivit en remerciement de l’envoi d’un volume de poèmes, probablement 1914 and other Poems qui venait de paraître le 16 juin. Selon Linette Brugmans, Marsh « savait l’admiration de Brooke pour Gide » et approuvait l’idée d’un volume en français, mais ne pouvait y acquiescer sans l’approbation de la mère du poète. Gide, en l’occurrence, ne réalisa jamais son projet. Un choix de poèmes de Brooke, en anglais et en français, parut en 1919 dans Les Soldats-poètes de l’Angleterre du Baron E. B. d’Erlanger, et ce ne fut pas avant 1931 que fut publié l’ouvrage de P. Vanderborght Hommage à Rupert Brooke 1887-1915 avec poèmes de Rupert Brooke traduits de R. Hérelle, suivi, en 1933, du Rupert Brooke : avec un portrait d’A. Guibert.
Les années de la guerre, au cours desquelles Gide limita délibérément sa production, étaient propices à la lecture et ses incursions dans le domaine littéraire anglais lui avaient désormais fait parcourir une grande partie de la production littéraire de cette langue. Dans sa jeunesse, lisant en traduction et guidé par l’Histoire de la littérature anglaise de Taine, sa prédilection allait à Shakespeare et à Dickens (qu’à cette époque, dans ses premières notes de lecture, il comparait et contrastait astucieusement avec Balzac), à Carlyle également et, en tant que le disciple de Mallarmé qu’il était, à Poe40. Il s’était essayé aussi à la lecture de George Eliot ; Adam Bede [22] estimait-il, faisait preuve de grandeur morale, mais manquait d’art, sa constante pierre de touche. Il avait fréquenté Wilde avec précaution et connaissait ses œuvres. Le monde romanesque dans lequel il aurait volontiers vécu comme personnage était celui de Dickens, mais le roman qu’il aurait vraiment voulu vivre était, avoua-t-il, Les Hauts de Hurlevent41. Au début de 1911, s’étant sérieusement mis à l’anglais, il pratiquait une heure de lecture chaque soir et, dans les deux ou trois années qui suivirent, découvrit tour à tour Lamb, Stevenson, Bennett, Conrad, Gosse, Hardy, Thackeray et, avec un plaisir tout particulier, Fielding et Defoe, dont la liberté narratologique et l’exemple picaresque allaient égayer maintes pages des Caves du Vatican. Swift n’était pas son genre, mais Milton, Keats, Byron, Butler et Spenser (ce dernier avec l’aide du Skeat), vinrent tous apporter de l’eau à son moulin qui tournait lentement mais sûrement. Il lui fallut, à l’automne de 1914, un mois entier pour achever Tess d’Urberville de Hardy (dont son ami Jacques-Émile Blanche avait fait le portrait en 1906), tandis que, vers la fin de 1916, la lecture de The Return of the Native du même écrivain s’étendit sur plusieurs mois. Le 1er décembre 1915, il nota dans son Journal :
Sitôt achevé le Almayer’s Folly de Conrad, je me plonge dans le Bible in Spain de Borrow. Rien ne peut exprimer l’amusement et la curiosité avec lesquels je me précipite dans un nouveau livre anglais d’un bon auteur que je ne connaisse pas encore ; amusement que, depuis longtemps, la littérature française ne pouvait plus me donner, ne me réservant plus, à proprement parler, de surprises 42.
D’autres nourritures comprenaient les Évangiles (en anglais, bien entendu), Kipling, Wells, Pater et même le Sons o’Mende G. B. Lancaster. Le Shaving of Shagpat de Meredith, écrivit-il, était « un des livres que je jalouse le plus, que je voudrais avoir écrits43 ».
Il avait écrit sur Wilde (avait sous-estimé, comprenait-il maintenant, ses pièces), traduit le Gitanjali de Tagore et Typhonde Conrad, plusieurs poèmes aussi de Whitman, et, en 1917, faisait progresser sa traduction d’Antoine et Cléopâtre. Trois écrivains, cependant, constituaient d’importantes découvertes pour lui. Sur les conseils de Bennett il lut l’Autobiographie de Mark Rutherford et Delivrance, deux œuvres qui éveillèrent en lui de profonds échos puritains. « L’honnêteté, la probité », écrivit-il, « se font ici vertus poétiques […], l’écriture même est d’une transparence exquise, d’une scintillante pureté. Il mène à perfection des qualités [23] que je voudrais miennes. Son art est fait du dépouillement de toutes les fausses richesses 44. » L’éducation protestante, à condition de la dépasser, était, jugeait-il, la suprême école de la psychologie, d’où la supériorité du roman anglais sur le français. Il s’était attaqué à Blake en 1914, mais « avec étonnement ». Plus tard, ayant découvert Le Mariage du Ciel et de l’Enfer (qu’il devait traduire), il allait ajouter le poète anglais, aux côtés de Nietzsche et de Dostoievski, à la constellation des quatre étoiles de son firmament intellectuel. La quatrième, plus brillante encore que Blake, était Browning… n’oublions pas cependant Goethe. Plus Gide se plongeait dans Browning, plus il découvrait d’affinités avec lui. « Nul autant que Browning », lisons-nous, dans le Journal de 1938, « n’a fait jouer devant notre assentiment les multiples possibilités de la noblesse humaine […]. L’œuvre entière de Browning : Dieu vu à travers des âmes 45. »
Tout comme ce fut la guerre avec l’Allemagne qui conduisit Gide à pénétrer plus avant dans la littérature anglaise, ce fut la frustration due à la guerre qui fortifia son envie de visiter l’Angleterre. Une autre amitié, « anglaise » comme celle de Raverat, travaillait à l’y attirer. Depuis l’automne de 1916, son vieil ami, le romancier et banquier belge, co-fondateur de La N.R.F., André Ruyters, habitait Londres, nommé en mission auprès du ministère de la Guerre. Sa fille Luce allait bientôt épouser un ingénieur britannique. Bon anglophone, Ruyters goûtait fort la vie londonienne et fit tant, dans des lettres alléchantes, pour y attirer son ami, que celui-ci ira jusqu’à lui répondre, au printemps de 1917 : « À présent, Londres m’attire autant que l’Afrique ; mais me paraît presque aussi loin 46. » Pour Gide ce n’était pas peu dire.
Mais il y avait plus. Au cours du printemps et de l’été de 1917, il s’était profondément attaché à Marc Allégret, le « Michel » du Journal de l’été 1917 et l’un des fils du pasteur Élie Allégret avec qui il avait visité l’Angleterre pour la première fois en 1888 et dont la famille était intimement liée avec les Gide. L’idée d’envoyer un de ses jeunes protégés faire ses études en Angleterre lui avait déjà souri en 1914, il s’agissait alors du « K » du Journal, très probablement Dominique Drouin. En l’automne de 1917, il écrivit à Raverat, lui exposant son plan de faire passer à Marc — à l’époque élève au lycée Janson de Sailly — l’année de sa rhétorique en Angleterre, avant de rentrer en France faire son service militaire. Afin de garantir qu’il ait la compétence linguistique nécessaire pour tirer profit de [24] son année, il passerait l’été à Cambridge à améliorer son anglais. Gide ne cachait pas à Raverat que le projet avait au moins l’avantage de lui offrir un prétexte d’accompagner Marc et de passer l’été avec lui en Angleterre. En somme il était déterminé à réaliser son rêve d’avant-guerre. À une génération près, et les rôles étant inversés, c’est comme s’il avait à cœur d’exorciser par une négation hédonistique et amorale, sinon par une revanche subconsciente, ce premier séjour de 1888, accompli sous le signe d’un puritanisme austère : « C’est par haine contre cette religion, cette morale qui opprima toute sa jeunesse », lit-on dans le Journal des Faux-Monnayeurs à la date du 25 juillet 1919, « par haine contre ce rigorisme dont lui-même n’a jamais pu s’affranchir, que Z travaille à débaucher et pervertir les enfants du pasteur. Il y a là de la rancune. Sentiments forcés, contrefaits 47. » Que « Z » fût un personnage romanesque ou réel, l’observation demeure pertinente.
En fait la situation évolua et d’une manière qui favorisait le projet de Gide, car Léonie Allégret, directrice du Lycée Victor Duruy, suggéra de réorienter les études de son neveu en le faisant renoncer à un bac latin-sciences, jugé trop ambitieux pour lui, en faveur d’un bac latin-langues. S’il savait l’allemand, seule une immersion totale pouvait suppléer à son ignorance presque entière de la langue anglaise. Quoi de plus sage donc qu’un séjour cambridgien ? C’était un renfort inespéré au dessein moins altruiste de Gide48. Raverat pourrait-il trouver et un professeur pour Marc et une famille qui pût l’héberger, s’enquit-il. Le peintre l’orienta vers Louis de Glehn, professeur de français à la Perse School qui, dans une longue réponse à la lettre de l’écrivain français, offrit de non seulement s’occuper de l’enseignement de Marc, mais aussi de le loger dans sa propre maison 49. Raverat suggéra que le Rév. H. F. Stewart, spécialiste [25] universitaire de Pascal, ami de Paul Desjardins et habitué des Entretiens de Pontigny, pourrait lui aussi favoriser les plans de son ami, qui comprenaient maintenant des projets d’excursions dans des régions plus sauvages, en l’occurrence la Région des Lacs, le Pays de Galles et l’Écosse. Bien qu’il le vît à Cambridge (et le trouvât, comme tous les autres Anglais qu’il y fréquenta « frémissants d’amour et d’enthousiasme pour la France », gageons que Gide, dans le contexte, était plutôt enclin à ne pas trop dépendre d’un tel appui ecclésiastique 50.
Averti par son ami -- la guerre se prolongeait — qu’il aurait besoin d’une carte de voyage et d’un carnet alimentaire, Gide travailla à consolider ses plans au printemps de 1918. Son dessein, si longtemps contrecarré, d’accomplir sa cinquième traversée de la Manche, se trouvait à présent enrichi du plaisir de l’accomplir en compagnie de Marc. Pour agréable qu’en fût la perspective, elle était cependant entachée d’un sentiment de culpabilité. D’une part la guerre n’était pas terminée. Sur un plan plus personnel, partir avec Marc, c’était trahir irrémédiablement l’engagement spirituel qui le liait de longue date à son épouse, même si Gide avait pris grand soin de le définir et de l’entretenir comme tout à fait distinct d’un engagement physique, hors de question dès même sa nuit de noces. Ses nombreuses précédentes aventures homosexuelles, sans lendemain pour la plupart, étaient d’un autre ordre que le profond lien émotionnel qui l’attachait depuis quelque temps à Marc. L’idée de l’escapade anglaise donnait donc naissance à de vifs sentiments d’anticipation, certes, mais aussi à de [26] profondes hésitations plus troubles. Significatif, le sujet de roman qu’il imagine dans son Journal du 9 mai : « X. fait un immense effort d’ingéniosité, de combinaison, de duplicité, pour réussir une entreprise qu’il sait répréhensible […], il y dépense plus de résolution, d’énergie, de patience qu’il ne faudrait pour réussir le meilleur […], mais il est trop tard à présent pour s’en dédire ; il est pris lui-même dans la machine 51… » À d’autres moments il est plus résolument optimiste : « J’imaginais déjà », écrirait-il plus tard, « la petite maison anglaise où nous allions, pour la première fois, vivre ensemble, seuls. C’était si beau, si inespéré », mais il savait déjà que c’était un rêve qui pourrait bien coûter, coûterait bien, le bonheur de sa femme et cette part de son propre bonheur qui dépendait du sien52.
Avant son départ pour l’Angleterre, Gide crut bon de passer quelques semaines avec sa femme à Cuverville. Quels qu’eussent pu être les soupçons que nourrissait Madeleine à l’égard de la vie privée de son époux, un incident en particulier, survenu au cours de l’hiver 1917, l’en avait informée de manière regrettablement brutale. Considérant Henri Ghéon (compagnon de Gide en débauches clandestines, alors au front, officier dans le corps médical) comme presque un ami de famille, elle avait pris l’initiative, exceptionnellement, d’ouvrir une lettre de lui, datée du 13 décembre, et adressée à son mari. Elle renfermait des allusions à certaines activités communes passées que Ghéon, converti au catholicisme par ses expériences de la guerre, regrettait maintenant profondément. Les yeux de Madeleine se dessillèrent 53. Elle connaissait aussi l’attirance qu’exerçait sur son mari la famille Allégret et l’avait discrètement prévenu contre cette tentation. En juin 1918 elle ne pouvait manquer de reconnaître avec appréhension le bonheur éhonté qu’il avait été récemment incapable de lui dissimuler et d’en être amèrement blessée. La veille de son départ, confia Gide plus tard à Martin du Gard, elle lui fit part de ses soupçons :
— Tu ne pars pas seul, n’est-ce pas ?
J’ai balbutié : — Non…
— Tu pars avec Marc ?
— Oui…
… J’ai voulu parler. Mais elle m’a arrêté d’un mot terrible :
— Ne me dis plus jamais rien. Je préfère ton silence à ta dissimulation 54.
Gide devait partir à l’aube le lendemain. Toute la nuit il arpenta sa chambre, atterré, tenaillé par le remords, empêtré dans ses plans soigneusement [27] élaborés, se demandant s’il devrait partir, composant dans le désarroi une lettre folle, pleine d’auto-justification, qu’il eut la mauvaise idée de mettre entre les mains de Madeleine au moment de son départ, et dans laquelle il avait écrit qu’avec elle, à Cuverville, il sentait qu’il « pourrissait », la vie s’écoulait de lui, il avait besoin de s’échapper, de partir, de se renouveler, s’il voulait retenir son pouvoir de création. Dans son Journal, à la date du 18 juin, on lit : « Je quitte la France dans un état d’angoisse inexprimable. Il me semble que je dis adieu à tout mon passé. » Il eut beau ajouter (phrase omise lors de la publication originelle, mais restituée par Éric Marty dans son édition de 1996) : « J’aime Madeleine de toute mon âme — l’amour que j’ai pour Marc ne lui a rien volé », il avait sacrifié sa femme aimée à l’adolescent adoré 55. C’est avec le sentiment de traverser le Rubicon qu’il se prépara à traverser la Manche.
Le soir du mercredi 19 juin les deux compagnons prirent le bateau de nuit du Havre, passant d’abord chez Georges Raverat (père de Jacques) à Ste-Adresse. L’arrivée matinale à Southampton leur permit un rapide tour de la ville. « Tout étonné(s) d’y être », ils gagnèrent Londres en fin de matinée du jeudi 2056. Puis, revigorés par la sieste et le thé, ils assistèrent, le soir même (à défaut, qui sait, de son Peter Pan), à une représentation [28] du Dear Brutus de J. M. Barrie.
Ils ne tardèrent pas à contacter Gosse à qui Gide avait préalablement demandé de confirmer par une note, rédigée de préférence sur papier officiel, « bibliothèque de la Chambre des Lords, par exemple » (Gosse en avait été le bibliothécaire), les arrangements concernant Marc à Cambridge. Même s’il la reçut à temps, elle n’empêcha pas les officiers d’immigration, en apprenant qu’il se rendait à Cambridge, centre bien connu de pacifisme, de s’enquérir s’il était lui-même un pacifiste. En l’occurrence, ce n’était pas le cas. « Hourra », écrivit-il à Bennett, le lendemain, « nous avons mis le pied en Angleterre hier matin ; hier encore je croyais rêver — mais c’est bien à Londres que je me réveille encore ce matin 57. » André et Georgina Ruyters ne pouvaient offrir hébergement, au 66, Galveston Road, East Putney, que pour une seule personne. Les voyageurs logèrent donc au 9, Lancaster Gate (où Paul Wenz, romancier franco-australien, traducteur de Jack London et ancien condisciple de Gide sur les bancs de l’École Alsacienne, mais travaillant maintenant pour la Croix-Rouge, avait aussi élu résidence), tout en passant la plus grande partie de leur temps ailleurs. Oxford Street s’avérait d’une attraction particulière. « Nous parcourons les rues de Londres du matin au soir », écrivit Marc Allégret, « toujours avec de nouvelles surprises 58. »
Il avait été prévu de consacrer une semaine à visiter la capitale avant de gagner Cambridge via les Raverat à Weston. Après le culte, le dimanche 23 fut consacré aux Ruyters avec visite obligatoire, puisque non loin de chez eux, à Kew Gardens. La lettre que Gide avait envoyée à Bennett le vendredi ne lui parvint pas avant le lundi, mais entraîna immédiatement une invitation à dîner au Grill Room du Café Royal, Regent Street, pour le mardi 25 juin. Mme Bennett serait aussi de la partie. À cette date, Bennett, grâce à l’intervention de son ami Beaverbrook, ministre de l’Information, se trouvait à la tête de la Section française du Bureau de Propagande au ministère. Gide était si anxieux de le voir qu’il se présenta à son bureau le mardi, à l’improviste, mais l’occupant était absent. La visite chez Gosse, le soir du 21, avait été plus fructueuse, car il fournit au visiteur deux lettres de recommandation, l’une à l’intention du Directeur du Zoo de Londres (Gide ayant toujours éprouvé une fascination pour l’histoire naturelle), l’autre auprès du « Vice-Chancellor of Christ’s College59 ».
[29] Il y avait d’autres connaissances à contacter dans la capitale : Henry-D. Davray, qui habitait au 8, St. Martin’s Place, Jules Delacre, écrivain belge en exil, et sa femme Marie-Anne, amie de Maria Van Rysselberghe ; c’est en la compagnie de cette dernière qu’ils allèrent au Palladium, Argyll St., tout proche de Oxford Circus, l’après-midi du 2660. Conrad se trouvait temporairement dans la capitale (sa femme y subissait une intervention chirurgicale), à Hyde Park Mansions. Ruyters et Gide lui rendirent visite le lundi 24, mais sans la traduction de Typhon, dont Gide attendait toujours des exemplaires. Ils revinrent le lendemain, Gide laissant ensuite à Ruyters, qui, de son côté, traduisait Heart of Darkness, le soin de continuer les pourparlers. Le voyageur souhaitait vivement voir quelques tableaux de Raverat exposés au New English Art Club dans Suffolk Street. Le peintre avait également arrangé une rencontre avec Katherine Cox, amie de Brooke, pour que le visiteur aille en voir d’autres dans son appartement de Fleet Street61. Quant à Valery Larbaud, il était en voyage en Espagne. Pour un homme habité de la curiosité et de l’énergie de Gide, surtout lorsque stimulé par la présence d’un jeune compagnon, Londres offrait des possibilités infinies.
Le jeudi 27 juin, ils quittèrent la capitale pour « Darnall’s Hall », Weston, Baldock, près de Stevenage, au sud-ouest de Cambridge. Jacques Raverat, de plus en plus immobilisé par la maladie, était impatient d’accueillir son ami et de parler avec lui, car il ne l’avait pas vu depuis un séjour à Cuverville à la fin de septembre 1914, quand les deux hommes avaient eu une sérieuse discussion concernant le Diable, la religion et la morale 62. Ils passèrent la soirée à discuter et à jouer du piano. Le lendemain Gide se rendit à Cambridge pour voir la ville dont il avait tant entendu parler. Ils y rencontrèrent de Glehn, visitèrent la Perse School, passèrent ensuite chez Lady Jane Strachey à la recherche de son gendre, le peintre Simon Bussy, auprès duquel un ami commun, Auguste Bréal, lui avait donné une lettre d’introduction 63. Bussy était sorti. Lui laissant un [30] mot, Gide et Marc s’en allèrent déjeuner chez Stewart, consacrèrent l’après-midi à du canotage sur la rivière à Grantchester, puis rentrèrent par le train chez les Raverat. La note laissée pour Bussy occasionna une réponse par retour du courrier, invitant le voyageur à déjeuner chez les Strachey le 4 juillet, une semaine plus tard. Ce fut une invitation qui allait lui ouvrir les portes d’un des centres les plus avant-gardistes et créatifs de la vie intellectuelle anglaise, un milieu avec lequel il allait se découvrir de nombreuses affinités. Il y trouvera également la traductrice qui répandra son œuvre auprès du public anglo-saxon.
À Weston, de nouveau le temps passa en promenades, causeries, soirées piano. On discuta l’œuvre de Jacques et de Gwen ; on parla peinture et littérature. De Brooke, Gide lut The Old Vicarage, Grantchester64 . Le dimanche, de Glehn et un ami français, Gaston Vadel, étudiant à King’s College, vinrent visiter à bicyclette. Puis, après ce très long week-end à Weston, qui eut sur Raverat le double effet de le détendre et de le revigorer, Gide et Marc déménagèrent à Cambridge le soir du mardi 2 juillet. Larbaud avait eu raison. L’on était en temps de guerre et de vacances ; la ville était vide d’étudiants et des plus jeunes d’entre les enseignants, mais peuplée de soldats convalescents.
À Grantchester, la maison de de Glehn, « Byron’s Lodge », gîte de Marc pour les presque six mois à venir, avec jardin, potager et non loin, en contrebas, rive sur la Cam, était tout proche du « Old Vicarage » qu’avait habité — et chanté — Brooke. Les pièces à « Byron’s Lodge » étaient embellies par les tableaux de Wilfrid de Glehn, frère de Louis, [31] talentueux peintre impressionniste, par ceux aussi de leur oncle Oswald von Glehn et de leur beau-frère Lucien Monod. À côté du « Old Vicarage » était « The Orchard » — où Brooke avait logé antérieurement. Installés aussi pour l’été chez de Glehn étaient sa sœur Rachel Marsh (sans, la plupart du temps, son mari Frank) et ses quatre enfants, Bobby, Barbara, Elma et Philip. À côté, à « Yew Garth », habitait la famille Warburton, Cecil Warburton enseignant la zoologie agronomique et l’entomologie médicale à l’université. Scientifique, l’entourage de de Glehn était aussi musical et, avec les grandes orgues de la célèbre chappelle de King’s College non loin, Gide et Marc ne tardèrent pas à faire la connaissance du talentueux compositeur Roger Quilter, du pianiste et conducteur Anthony Bernard, du pianiste Hamilton et de Reginald Hilton, étudiant de musique en passe de devenir étudiant de médecine, mais aussi organiste passionné. Au cours de l’été, tout ce monde passa et repassa à « Byron’s Lodge ».
C’est à cent pas de la maison qu’on avait trouvé une chambre pour Gide, à « Grape House », chez Mlle Ashford, qui y habitait avec ses vieux parents. Au milieu de la semaine, le 3 juillet, il s’y sentit assez bien installé pour ouvrir son journal pour la première fois depuis son départ de France. À la demande de son nouveau locataire, l’obligeante hôtesse avait décroché certaines gravures peu attrayantes des murs de la petite chambre qu’il occupait. Il s’avéra moins facile, cependant, de se débarrasser du tic-tac de l’horloge, plus solidement installée céans. « L’air est chaud », nota-t-il, « le ciel pur ; le temps fuit. » Allumant une cigarette, il entama Brief Lives de John Aubrey, pionnier de la biographie anglaise 65. Le lendemain, il devait déjeuner chez les Strachey.
La monolithique Lady Strachey, veuve depuis 1908, avait loué le 27, Grange Road, pour l’été. Autour de cette formidable dame (Marc la dépeint « balan [çant] son mégot sous sa lèvre inférieure 66 ») était réunie sa tout aussi formidable famille, dont plusieurs membres allaient devenir des fréquentations de Gide. Sa fille, Dorothy, âgée de 53 ans, épouse de Simon Bussy, dont la rencontre avec André Gide allait changer le cours de sa vie, se souvint de cette première visite. L’invité français arriva vêtu d’un élégant costume noir qui lui prêtait un air de sévérité puritaine très « pasteur protestant ». Elle fut frappée par son extrême politesse qui frôlait l’affectation. Ses difficultés à s’exprimer en anglais rendirent la conversation difficile. Une certaine ressemblance avec Shakespeare inclina Lady Strachey immédiatement en sa faveur et demeura à jamais imprimée dans son esprit. Ils parlèrent de la guerre et du neveu de Gide, Dominique Drouin, qui se trouvait encore au front. Gide mentionna qu’il cherchait quelqu’un qui pût lui donner des leçons d’anglais. Dorothy se proposa. N’étant pas homme à perdre son temps, Gide arriva à bicyclette de Grantchester, le lendemain même, vendredi 5 juillet, à 11 h tapantes. Dorothy découvrit bientôt que son élève avait une connaissance étendue de la littérature anglaise. Apprenant qu’il s’était depuis toujours appliqué à apprendre des vers par coeur, elle lui demanda quels étaient les derniers qu’il avait retenus. Lorsqu’il récita, sans hésiter, les vers du Faustus de Marlowe : « Was this the face that launched a thousand ships... », elle comprit brusquement la richesse de la culture de son élève ainsi que la profondeur [34] de sa sensibilité.
Pour chaque leçon il se présentait à l’heure exacte, ayant fait le trajet à bicyclette et scrupuleusement préparé les tâches qu’elle lui avait assignées. Ils lisaient de la prose et de la poésie en anglais un peu au hasard pendant une heure, Marvell, parmi d’autres auteurs, et Donne, que Gide appréciait moins, en dépit du fait qu’il s’était inscrit autrefois au Club John Donne d’Agnes Tobin. La leçon achevée, Gide restait souvent à parler en français, familiarisant à son tour son professeur avec des auteurs de sa langue : Valéry (selon lui le plus grand poète français contemporain), Scève également. Il parlait de son enfance, de l’art de la traduction — tout futur écrivain se devrait, selon lui, de traduire au moins un ouvrage étranger, — discutait aussi avec Simon de la stylisation de ses peintures. Dorothy Bussy, qui allait faire de ses œuvres d’excellentes et élégantes traductions et, par la même occasion, tomber désespérément, corps et âme, amoureuse de lui, a évoqué avec nostalgie ces tranquilles rencontres du début de leur amitié et leur industrieuse camaraderie : « Oh ! le bonheur de ces journées cambridgiennes, quand je n’étais que votre dictionnaire et votre grammaire, pratique et serviable. Et vous aviez pour moi la même affection que celle qu’on éprouve pour un dictionnaire 67. » Ce qui resta surtout dans son souvenir était la voix de son élève, parlant, lisant, récitant, « une voix si pure, si vraie, si émouvante — une voix qui entraîne, une voix qui transporte et fait fondre, une voix qui me fait tomber à genoux 68 ».
Le 8 juillet, laissant Marc à ses cours de latin et d’anglais à la Perse School et à ses tentatives de flirt avec les girls de Grantchester, Gide quitta le village pour passer quelques jours avec les Raverat. De nouveau les amis partagèrent de longues discussions et Gide lut une grande quantité de poésie anglaise, prenant un plaisir tout particulier à la lecture de Marlowe et Herrick. Il repartit le samedi 13 juillet, emportant avec lui le paquet de lettres que Rupert Brooke avait écrites à Jacques, et qu’il était impatient de lire 69.
Ce fut le 14, jour de pluie et de fête, qu’eut lieu l’incident sexuel que, le lendemain, il consigna dans son Journal, mais prit soin d’omettre lors de sa publication, et qui a été récemment restitué dans la version intégrale : « Attendu Marc le premier soir ; en vain. Le lendemain, 14 juillet, je me suis exténué tout le long du jour. Deux fois avec M. ; trois fois [35] seul ; une fois avec X. ; puis seul encore deux fois. Absurde besoin d’outrance, puis d’annihilation… d’en finir. Aujourd’hui70… » Il s’agit sans doute du même épisode, guère à son honneur comme lui-même en convenait, qu’il relata plus tard à la « petite Dame » : « Vous ai-je raconté, me dit Gide, que chez D. (professeur chez lequel Marc était en pension, à Grantchester), je me suis fort mal conduit avec un jeune garçon de ses parents, fort sottement du reste, sans désir, ni curiosité, « par acquit de conscience », avais-je raconté à Marc en riant. L’enfant le dit à sa mère, qui s’en ouvrit à D., qui crut de son devoir d’avertir Marc auquel il s’était attaché, et cela d’une façon fort belle, ma foi, pleine de noblesse et de sagesse, plus révolté par l’abus de confiance que par les faits. Là encore, il semble bien que Marc eut une fort jolie attitude : exaltant devant D. tout le bienfait de mon influence. En me le racontant, il dit en souriant : « Tout de même, oncle André, tâche de ne plus faire trop de choses par “acquit de conscience 71" ! » Nulle mention de l’épisode dans le carnet de Marc, à moins que le laconique « Fumée » ne soit une référence codée à l’activité sexuelle. « D » est indubitablement de Glehn, la « mère », sa sœur Rachel Marsh (née de Glehn), et le garçon, très certainement, Philip Marsh. Même hormis tout contexte délictueux, c’était mal payer la bonne volonté, la cordialité d’un hôte exemplaire. Comme il s’en rendit compte (d’où, sans doute, la « confession » à Maria Van Rysselberghe), il n’y eut que Gide qui sortît avili de l’histoire.
Malgré l’hospitalité qu’il y rencontrait et les liens qu’il commençait à forger, il se sentait un peu dépaysé dans son nouvel environnement anglais et pourtant avait l’impression que c’était son destin d’être là et de s’y plaire : « L’oasis de l’Afrique la plus extrême me dépaysait moins que ne fait aujourd’hui Cambridge ; et je comprends que ce n’est point par hasard que depuis tant d’années l’horloge de l’église de Grantchester est arrêtée. Quelques heures de ma jeunesse m’attendaient depuis longtemps sur la Cam, que je vis enfin, désespérément et comme en rêve, canotant, lisant Herrick, me baignant », écrivit-il le 16 juillet à Bennett, dont il avait lu, avec approbation, les articles humanitaires sur l’actualité, parus dans Lloyds Sunday News. Il se faisait du reste un plaisir de rencontrer Mme Bennett lors d’une visite prochaine qu’elle comptait faire à Cambridge72. [36] À Blanche, il s’avoue « requis par le canotage, le bain, etc. Le cours de la Cam est charmant ; je ne me console pas de n’avoir point goûté à cette vie il y a trente ans 73 ». Il lisait aussi, pour s’aguerrir, sans doute, aux attitudes anglo-saxonnes, Les Silences du Colonel Bramble, « pimpant petit livre » d’un inconnu, André Maurois74.
Rentrant de chez les Raverat, Gide réintégra le ménage Ashford, à « Grape House » : « J’habite à 200 mètres de [Marc], à l’extrémité d’un petit village entouré de prairies qui vers l’est dévalent vers la Cam, où circule du matin au soir une flottille de barques chargés de cadets et de sylphides et où viennent apprendre à nager tous les urchins du pays. J’occupe ici une chambre à coucher avec un lit terriblement trop grand pour moi seul, et un sitting-room où l’on me sert mon solitaire repas du soir (les autres repas se prennent en compagnie de ma logeuse, et de ses vieux parents !) ; la table où je t’écris est devant la fenêtre à guillotine ; une étroite bande de jardin me sépare de la grande route où le people qui passe me distrait 75. » Nonobstant les urchins et bien qu’adonné à l’ascétisme, il avait commencé à souffrir, après un certain temps, des limitations de ce gîte. Il avait rencontré Goldsworthy Lowes Dickinson, ami de Lytton Strachey, un « Apôtre » et un « Fellow » de King’s College, qui lui offrit son appartement dans le collège. Malgré cet appui de « Goldie » et l’approbation du « Provost » (le président du collège), le conseil collégial refusa sa requête d’emménager. La faute à ses livres à lui ou à ceux de son oncle socialiste ? Gide hésita à décider, comme il l’écrivait à Auguste Bréal, laquelle des explications était la bonne 76. Roger Fry, pensa-t-il, pourrait, à la rigueur, jeter quelque lumière sur le mystère.
Dickinson était un peu plus âgé que Gide, mais partageait avec lui un grand nombre d’intérêts. C’était un écrivain réfléchi et prolifique, profondément versé dans la culture grecque, mais ouvert également aux conflits [38] et dilemmes du monde contemporain. En dépit de sa réserve innée, il exerçait une grande influence sur les jeunes gens de l’université et au-delà. Figure de proue, avec George Moore, de la société des « Apôtres » (club de l’élite intellectuelle de l’université — et presque exclusivement homo- ou bi-sexuel), il croyait à la pratique de l’esthétisme dans sa vie personnelle et dans ses rapports, et que le salut résidait dans l’activité exemplaire de l’individu. Il avait écrit sur la France, publié La Vie selon les Grecs (« élément constitutif de la bibliothèque de libération de la jeunesse d’alors », affirma Noël Annan), et, en 1905, avait fait paraître Un Symposium Moderne, « même jusqu’à présent, l’une des vues les plus perspicaces sur les idées politiques anglaises au tournant du siècle 77 ». Comme le révéla la publication de son autobiographie, il était aussi un homosexuel non avoué, dont le premier grand amour avait été pour Roger Fry. Il était l’ami intime du romancier E. M. Forster.
Gide en vint à le connaître suffisamment pour pressentir que, au risque de peut-être le choquer quelque peu, il serait un lecteur compréhensif de Corydon, son dialogue socratique, encore inédit, sur la pédérastie. Dorothy estimait Dickinson inchoquable 78. Que Gide le sût ou pas, Dickinson, en 1901, avait lui-même utilisé la forme du dialogue socratique dans son Sens du Bien. Lorsque Gide revint passer un deuxième été en Angleterre et au Pays de Galles en 1920, il souhaita tout particulièrement rencontrer Dickinson de nouveau et organisa une rencontre avec lui à Londres, à la mi-septembre, pour lui confier un exemplaire de Corydon, publié cette année-là à compte d’auteur et en tirage très limité. Il lui demanda de le transmettre ensuite à Forster. Dickinson lui fit part de sa réaction le 14 septembre 1920. Gide la qualifia d’« appréciation intéressante et si joliment exprimée 79 ». Il ne devait rencontrer Forster en personne, et alors à Paris, qu’au milieu des années trente, mais le romancier anglais allait néanmoins être un lecteur engagé de Si le grain ne meurt et des Faux-Monnayeurs, texte que Forster analysa en détail dans ses Aspects du roman.
Cambridge, malgré la guerre, était peuplé de gens intéressants, mais c’était à Londres qu’il fallait chercher des diversions culturelles. Le [39] vendredi 19 juillet, tandis que la grande bataille sur la Marne faisait rage, Gide et Marc retournèrent à la capitale avec les Bussy/Strachey y passer trois ou quatre jours, couchant non au 9, Lancaster Gate, complet, mais à deux pas de là, au 28 Craven Terrace, utilisant toujours le 9 cependant (tél. : Paddington 7265) comme quartier général et salon de thé. L’après-midi ils passèrent chez Davray et chez Bennett -- ce fut Madame qui recevait — et, le lendemain soir, samedi 20, assistèrent à la première de sa nouvelle pièce, The Title, au Royalty Theatre, suivie d’un petit souper, organisé toujours chez Madame. « Copieux divertissement sans prétentions », écrivit de la pièce le critique anonyme du Times (22 juillet, p. 9), « pas pesant pour un sou, elle concerne les listes de décorés, propriétaires de journaux, écoliers, jeunes filles modernes, le mariage et d’autres sujets assez connus de tous, le terme surfait de camouflage n’y est pas dédaigné […]. Le public […] était manifestement ravi du spectacle entier. » Assez éloignée toutefois des goûts théâtraux de Gide, ce qui ne l’empêcha pas d’écrire une lettre effusive à l’auteur, le félicitant et le remerciant d’une « excellente, exaltante soirée 80 ».
En même temps, par le biais autrement piquant du Journal de Samuel Pepys, Gide apprenait également, et avec plus de véritable admiration, les préoccupations — et les divertissements — du Londres du dix-septième siècle. « Lisez le journal de Pepys », exhorta-t-il Blanche, « ne vous adressez qu’à une édition non expurgée […], sans blague vous devriez vous procurer cela 81. » Le soir du vendredi 19, les deux touristes avaient assisté, avec les Bussy et d’autres Strachey, à la première du Coq d’or monté par la Compagnie Opératique de Sir Thomas Beecham au Theatre Royal, Drury Lane. Un élégant Britannique flirta avec Marc à l’entracte. Après le théâtre, on partagea une collation dans l’appartement de Clive Bell dans Gordon Square à Bloomsbury. Aux murs, un Ingres et un Cézanne. Le maître des lieux était absent, mais y circulaient force Strachey (Gide connaissait maintenant la moitié de la famille) et Marc, pourtant bien renseigné sur l’objet réel de ses affections, notamment le très homosexuel Lytton, prodigua, à une Dora Carrington très garçonne, toute son attention 82. Y eut-il, champagne aidant, assignation ? Il le semble, car Marc, rentré entre-temps à Grantchester, fit un nouveau saut rapide à Londres le lundi 22, mais chez Oliver Strachey, cette fois, autre frère de Dorothy et de Lytton, au 96, South Hill Park, Hampstead Heath. Une [40] Carrington plus sobre lui fit cependant faux bond ; le chasseur de girls rentra bredouille. Un autre soir de ce séjour londonien, Gide dîna à la même adresse, faisant la connaissance de la femme d’Oliver, Ray Strachey, née Costelloe, dont la mère avait épousé en secondes noces le critique d’art Bernard Berenson83. Beaucoup des Strachey parlaient français, heureusement pour Gide, car son anglais parlé restait défectueux (la prononciation des mots « Holy Ghost » — Saint-Esprit — était le test habituel auquel le soumettaient les Raverat) et malgré ses efforts soutenus, conjugués à ceux de Dorothy Bussy, il sentait qu’il ne progressait guère.
Ce saut à Londres — ils en feront d’autres — était un interlude par trop frénétique déjà dans la calme idylle de Cambridge. « Cambridge est merveilleux, enthousiasmant », écrivit-il à Bréal le 19 août, et, le 31 juillet, à Gosse dont il lisait Trois moralistes français, que l’auteur lui avait offert : « J’y rencontre quantité de gens charmants — mais surtout j’y écoute les voix du passé 84. » Le 2, il avoua cependant à Schlumberger le profond culture-shock qui expliquait sa relative anorexie épistolaire : « Je me suis perdu de vue. Je ne comprends plus rien aux états que je traverse — des terres innommées — et il faut jouer devant les autres cette comédie de faire semblant de vivre avec eux 85. »
Le projet d’emménager à King’s College ayant échoué, Gide demeura à « Grape House », Grantchester, avec, cependant, comme on l’a constaté, des échappées dans la capitale et ailleurs. Le 29 juillet il fit une excursion, seul, pour voir la célèbre cathédrale gothique d’Ely, petite ville voisine de Cambridge. C’est alors qu’une autre de ses connaissances anglaises, peintre lui aussi, le contacta : William Rothenstein, qui avait fait sa rencontre dans les milieux artistiques de Paris, avant le tournant du siècle, et avec qui, depuis 1913, il échangeait une correspondance sporadique. Rothenstein était un ami de Rabindranath Tagore et avait admiré L’Offrande lyrique, la traduction que Gide avait faite en 1913 du Gitanjaliet dont il lui avait offert un exemplaire dédicacé. En fait, le peintre avait déclaré à Tagore qu’en ce qui concernait les traductions d’anglais en français il « n’avait jamais rien lu d’aussi remarquable […] depuis les traductions [41] de Poe faites par Baudelaire86 ». Ce fut pour l’inviter à passer un week-end à Iles Farm, Far Oakridge, près de Stroud, que Rothenstein lui écrivit maintenant. Gide lui répondit pour expliquer la situation concernant son « neveu » de 17 ans qu’il hésitait à abandonner. Tous deux seraient les bienvenus, lui assura le peintre. Ils passèrent donc un long week-end, du 9 au 13 août, au plus profond du Gloucestershire87. En route, ils s’arrêtèrent à Londres, y couchant à l’étroit dans des chambres de circonstance que Wenz leur avait trouvées, proches de Lancaster Gate, les soirs des mercredi 7 et jeudi 8. Courses, Conrad — deux visites (il était dans la capitale) —, le zoo, le British Museum, déjeuner le vendredi, avec Middleton Murry — emploi du temps, en somme, plutôt chargé. C’est Paul Valéry qui lui avait enjoint de contacter son ami Murry — qui devait être nommé directeur de l’Athenaeum quelques mois plus tard — et lui avait fourni son adresse londonienne 88. Arrivés par chemin de fer dans le Gloucestershire en début de soirée, ils trouvèrent Mme Rothenstein qui les attendait en voiture. Marc sympathisa vite avec le jeune John (plus tard Sir John Rothenstein, critique d’art et mémorialiste). Avisé, cultivé et compréhensif, Rothenstein admirait la vaste culture et la puissance intellectuelle de son invité. On parla de la guerre, de la trahison de la culture allemande par ses chefs, de « la proscription de la vérité » par les deux camps, des écrits de Gide, du travail du peintre et, en cette première période post-cubiste, de l’abstraction dans la peinture. Gide, toujours farouche en la matière, consentit à jouer du piano. Au menu également, promenades et baignades. Le poète John Drinkwater et sa femme Kathleen, actrice, étaient voisins 89. Ils passèrent dans la soirée du vendredi et reçurent Gide et Marc chez eux le dimanche après-midi et le soir du lundi. Durant les conversations à Iles Farm, Rothenstein fit une douzaine d’études de son visiteur français, dont certaines au crayon, d’autres à la sanguine. Plusieurs étaient du goût du modèle. Il pressa le peintre, qui avait vécu à Paris, d’y retourner faire le portrait de Proust et d’autres de [42] ses amis. Gide, écrivit Rothenstein, « avait un faciès mi-monacal, mi-diabolique ; il me rappelait des portraits de Baudelaire. Il y avait en lui un rien d’exotique. Il apparaissait en gilet rouge, veste de velours noir et pantalon beige, avec, à la place du col et de la cravate, une écharpe mollement nouée. Lorsqu’il nous quitta, il me manqua. La conversation, telle qu’il la pratiquait, si ardente, si profonde, me donnait la nostalgie de Paris90. »
Le mardi 13, après un départ matinal du Gloucestershire, ils revinrent à Grantchester, passant rapidement, entre deux trains, à Lancaster Gate. Le beau temps continuait. Il se pouvait bien que, comme Brooke le constata dans son poème The Old Vicarage : Grantchester, l’horloge de l’église du village fût arrêtée à trois heures moins dix, le temps passait nonobstant comme auparavant, Gide lisant, canotant, rencontrant les nombreux amis et connaissances des Strachey, et sans doute y avait-il aussi, à l’occasion, comme dans le poème, du miel au goûter. Aux Rothenstein, Gide expédia, le 16 août, une lettre de chaleureux remerciements :
Grantchester.
Cher Monsieur et ami,
Il faut pourtant que je vous redise encore quel exquis et durable souvenir j’ai remporté de Iles Farm, et de l’accueil charmant de Mme Rothenstein, et de la gentillesse de vos enfants, et de la beauté du pays, et de l’amabilité de vos voisins. Tout cela se tasse et luit au fond de ma mémoire et je n’y repenserais point sans nostalgie si vous ne m’aviez laissé l’espoir de vous revoir en France bientôt.
Le temps se maintient splendide, et hier avec Mme Bussy et Roger Fry nous avons été déjeuner sur l’herbe remontant en canoé la Cam…
Hélas, l’appel de la classe de Marc va mettre un terme à ces joies ; il fait un dernier effort, ces jours-ci, pour s’engager dans l’armée anglaise — mais sans grand espoir d’y réussir. — Il joint aux miens ses hommages pour Mme Rothenstein et ses salutations les plus cordiales pour vous tous.
Au revoir. Croyez-moi votre bien reconnaissant et affectueux
[43] André Gide.
P. Sc. Je reçois à l’instant le gilet vert. Merci ! — C’est un vieil ami qui m’a accompagné au cours de tant d’aventures lointaines, que j’aurais regretté de le perdre.
J’ai écrit au Mercure de vous envoyer mon essai sur Wilde et j’espère que vous le recevrez dans quelques jours91.
De temps à autre cependant des nuages jetèrent de l’ombre sur l’idylle. La nouvelle lui parvint de la mort, à la guerre, du fils aîné de Paul Desjardins92. Les lettres de Madeleine étaient curieusement rares, bien qu’il reçût une lettre rassurante de Domi Drouin. Marc, épris d’une subite demi-indépendance, courant désespérément la prétentaine, passant la plus belle partie de son temps, avec ou sans jeunes filles, dans ou sur l’eau, se montrait rétif parfois au travail ainsi qu’aux conseils de son mentor 93. L’idée de faire son service militaire en Angleterre, agréée par sa mère, faisait l’objet de sérieuses démarches. En principe du moins, les services de recrutement de Cambridge n’y étaient pas opposés. On faisait appel aux bons offices de Sir Maurice Bonham-Carter ainsi qu’à ceux de Gosse94.
Les leçons d’anglais continuaient à leur rythme quotidien. Cependant le trajet régulier des quelque trois kilomètres pour gagner Cambridge devenait ennuyeux et, le 19 août, Gide déménagea de nouveau, cette fois pour s’installer à « Merton House », Queen’s Road, maison de Harry Norton, qui était en voyage95. C’était une grande demeure ancienne, entourée de jardins tranquilles, qui avait été aménagée avec goût par son propriétaire. Gide se sentit immédiatement à l’aise dans son nouvel environnement : « De ma vie je n’ai été mieux installé, sinon sans doute à Cuverville ou à la villa », confia-t-il à son Journal le 2 septembre, et à Ruyters, le 21 août : « J’ai deux servantes à mes ordres. Je t’écris en face d’un Picasso dernière manière et d’un admirable vase persan, tournant le dos de mon mieux à une insondable bibliothèque, où la première édition du Traité des sections coniques voisine avec des premières éditions d’Élisabéthains. L’on me sert pour mon ordinaire un Mouton-Rothschild “78 qui [44] ravirait Eugène [Rouart]96. » Norton, mathématicien doué, qui enseignait à Trinity College, était un homme fortuné et avait été présenté à Gide par Lytton Strachey, dont il était un ami proche et qui lui avait dédié Eminent Victorians. Dorothy Bussy se souvint d’avoir rendu visite à son élève dans sa nouvelle demeure. « Je me rappelle être entrée dans l’antre du lion un pluvieux matin d’été […]. Je me souviens que vous m’avez lu une ou deux pages des Nouvelles Nourritures “pour me remercier d’être venue”, avez-vous dit, et que vous portiez votre veste de velours et que vous avez été particulièrement charmant. Et vous m’avez dit ensuite, quand nous nous sommes mieux connus, que vous aviez été extrêmement choqué par ma conduite inconvenante en osant rendre visite toute seule à un monsieur 97 ! » L’on jaugera le bien-fondé de ce sentiment de moralité outragée chez Gide, si toutefois il ne fut pas feint, en comparant son attitude, qu’évoque ici Dorothy Bussy, avec ses pratiques sexuelles auprès du petit Marsh.
À l’exception peut-être de sa femme, Gide écrivit peu à ses amis et correspondants en France. Ce fut avec Ruyters, tout proche à Londres, qu’il échangea peut-être le plus de missives, mais concernant les finances, l’achat de livres et leurs traductions respectives de Conrad surtout. Tandis que dans les deux librairies de Londres, « Edwards » et « Salby », Ruyters lui dénicha Smollett, Milton, Fielding et cherchait des éditions également belles de Herrick, Aubrey, Lyly, Richardson, Burton et Hafiz, Gide, lui, fit la découverte, à Cambridge, de Heffer’s : « un prodigieux bouquiniste : trois étages à fouiller […], j’y achète à bras raccourcis », s’enthousiasme-t-il98. Il s’y procure Bourdaloue, un joli Meredith et « tourne autour d’un très beau Roman de la Rose ». En peu de temps il se trouve lesté d’une mini-bibliothèque qui, dit-il, « va croissant et commence à m’embarrasser fort99 ». Autrement, Gosse, Bennett et Raverat étaient les destinataires les plus fréquents de ses lettres. C’étaient des jours consacrés surtout à la rencontre de nouvelles gens, au plaisir de la compagnie de Marc, à la joie de vivre plutôt que d’écrire (même dans son Journal), bien qu’à des moments de répit, un peu de son sentiment d’exaltante jouvence se laissât décanter dans l’esprit et — qui sait ? — peut-être aussi la lettre (les passages lus à Dorothy Bussy à Merton House ?) des Nouvelles Nourritures. Le 4 septembre, il y eut avec Marc un début d’excursion, vite écourtée par un boulon perdu, à Royston, en moto et side-car ; qui le [45] passager, qui le conducteur, on peut le deviner.
Le lendemain, ils partirent de nouveau pour Londres, couchant au 27, Craven Terrace, après avoir passé la soirée avec Wenz à la première des Femmes de bonne humeur des Ballets Russes au Coliseum. Ensuite, après être passé chez le prince Bibesco, prenant le train de nuit du vendredi 6 septembre, ils partirent pour une visite-éclair en Écosse où Beth Van Rysselberghe (alors âgée de 28 ans), après avoir quitté Swanley Horticultural College, travaillait, avec Ethel Whitehorn et Marie-Thérèse Muller, à « Laurel Bank », comme « farm-girl » sur une ferme à Drumeldrie, petit village du Fife, situé au-dessus de Largo Bay sur la côte nord du Firth of Forth. Ils couchèrent à l’auberge du village, accompagnèrent les girls au travail des champs et en tournée de lait, visitèrent les jardins du colonel Anstruther, propriétaire des lieux, mangèrent, comme dîner, du porridge avec de l’eau de pluie, causèrent surtout de leur diverses expériences anglo-écossaises100. Gide n’était pas indifférent au charme de Beth Van Rysselberghe et escomptait qu’il en serait de même pour Marc et réciproquement. « Avouez que ce que je lui montrais (à Marc) avait de quoi l’exciter. J’aime lui faire connaître des filles de cette qualité », observa Gide devant Mme Théo. « Tout le monde là-bas était fou de lui — et particulièrement les trois « farm girls « », rapporta-t-il à Copeau. Mme Théo imagina l’occasion comme « une chose inouïe », tant les différentes tensions d’âge et d’homo-hétérosexualité durent alors sensiblement s’entrecroiser101. Le mercredi 11, sur le chemin du retour, l’horaire ferroviaire accorda aux voyageurs assez de temps à Édimbourg pour voir le musée, l’université et le monument Nelson.
À cette époque de son séjour, Gide avait fait la connaissance de nombreux membres de la grande tribu fascinante des Strachey, « famille talentueuse, excentrique et pleine d’originalité, aux façons quelque peu farouches », comme devait les décrire un de leurs descendants102. Dorothy [46] était la troisième par rang d’âge des dix enfants. À part elle, Gide allait connaître surtout ses deux sœurs cadettes, Philippa (« Pippa ») et Joan Pernel, bien qu’il eût rencontré la sœur puînée Marjorie, fréquentât Lytton (nous y reviendrons plus loin), et fût plus tard redevable d’un service important (le contact entre lui, la N.R.F. et Freud) au plus jeune membre de la famille, James, ami, lui aussi, de Rupert Brooke. Il avait dîné, on l’a vu déjà, chez un autre frère, Oliver et sa deuxième femme Ray, y rencontrant Julia Strachey, fille d’Oliver par son premier mariage et qui devint la romancière de Cheerful Weather for the Wedding (1932). Philippa faisait activement campagne pour les droits des femmes. Joan Pernel enseignait le français en faculté à Newnham College et en devint le Principal. Tenant de leur mère, tous étaient francophiles, intellectuels et avaient une culture littéraire française étendue. Janie Bussy, fille de Dorothy, âgée de douze ans, était aussi présente à Grange Road. Un certain nombre de leurs connaissances et amis furent aussi présentés à Gide, parmi eux Beatrice Chamberlain (1862-1918), demi-sœur de Neville (l’homme politique) et amie de Dorothy depuis son enfance (elle mourra quelques mois plus tard), Jane Ellen Harrison (1851-1928), spécialiste des Grecs et Fellow de Newnham College, connue surtout pour ses Prolegomena to Greek Religion et son Themis (Constance Garnett, la traductrice de Dostoïevski, se souvint que, jeune professeur, Jane Harrison, avec ses boucles coupées court et son style de vie émancipée, avait été objet d’envie et de stupeur parmi ses élèves 103). Quelques mois avant de quitter la France, Gide avait finalement commis sur le papier, sous une forme succincte, mais essentielle, ses propres Considérations sur la mythologie grecque (NRF, sept. 1919, pp. 481-7), sujet cher à son cœur. Il rencontra Jane Harrison de nouveau à Paris pour discuter de la possibilité d’inscrire Andrée Mayrisch comme étudiante à Newnham, et elle assista ensuite, comme Joan Pernel, Lytton et, bien entendu, Dorothy, aux « Décades » de Pontigny104.
[48] Il rendit aussi visite à un autre « classiciste » de l’université, plus connu comme l’auteur de A Shropshire Lad, le poète A. E. Housman. Alors âgé de 59 ans, Housman occupait la chaire de Latin et était Fellow de Trinity College où il avait ses chambres. Gide le rencontra au collège, armé d’une lettre d’introduction de la part de Rothenstein, dont il était l’ami. Ce n’est que tard dans sa vie, lorsqu’il rédigea la préface à son Anthologie de la poésie française pour la « Bibliothèque de la Pléiade », qu’il évoqua leur rencontre :
En 1917 [sic], me trouvant à Cambridge, je fus aimablement convié à un de ces lunchs cérémonieux que donnent, régulièrement je crois, les membres de l’Université. L’aspect de l’immense salle où le repas était servi, aussi bien que la dignité des convives et leur costume, imposait aux propos un ton quelque peu solennel. M’étant mis fort tard à l’anglais, je le parlais alors très mal, le comprenais plus mal encore. Pourtant j’avais comme voisin de table A. E. Housman, dont un petit volume de vers, The Shropshire Lad, avait récemment fait mes délices. J’aurais pris plaisir à le lui dire […], je restais gêné, doutant même s’il comprenait le français et n’osant me risquer à le complimenter dans sa langue. Depuis le commencement du repas […] nous restions donc silencieux l’un et l’autre et ma gêne était près de devenir intolérable, lorsque Housman, se tournant vers moi brusquement, me dit enfin, en un français impeccable et presque sans accent : « Comment expliquez-vous, Monsieur Gide, qu’il n’y ait pas de poésie française ? […] Entre Villon et Baudelaire, quelle longue et constante méprise a fait considérer comme poèmes des discours rimés où l’on trouve de l’esprit, de l’éloquence, de la virulence, du pathos, mais jamais de la poésie 105 ? »
Et Gide, parti de la boutade sérieuse de son convive, de continuer, dans sa préface, à prolonger la riche conversation réelle d’autrefois en dialogue imaginaire avec Housman à propos de la nature et de l’évolution de la poésie française. Se remettant de son choc initial, l’invité jugea le poète « un esprit des mieux cultivés ». Housman semble avoir, de son côté, apprécié l’intellect de Gide, car il écrivit à Rothenstein qu’il aimerait le revoir, souhait qui ne semble pas avoir été exaucé.
À Londres comme à Cambridge, l’amitié des Strachey facilitait de nombreuses accointances. L’économiste Maynard Keynes, qui épousa la danseuse Lydia Lopokova, est une autre des personnalités de Bloomsbury à qui on le présenta. Plus tard il entra en correspondance avec lui à propos des droits de traduction de The Economic Consequences of the Peacepour la NRF106. Le 17 mars 1920 il déjeuna à Paris avec Keynes et son [49] ami le peintre Duncan Grant, autre membre du groupe, dont Gide avait beaucoup entendu parler, mais qu’il rencontra alors pour la première fois. En rapport avec Copeau et le Vieux-Colombier depuis avant la guerre, Grant devait soumettre des maquettes pour la production du Saül de Gide qui, finalement, lors de la représentation de la pièce en juin 1922, n’ont pas été retenues 107.
De retour d’Écosse, les voyageurs s’étaient attardés cinq jours dans la capitale, avec, comme quartier général, Craven Terrace de nouveau. Le jeudi 12, ils reprirent contact avec Davray et Gosse, assistèrent à une représentation de Carnavalde Fokine, aux Ballets Russes du Coliseum toujours, puis, ayant rencontré entre temps Diaghilev et Defosse, son chef d’orchestre, qui les invitèrent dans les coulisses, réassistèrent, le soir, aux Femmes de bonne humeur, en compagnie de l’impresario. En en sortant, ils se heurtèrent à Lady Ottoline Morrell, accompagnée du peintre Mark Gertler, d’Aldous Huxley et de Dorothy Brett. Sur quoi, tous allèrent rendre visite à Lydia Lopokova et à Leonid Massine, premiers danseurs, dans leurs loges. Lady Ottoline, soucieuse sans doute d’ajouter Gide à sa collection, ne le réussit vraiment qu’en 1920, lorsqu’il fit un bref séjour dans son manoir de Garsington, près d’Oxford. Le lendemain, et de nouveau le lundi 16, ils visitèrent, dans Fitzroy Street, le studio du peintre Nina Hamnett qui leur montra ses dessins, dont ils avaient déjà admiré plusieurs à Cambridge. Personnage pittoresque, elle devait revoir Gide plus tard à Paris, d’abord au café Parnasse, ensuite dans la chambre d’hôtel qu’elle louait en face de la Gare du Montparnasse où elle lui joua de la guitare et chanta des chansons anglaises 108. Le lundi 16 ils retournèrent aux Ballets Russes avec Lalla Vandervelde, l’amie de Roger Fry, voir en matinée La Princesse enchantée et Le Prince Igor109. Là, nouvelle rencontre [50] avec Diaghilev et Massine dans les coulisses, tandis que minuit les trouva à Chelsea, chez Aldous Huxley et Dorothy Brett. Diaghilev, Massine, Lalla Vandervelde, Fry et Nina Hamnett furent de la partie. Enfin, le matin du mardi 17, ils prirent le train pour le relatif calme de Grantchester.
Aldous Huxley eut l’impression que Gide « ressemblait à un babouin, avec la voix, les maniérismes et l’éducation d’un membre d’un Bloomsbury Group français 110 ». Bien que, en 1929, le romancier anglais envoyât un exemplaire dédicacé de son Do what you will à Gide « en reconnaissance des Faux-Monnayeurs et de Si le grain ne meurt », les rapports entre les deux hommes semblent avoir été tendus dès le début. Clive Bell, qui ne fit pas la connaissance de Gide lors de ce séjour à Cambridge, a décrit une rencontre bien plus tard avec lui, au cours de laquelle Gide s’enquit pourquoi Huxley l’avait qualifié de « faux grand écrivain ». Lorsqu’enfin Bell rapporta la chose à Huxley, celui-ci crut se souvenir qu’il avait jadis effectivement commis le mot dans un magazine d’étudiants 111. En maintenant, plus tard, qu’il y avait dans l’œuvre de Huxley quelque chose d’emprunté, dans les deux sens du terme, Gide pensait sans doute aux ressemblances qu’on avait cru remarquer entre Point Counter Point et ses propres Faux-Monnayeurs, qui précéda le roman anglais de quatre ans. Il estimait que, dans les écrits de l’Anglais, plutôt que l’expérience authentique de la vie vécue, c’était surtout le jeu intellectuel de l’intelligence de l’auteur qui se manifestait. Il concéda néanmoins que tous deux partageaient certaines préoccupations et, lorsqu’il examina l’œuvre de Huxley de plus près, conclut généreusement que toute ressemblance avec la sienne était « bien légitime et pas du tout plagiat 112 ». Il trouva Point Counter Point illisible cependant, et quand parut la traduction française, préfacé par Maurois, sa magnanimité ne l’empêcha pas de s’interroger si des modifications de l’original, « plein de démarquage de mes œuvres », n’avaient pas été pratiquées pour la différencier des Faux-Monnayeurs113. Au demeurant, il ne pardonna guère à Ruyters, et ce fut même l’un des motifs de leur brouille, d’avoir écrit à Drouin que « Huxley [51] vient de réussir le livre si complètement manqué par Gide114 ».
On peut noter que Huxley avait de l’œuvre de Gide une tout aussi piètre opinion, la qualifiant de « longue et calme masturbation littéraire d’un exquis », encore qu’il fût, comme l’on pouvait s’y attendre, impressionné par Les Faux-Monnayeurs lors de leur parution :
Gide est décevant […]. Il a la faculté d’aborder des sujets intéressants, mais sans jamais réussir à les saisir à bras le corps. Il s’attaque à de grands problèmes moraux, et avant même d’être entré en campagne bat une retraite littéraire avec une élégance du meilleur goût qui soit. Le seul bon livre qu’il ait écrit est son dernier : Les Faux-Monnayeurs, dans lequel il s’est vraiment aventuré à parler de la seule chose qui l’intéresse au monde : la sodomie sentimentale. À présent que Proust a donné au monde son vade-mecum des cités de la plaine, les autres sodomites sentent qu’ils peuvent, à l’abri de son précédent, prendre sa succession sans risquer le scandale. Jusqu’à maintenant Gide n’a jamais réussi à canaliser les sources de son énergie littéraire vers son œuvre ; ses écrits étaient coupés du courant principal de sa vie. Désormais les circonstances lui ont permis de faire usage de ce courant ; pour la première fois la roue de la création littéraire tourne. Le résultat est admirable 115.
L’opinion de Huxley sur Gide, concernant et son œuvre et l’identification de sa forme particulière de sexualité, peut être mise en question, mais il ne fait aucun doute qu’il tenait Les Faux-Monnayeurs en haute estime. Le roman ne constitue du reste pas la seule leçon qu’il apprit de Gide ; ayant reçu de lui une seule et unique lettre, il emprunta sa formule finale : « Bien sincèrement vôtre » pour toutes les lettres qu’il écrivit ensuite à des correspondants français qui ne lui étaient guère connus 116.
À l’encontre de Huxley, Roger Fry, dont il avait fait la connaissance chez les Strachey et chez Dickinson à King’s College au mois d’août, lui offrit sa sincère et ferme amitié. En compagnie de Dorothy et Janie Bussy et de Julia Strachey, Gide et Marc passèrent l’après-midi du 15 août avec Fry et sa fille à nager et à canoter sur la Cam. L’Anglais offrit alors à Marc, dont les lectures cambridgiennes semblent s’être limitées jusque-là à des contes d’Oscar Wilde, un exemplaire de Alice in Wonderland. Ils retrouvèrent Fry à Londres le 13 septembre, visitant avec lui, au 33 Fitzroy Square, les ateliers Omega qu’il avait fondés en association avec [52] Duncan Grant et Vanessa Bell et où, de 1913 à 1919, l’on fabriquait, d’après les dessins de ses amis peintres, petits meubles, textiles et céramiques. L’on y vendait aussi des tableaux. Plus tard, Gide et Marc séjournèrent, le temps d’un week-end — les 14 et 15 septembre, — dans la belle maison de Fry, « Durbins », à Guildford, dont il avait dessiné lui-même le plan et qui abritait une belle collection de tableaux, tandis que des sculptures d’Eric Gill ornaient le jardin. Fry fit un dessin de Marc. Marc flirta avec Pamela. Gide causa avec Fry. Telle fut l’entente entre Gide et Fry que Marc et lui furent réinvités pour le week-end du 21-22. Lowes Dickinson était aussi là. Fry commença le portrait de Marc. On joua au tennis, aux échecs, du clavecin. Ce fut à la suite de ce séjour que Gide rencontra le peintre Vanessa Bell, femme de Clive et ancienne amante de Fry117.
Fry était surtout l’ami de Dorothy et de Pippa Strachey, plutôt que de Lytton, plus jeune et avec qui il n’avait pas d’atomes crochus. Son épouse, en proie à une maladie mentale incurable, était hospitalisée dans un asile psychiatrique et il vivait avec Pamela, sa fille, lycéenne encore et qui avait le même âge que Marc. Fry et Gide étaient eux aussi du même âge à peu près, l’Anglais étant l’aîné de deux ans. Bien vite s’établirent entre eux une affable entente et une estime réciproque. Ils avaient un ami commun en la personne du comte Harry Kessler. « Cambridge a été un ravissement », écrivit Fry à Vanessa Bell, le peintre, sœur de Virginia Woolf, « surtout Gide, que je considère déjà comme un vieil ami. Nous avons surtout parlé littérature, mais il a des connaissances d’art aussi. Nous devons aller ensemble à Dulwich voir les Poussin, pour lesquels il a une passion 118. » Fry et les Bussy dînèrent avec Gide à Merton House, invités par Betty et Lucy Norton, les sœurs de Harry. Gide proclama son goût pour les peintures de Simon et admira sur les murs un Picasso et un Duncan Grant, achats du propriétaire. Depuis un an ou presque, Fry s’était attelé à la tâche de traduire les poèmes de Mallarmé. Aussi fut-il ravi de rencontrer non seulement quelqu’un qui partageait son admiration pour le poète, mais qui l’avait personnellement connu. Il soumit ses brouillons à Gide, pour qu’il lui fît part de ses commentaires. Lorsque, dans une édition posthume (Londres, 1936, p. 308), parurent les traductions de [53] Fry, y figuraient des remerciements adressés à Gide, Valéry et Pippa Strachey pour leur aide. Si brève fût-elle, cette période de travail en commun renforça leurs liens. Les connaissances de Fry en matière de littérature française étaient étendues. Il s’était lancé dans Proust, avait lu Romains, Bloch, Charles-Louis Philippe et Jouve, et était l’ami de Vildrac. Pour ce qui était de son interprétation de la poésie de Mallarmé, il ne se sentait nullement inférieur à son nouvel ami français : « André Gide », écrivit-il à sa sœur, « est en visite ici et j’ai eu le plaisir d’échanger des idées avec lui et de lui montrer mes traductions. À ma grande surprise, il ne semble pas être allé aussi loin que certains d’entre nous dans le déchiffrage des mystères complexes de l’art mallarméen 119. » Il est manifeste, lorsqu’on lit d’autres lettres de Fry, que sa rencontre avec Gide fut des plus importantes : « Gide a passé le dernier week-end ici. C’était un ravissement », ainsi fit-il part de son enthousiasme à Pippa Strachey, « c’est un grand événement pour moi. Je n’aurais jamais pu imaginer qu’il y eût quelqu’un dont la pensée correspondît si exactement à la mienne. C’est incroyablement stimulant et, quand il s’est assis au clavecin et a joué tous les vieux airs italiens comme nul autre avant lui, comme j’ai toujours rêvé qu’on les jouât, cela semblait trop beau pour être vrai 120. »
Dans des lettres à Charles et Rose Vildrac, il chante le charme de son nouvel ami, son libéralisme, sa haute opinion de la poésie de Vildrac. Quoique ses correspondants, qui considéraient Gide comme un réactionnaire proto-catholique, fussent sceptiques, Fry s’obstina : « Je ne le pense pas capable d’être réactionnaire. Si tel avait été le cas, aurait-il recherché la compagnie de gens tels Lowes Dickinson, qui est l’un de nos propagandistes les plus pacifistes et progressifs121 ? »
Fry peignit un portrait à l’huile de Gide avant qu’il ne retournât en France, de l’ébauche duquel Arnold Bennett lui persuada, à contre-coeur, de se défaire et que le romancier accrocha aux murs de son appartement de Cadogan Square. Fry fit cadeau du portrait à Gide ainsi que d’un petit livre de gravures sur bois. Les deux hommes entamèrent une correspondance qui, bon an mal an, dura jusqu’en 1927. Peut-être la première lettre de Fry fut-elle la suivante, en anglais, expédiée de « Durbins » le 26 décembre 1918 et que Denys Sutton ne reproduit pas dans son édition des lettres :
Mon cher Gide,
J’espère voir Marc en ville demain et lui remettre votre portrait et un [54] petit livre de gravures sur bois qui vous intéressera peut-être et que je souhaite que vous acceptiez comme cadeau de Noël ou du Nouvel An avec tous mes meilleurs vœux. J’aimerais beaucoup savoir ce que vous pensez de l’avenir en ce moment, ce que vous souhaitez pour la France et pour l’Europe. Les choses ont changé depuis que nous nous sommes vus pour la dernière fois. J’aimerais croire qu’elles ont changé pour le mieux. Ici et chez vous, je le crains bien, l’esprit de revanche et de haine semble se manifester encore plus rageusement que jamais et menace, s’il persiste, de détruire toute notre civilisation. Je désespère de plus en plus de tout futur dans lequel puissent exister des hommes sans préjugés ni passion, qui poursuivraient leur quête de la vérité et de la beauté et des choses qui importent vraiment. Je sens la barrière qui nous sépare de nos semblables. Ici, certainement, les choses prennent mauvaise tournure. On nous maintient dans l’ignorance ; nous n’avons pas plus de liberté que quand le danger était invoqué pour justifier l’absolutisme et on ne peut guère élever la voix pour protester. Il n’y a pas eu d’amnistie des prisonniers politiques et des objecteurs de conscience. Lloyd George a été joué par le Parti Conservateur et est leur esclave. En fait, notre seul espoir, c’est Wilson. Ce qui est étrange, c’est que nous ne savons rien de la France ; la France semble aussi muette et secrète que Tombouctou. Existe-t-il quelque chose d’autre ou le chauvinisme est-il le seul credo qui prévale ? C’est un monde cauchemardesque. J’espère me tromper dans mes craintes et souhaite avoir des nouvelles de vous qui m’apprendraient quoi que ce soit sur la situation, si cela est possible. Leonard Woolf, le mari de Virginia Woolf, dont je vous ai envoyé l’article, va fonder un Journal International à grande échelle et veut entrer en contact avec des écrivains français. Il doit être consacré aux questions internationales, traitées dans une optique internationale. Seriez-vous en mesure d’apporter votre aide et, si oui, puis-je vous mettre en rapport ?
Les Ballets Russes continuent et c’est la seule manifestation entièrement satisfaisante ici. Le dernier ballet, une série de contes de fées, mis en scène par Larionoff, est la chose la plus belle et la plus parfaite que je croie avoir vue sur scène. Je ne dis pas que c’est aussi génial que Le Sacre du Printemps, mais, dans son ensemble, c’est plus parfait.
Arnold Bennett a tellement aimé l’ébauche de votre portrait qu’il m’a persuadé de le lui vendre. J’espère que vous ne considérerez pas ceci comme déloyal. Je n’avais certainement pas envie de m’en séparer et j’ai quelques regrets de l’avoir fait, mais j’ai réfléchi que mes peintures s’accumulaient à un rythme alarmant et l’occasion de m’en débarrasser est plutôt rare. Je peins avec acharnement, autant que les courtes journées me le permettent et espère avoir fait du bon travail. Le portrait de la belle (la « trop belle ») Lalla est presque terminé et assez réussi.
Pamela est rentrée de pension et a beaucoup apprécié votre message à son intention. Nous avons quelque espoir de persuader Marc de passer un week-end ici avant son départ, mais je doute qu’il souhaite attendre. S’il le [55] fait, il verra aussi le mythique Julian et vous parlera de lui. Je pense que son esprit commence à se délier enfin. J’ai fait relier Les Nourritures terrestres en papier Omega et c’est du plus bel effet. Faites réimprimer d’autres de vos premières œuvres, je vous prie. Comme j’aimerais parler indéfiniment avec vous.
Votre,
Roger Fry122.
Il faut donc présumer que Gide avait offert à Fry ses Nourritures terrestres, dans la réédition de la NRF de 1917. Fry envoya à Gide The Mark on the Wall de Virginia Woolf. Gide lui fit parvenir en retour un volume de Léon-Paul Fargue, La Jeune Parque de Valéry, et L’Allemand de Rivière, qu’en dépit de certaines réserves Fry trouva excellent. Il pensait organiser une exposition d’art moderne anglais à Paris (il en avait déjà monté une en 1912) et demanda conseil à son ami. Quand Fry n’écrivait pas, Dorothy Bussy tenait Gide au courant de ses activités. Les deux hommes se rencontrèrent brièvement au début d’août 1920, quand Gide revint en Angleterre. Ils échangèrent de nouveau leurs idées sur Mallarmé123. En août 1921, une rencontre fortuite les fit presque littéralement tomber l’un sur l’autre sur la plage d’Hyères. Il y eut des contacts ultérieurs : le 9 avril 1922 à Paris, à la Villa ainsi qu’à l’hôtel de Lady Colefax ; la première semaine de septembre 1924124 à Chartres, et de nouveau à Dieppe le 1er novembre 1926. En partance pour le Congo, Gide ne fut pas présent à Pontigny, lorsque Fry, accompagné de Charles Mauron, assista aux « Entretiens » au cours de l’été de 1925125.
À propos de Charles Mauron et de ses écrits, les avis de Gide et de Fry divergeaient cependant. Fry le rencontra au cours de l’été de 1919 et le [56] jeune scientifique provençal devint peut-être son ami le plus proche, travaillant avec lui sur ses traductions de Mallarmé. Fry ne réussit pas à éveiller l’intérêt de Gide pour Mauron, qui, à l’exception d’une courte note publiée quelques mois après la mort de Fry dans La N.R.F. de décembre 1934 sur son livre Characteristics of French Art, ne fut jamais publié, non plus que Fry lui-même du reste, par la revue ou sa maison d’édition. Toutefois ce dernier défendit Gide contre les critiques de Marie Mauron et, dans une lettre à Gide du 27 septembre 1927, déclara : « Je ne peux m’empêcher de penser que l’immense et riche gisement d’expérience positive et authentique dans votre œuvre continuera à dégager des émanations comme le radium pendant bien plus longtemps que les fabrications astucieuses, mais terriblement invécues (excusez mon néologisme) de Valéry. De plus en plus je conçois l’art, non comme une prestation ou une compilation, mais comme le témoignage réussi d’une expérience vraie et que rien d’autre que cela n’a d’importance 126. »
C’était un beau compliment de la part d’un critique au sens littéraire des plus fins. Lorsque, au cours de l’été suivant son séjour cambridgien, Gide pensa rédiger, pour La N.R.F., une « Lettre à un Anglais », c’est à Fry qu’il songeait — mais, en dépit des encouragements de Rivière, il ne mit jamais son projet à exécution 127. Lorsque Fry mourut, des suites d’une chute, le 9 septembre 1934, Gide fut « très affecté 128 ».
L’amitié entre les deux hommes s’était nourrie frugalement, mais substantiellement de rencontres épisodiques et de lettres clairsemées. Néanmoins l’influence discrète sur Gide de ce pacifiste de souche quaker n’est pas à négliger. Son excellente appréciation de l’art, sa conception de l’intention morale captée dans une « forme signifiante », sa quête de la beauté et de la vérité pure, ses efforts, souvent couronnés de succès, pour rapprocher l’art anglais et français — tous ces aspects trouvaient un écho chez Gide et durent, à long terme, faciliter son abandon de l’engagement nationaliste et religieux vers lequel il avait penché pendant la guerre. La rencontre Fry-Gide, pour brève qu’elle fût, importa.
Celui, parmi les membres de la famille Strachey, qui eût pu intéresser le plus Gide était Lytton, bien qu’on ne puisse que spéculer quant à la fréquence de leurs rencontres cet été-là. Lytton avait alors trente-neuf ans. Les six mois précédents avaient comporté deux événements importants de [57] sa vie. Bien que résolument homosexuel, au milieu de l’hiver il s’était installé à « The Mill House », Tidmarsh, près de Pangbourne, pour vivre avec le peintre Dora Carrington une liaison complexe qui devait plus tard se terminer par sa mort et le suicide de la jeune femme — comme l’a illustré, en 1995, le film Carrington de Christopher Hampton. Au printemps il avait publié Eminent Victorians et préparait maintenant sa biographie de la reine Victoria. Dans ses allées et venues entre Tidmarsh et Londres, suite au succès immédiat de son livre, il avait passé quelque temps dans sa famille à Grange Road et rencontré brièvement l’élève de sa sœur. Assez curieusement, les deux hommes étaient entrés en relations plusieurs années auparavant, lorsque Lytton avait pris l’initiative de tenter de fléchir l’attitude du gouvernement français, qui voulait alors imposer son veto à la statue, jugée indécente, que le sculpteur Epstein avait conçu pour la tombe d’Oscar Wilde au Père-Lachaise. Méjugeant, chez l’auteur de La Porte étroite, sa répugnance puritaine pour tout ornement tombal, Auguste Bréal avait eu beau persuader Gide d’épauler Lytton dans ses efforts… Le 1er août 1912 la lettre suivante fut expédiée de Cuverville en Angleterre :
Monsieur,
Auguste Bréal me communique votre lettre. Déjà j’avais entendu louer l’œuvre de M. Epstein par M. Kenilworth qui s’intéresse beaucoup à ce monument. Un comité comme celui dont vous parlez n’est sans doute pas irréalisable, mais je ne puis m’en occuper personnellement — d’abord parce que je ne suis en relation avec aucune des personnes du gouvernement qui pourraient ici vous servir — puis parce que, par un goût personnel, je préfère au plus beau monument la simple dalle funéraire.
Recevez, Monsieur, avec mes regrets de ne pouvoir vous aider en cette circonstance, l’assurance de mes sentiments bien cordiaux.
André Gide129.
Fin septembre 1918, comme la villégiature de Gide approchait de son terme, Lytton lui écrivit pour l’inviter avec Marc et Dorothy à venir passer le week-end du 28-29 à The Mill House.
The Mill House
Tidmarsh
Pangbourne Sept. 22, 1918.
Dear Mr. Gide,
[58] I wonder if there is any possibility of your being able to come down here for the weekend next Saturday -- the 28th. My sister Dorothy is to be here then and it would be a great pleasure if you could come too. I don’t know whether Monsieur Marc ... (surname unknown) is with you now, and whether he could also come ; but if he could I should be delighted. Will you ask him? And tell him that Miss Carrington will be here?
This is not a difficult place to get at -- only about an hour from London.
Yours sincerely,
Lytton Strachey130.
Distrait, Gide fourra la lettre, non décachetée, dans la poche de son pardessus, l’y oubliant jusqu’au moment où il en fit la redécouverte le lendemain de son retour en France. Sa lettre à Dorothy Bussy du 18 octobre, la toute première de leur longue correspondance, exprime sa déconvenue et constitue un exemple intéressant de son anglais écrit et, sans doute, parlé, de ses « élucubrations de Cambridge. Un charmant curieux anglais », écrivit Dorothy, un anglais que l’on présume avoir été alors au sommet d’une perfection toute relative :
Dear friend,
Had I sooner got your address, you already would have received a letter from me. I wrote to Lady Strachey, last week, enquiring after it. (Just her kind answer reaches me). Welcome is your letter which restore the clue between us. Your account about that last supper party in Bloomsbury nettles my heart and my brain ; but nothing was more chafing for me than the discovery I made in the pocket of my overcoat, the first day of my return at home, of your brother’s letter, that letter you were speaking of and I told you I had not received, which was waiting in this cover I don’t know how long, unopened... a letter inviting Mark and me to meet you and to spend with you the weekend at Tidmarsh, so [59] kindly urging a letter that I couldn’t but yield to its prompting, had I only received it in due time. I answered it immediately, no more able, alas ! to accept. I did relate to Mark the whole story, and we both remain, he furious and I inconsolable ! “All is as God overrules” [...]131.
“Inch’Allah !” certes. À Lytton, Gide envoya une version moins exacte, mais plus diplomatique — et un tantinet irrévérencieuse — de son impair :
Cuverville
par Criquetot l’Esneval
Seine-Inférieure
29 sept. 1918.
Cher Monsieur,
Un contretemps absurde fait que je n’ai reçu que trop tard votre aimable invitation, alors que déjà tout était décidé pour mon départ. Le plaisir que je me promettais, de vous revoir, et Miss Carrington, était si vif que peu s’en fallut que je ne remisse mon voyage… Du moins croyez à la sincérité de mes regrets. Et pour me consoler je vous lis.
Si j’ajoute à mes regrets ceux de Marc, je ne pourrais plus fermer l’enveloppe…
Sincerely Yours,
André Gide132.
Une inconsolable Dorothy dut passer un week-end lugubre et pluvieux avec son frère et Carrington à la « Mill House », en l’absence de ses co-invités français, dont l’un lui devenait de plus en plus cher.
La lecture à laquelle Gide faisait allusion dans sa lettre à Lytton est, bien entendu, Eminent Victorians, qui, ajoutait-il, « est constamment en lecture sur notre table 133 ». Lytton avait demandé à Dorothy de faire des [60] approches auprès de Gide concernant la possibilité d’une publication éventuelle en français. Gide approuvait le livre, le chapitre sur Manning surtout, qu’il recommanda à son ami Jacques-Émile Blanche comme étant « remarquable et d’un intérêt extrême », tout en doutant que le livre du « bitter, brilliant Briton » — comme l’auteur fut décrit par ses éditeurs américains — plût à un public français 134.
En avril 1922, encouragé par Gide, Paul Desjardins, qui lui aussi avait visité Cambridge à l’automne de 1918, invita un trio de Strachey, Dorothy, Pernel et Lytton, à Pontigny pour la « décade » du 16-27 août 135. Deux mois plus tard, par l’entremise de Dorothy, Lytton reçut une invitation personnelle et particulièrement pressante de Gide :
Villa Montmorency
Paris XVIe
9 juin.
Mon cher Lytton Strachey,
Nous sommes plusieurs à souhaiter beaucoup votre présence à cette réunion d’« éminents » penseurs de pays divers, qui doit avoir lieu cet été — du 16 au 27 août — à l’abbaye de Pontigny (celle même où Thomas Becket trouvait asile). Deux de vos sœurs ont accepté d’y venir. J’aurais le plus grand plaisir à vous y voir et à vous présenter quelques amis qui ont un vif désir de faire votre connaissance, étant déjà de vos lecteurs et des meilleurs. Vous y retrouveriez également Middleton Murry et Marc Allégret. Sur un mot de vous, qui me dirait que vous acceptez, je vous enverrais aussitôt des renseignements complémentaires. Venez, je vous en prie. Je crois que vous ne vous ennuieriez pas.
Croyez à mes sentiments bien affectueux et attentifs.
André Gide136.
Dorothy déclina d’abord l’invitation, pensant qu’il était impossible de faire entrer Pontigny dans ses plans. Éventuellement sa sœur et elle assisteraient à la décade, mais sans Lytton. Tombée éperdument amoureuse de [61] Gide, depuis presque les premiers jours à Cambridge, ce fut vers la fin de leur séjour bourguignon qu’elle vécut l’un des moments les plus traumatiques de sa vie quand, tout à fait conscient de l’effet qu’aurait la nouvelle sur elle, il lui confia qu’Élisabeth Van Rysselberghe était enceinte de ses œuvres. Il choisit son moment avec soin, estimant que le décorum nécessité par le repas aiderait son amie à contrôler sa fureur jalouse. Elle n’en fut pas moins torturée par la colère et le désespoir 137.
Lytton remit à l’été suivant son acceptation, lorsque Dorothy le convainquit de s’y rendre avec elle. Gide écrivit qu’il était « très excité et épouvanté à l’idée de l’y voir. Il va nous trouver tous idiots 138 ! ». Il ne se trompait pas de beaucoup. Michael Holroyd, qui télescope la lettre de 1922 et la visite de 1923, a évoqué avec humour les journées pontignaciennes de l’essayiste anglais, où il trouva les petits déjeuners et les installations sanitaires aussi inadéquats que les discussions. La cordialité de Gide était aussi quelque peu déficiente, avait-il l’impression. Dans une lettre à Carrington qui, avec Barbara Bagenal, l’avait accompagné dans le voyage, mais était restée à l’hôtel à Vermenton-sur-Yonne, il nota : « Gide est désespérément inabordable. Hier soir, il a lu quelques pages d’un de ses ouvrages, d’une façon extraordinaire, comme un pasteur intronisant des litanies en chaire. On a beaucoup admiré 139. » Au milieu de l’hiver suivant, délai après lequel il avait sans doute eu le temps de se remettre, il écrivit à Gide « une lettre exquise », accompagnée d’un cadeau, le Nightmare Abbey (L’Abbaye des Cauchemars) de Peacock, manifestement, nota le destinataire qui saisit l’allusion, car il connaissait déjà et appréciait le livre, « en souvenir de Pontigny140 !!! ». Gide répondit :
4 février 1924.
Mon cher Lytton S.,
Je m’inquiétai de ne pas recevoir le livre annoncé (et merci de tout cœur), mais j’apprends ce matin qu’il m’attend depuis quelque peu à Cuverville où il fait la joie de ma femme et de quelques hôtes qui ne le connaissaient pas encore. Je vous remercie donc également de leur part. — Je goûte fort, pour ma part, la littérature de Peacock, qui n’a guère d’équivalent en France, sinon peut-être précisément nos séances de Pontigny. Elles ne pourraient, hélas, [62] être vraiment charmantes qu’aux dépens de cette gravité que veut y imposer Desjardins.
Je vous plains de si peu travailler — et je plains vos lecteurs. Mais je vous sais modeste et je sais également que l’apparente paresse cache souvent de secrètes germinations.
Au revoir. Croyez à ma fidèle sympathie.
André Gide141.
Par la suite le contact entre les deux hommes ne fut que sporadique et souvent indirect par l’intermédiaire de Dorothy. Peut-être la réserve de Gide, que Lytton ressentit à Pontigny, fut-elle imputable au refus de ce dernier d’écrire la préface à la traduction anglaise de La Porte étroite que Dorothy, d’abord à l’insu de l’auteur, avait terminée au printemps de 1919. Lorsque mourut Lytton, le 21 janvier 1932, Dorothy exprima le souhait que Jacques Heurgon, qui l’avait connu depuis Pontigny en 1923, écrivît une note nécrologique pour La N.R.F. À sa publication, et Gide et elle désapprouvèrent l’insistance simpliste que Heurgon mit sur l’iconoclasme anti-victorien de l’écrivain, tout en négligeant l’intérêt que portait Lytton à l’humain et à l’art du verbe. Il est vrai qu’Heurgon se racheta avec un texte plus long dans La Revue de Paris, ainsi qu’avec sa traduction française, un an plus tard, d’Eminent Victorians142.
À Cambridge, en 1918, la fin de l’été approchait et Gide se préparait à rentrer en France. Une malle-caisse ferronnée, remplie de livres, avait été envoyée chez Ruyters, qui allait la faire suivre à Paul Wenz qui, lui, s’occupa, via les bons offices de la Croix-Rouge, de la réexpédier au Havre. Un jour de la fin de septembre, le voyageur fit ses adieux à Dorothy à Londres. Pour elle, la venue de l’écrivain avait eu pour effet de changer totalement sa vie, qui, dit-elle, plus tard, aurait été « immensément appauvrie » si Gide était allé à Oxford plutôt qu’à Cambridge. Sa passion, son dévouement, sa coopération allaient aussi infléchir l’existence de Gide. C’est pourtant une marque d’affection très différente qu’il faut attacher à sa dernière visite à Jacques et Gwen Raverat. Ils avaient été la pierre d’achoppement de sa visite et cet au revoir de Gide allait être le dernier acte de son séjour. Il y avait aussi le précieux paquet de lettres de Rupert Brooke à rendre. Malheureusement les plans échouèrent.
Le jeudi 26 septembre, Marc devait retrouver Gide chez les Raverat, [63] s’y rendant directement de Cambridge. Gide, qui venait seul de Londres, se perdit à la gare de Liverpool Street, arriva à Baldock trois quarts d’heure plus tard que prévu et dut se rendre à pied à Weston. À sa grande surprise et découragement, il trouva « Darnall’s Hall » vide. Les Raverat ne savaient rien de ses intentions de visite. Tout allait mal. Le lendemain il devait traverser la Manche. Une grosse tempête s’était levée. Marc, de son côté, arriva, partagea avec lui un triste repas servi par la bonne, restée là pour garder la petite Elizabeth. Marc feuilleta un livre sur Degas. Gide glissa les lettres de Brooke dans un tiroir du bureau de Jacques et laissa également l’exemplaire de The Shadow of a Titan qu’il n’avait pas eu le temps de lire. Malgré leur curiosité, ils n’osèrent fouiner dans le studio de Jacques. Gide s’était promis le grand plaisir de discuter de Brooke, de Bloomsbury (que Jacques désapprouvait), de Cambridge et de tous ses nouveaux amis et connaissances anglais. Ne restait que de laisser un mot exprimant sa déconvenue et tentant une explication. Le peintre aussi passa des heures noires lorsque, de retour, il apprit le contretemps. Rien n’y fit.
Le lendemain, Ethel Whitehorn prêta assistance à Gide pour l’achat d’une paire de bottes et d’une cravate aux Army and Navy Stores avant de l’accompagner à la gare de Charing Cross. Il avait réussi à faire entrer quelques livres anglais supplémentaires dans ses bagages 143.
Le vendredi 27 septembre, il embarqua et gagna Cuverville où il avait l’intention de passer quarante-huit heures avant de pousser à Paris pour une dizaine de jours, projetant ensuite de regagner sa retraite normande jusqu’à Noël. La Symphonie pastorale restait à achever. À Cuverville, dans le courrier qui l’attendait, un « délicat manuscrit » d’un Jean Paulhan inconnu 144. Plongeant une main dans la poche de son pardessus, il en retira une enveloppe non décachetée contenant l’invitation de Lytton. Il rédigea une lettre d’excuses.
Dorothy passait son week-end solitaire à la « Mill House ». Marc était demeuré chez de Glehn à Grantchester, où il comptait passer quelques semaines encore et peut-être, grâce aux efforts (en fait infructueux) de Stewart et de Gosse, se faire attacher au Royal Flying Corps. Au début d’octobre, il servit d’agent de liaison entre Paul Desjardins, alors en mission académique en Angleterre, et les enseignants de la Perse School, où le visiteur universitaire fit un discours. Ensuite, alité pendant une quinzaine, à la mi-novembre, par la virulente « grippe espagnole » qui ravageait [64] alors l’Europe, et victime d’une rechute plus tard dans le mois, Marc resta en Angleterre jusque vers la fin décembre. Le 9 octobre, Dorothy, ne connaissant pas l’adresse de Gide, envoya à la N.R.F. sa première lettre à l’homme qui, par-dessus tous, comptera désormais pour elle. Il lui répondit le 18. Le 10, inconscient du désastre conjugal qui allait bientôt déferler, avait déjà à son insu déferlé sur son havre normand pour le submerger, âme sinon corps, il nota, plume détendue : « Au port depuis quelques jours 145. »
Sans aucun doute, son escapade anglaise l’avait rajeuni : « Ce qu’a été ce voyage, ce séjour en Angleterre », observa-t-il en écrivant à Roger Martin du Gard (qui se méfiait des Anglais comme de la peste), « je ne puis le dire. Vous l’imaginez !... Réussi au-delà de tout ce que j’espérais 146. » À Copeau, à qui, un peu penaud, il écrivit outre-Atlantique seulement le lendemain de son retour, il souligna le caractère proprement fantastique de son séjour : « Les trois mois que je viens de passer en Angleterre ont passé d’une manière si étrange, qu’à peine si je parvenais à me convaincre qu’ils étaient pris à même ma vie ; sans doute je rêvais 147. » L’approche de ses cinquante ans le faisait aussi penser à la mort. Il y avait beaucoup à faire. En dépit de ses efforts pour reprendre La Symphonie pastorale, la tentation de lire les livres rapportés d’Angleterre était constante. Il goûta la préface de Larbaud à la version française des Œuvres choisies de Whitman, qui comprenaient certains morceaux qu’il avait lui-même traduits. Il lut aussi Marvell, Congreve et Ode to Evening de Collins, mais surtout, de Browning, Prospice et Mr Sludge « the Medium ». « I duck and dive into Browning with the greatest amazement », écrivit-il à Dorothy Bussy, dans son meilleur anglais ornithologique. « How magnificent is such a poem as Prospice ! How piercing Mr Sludge (you know of course?). How fascinating [...]. I don’t remember to ever have feel so complete and satisfactory a delight in any English poet -- but Shakespeare148. » En revanche, la biographie de Browning par Chesterton l’agaça. Pour avoir une vue d’ensemble, il reprit les cent [65] premières pages du troisième tome de l’Histoire de la littérature anglaise de Taine, puis se replongea dans Browning : Ivan Ivanovitch, Bishop Blougram’s Apology, Saul, Fra Lippo Lippi, Andrea del Sarto, How They Brought the Good News from Ghent to Aix qu’il donna à lire à son neveu Domi de retour du front en congé de convalescence. Une strophe de By the Fireside le frappa à tel point qu’il pensa l’utiliser comme épigraphe à la deuxième partie de Si le grain ne meurt à laquelle il travaillait. Jusqu’au Two Years Before the Mast de Richard Henry Dana qui l’enthousiasmera 149.
Ce fut tandis qu’il préparait le matériel pour Si le grain ne meurt, à la mi-novembre, qu’il fut frappé par le coup le plus dévastateur de sa vie, qui découlait directement de son voyage anglais et, rétrospectivement, l’obombra. Depuis leur adolescence commune, sa femme avait gardé précieusement toutes les lettres qu’il lui avait écrites régulièrement, parfois quotidiennement. Désireux de vérifier une date dans l’une d’entre elles, il lui demanda s’il pouvait ouvrir son bureau. À sa grande surprise elle ne voulut obtempérer. Il lui demanda donc de vérifier la date à son loisir. Ce fut alors qu’elle lui révéla les avoir toutes brûlées. Abandonnée dans la grande maison après son départ pour l’Angleterre, et ayant lu la lettre dans laquelle il lui avait écrit qu’il pourrissait à ses côtés, elle avait sorti toute la correspondance, peut-être ce qu’elle possédait de plus cher, et, après avoir relu chaque lettre, l’avait brûlée. Madeleine savait qu’elle avait été trahie pour Marc à un niveau émotionnel profond. La destruction des lettres était un acte solitaire et irrémédiable de vengeance désespérée, qui la blessait autant qu’elle savait qu’elle blesserait son mari : « Mais pourquoi, pourquoi, lui ai-je dit ensuite. Comment as-tu pu faire cela ? Notre cher amour, tout notre passé, anéantis par toi ! Par toi ? » À sa question, elle répondit simplement : « J’ai tout relu avant de détruire […]. C’était ce que j’avais de plus cher au monde. » Accablé de désespoir, il pleura jour et nuit pendant une semaine. À son sens, les lettres brûlées alliaient le meilleur de son écriture au meilleur de son être : « le meilleur de moi », écrivit-il, « le plus pur de mon existence, le plus pur de mon cœur 150. » Elles étaient plus que des lettres d’amour ; il y avait tissé [66] les fils de toute sa vie émotive. Elles représentaient, pour reprendre ses propres termes, l’arche qu’il s’était construite contre le déluge du temps, le foyer incandescent dont ses livres n’avaient été que les flammes intermittentes. « Je suis mort il y a quelques années », confia-t-il à Roger Martin du Gard en décembre 1924, « quand j’ai découvert que ma femme avait brûlé toutes mes lettres pour mieux se détacher de moi, me rayer de sa vie 151. » Il tomba dans une noire dépression qui dura six mois et l’amena au bord de la folie et du suicide. Quoique, bien plus tard, il réussît à rétablir avec Madeleine un modus vivendi plutôt serein, la profonde harmonie de leur mariage, qui, comme l’on sait, n’avait jamais été consommé, fut irrévocablement viciée. Le plaisir de Cambridge, il s’en rendait compte maintenant, avait été acheté à un prix inestimable.
Du miroir brisé de l’idylle cambridgien seuls de rares éclats brillent dans ses écrits, colorés parfois de nuances étrangères. Peut-être le fait que l’écriture de son Journal était souvent une expression de son abattement, de ses doutes ou de son inertie explique-t-il le peu qui y fut consigné, une trentaine de lignes en tout, pour l’été de 1918, quand tout était nouveauté, exaltation, satisfaction des sens. Marc, pourtant, y tint, lui, une sorte de journal-agenda. Cependant il n’est pas impossible que certaines des pages du commencement des Nouvelles Nourritures que Gide donna au premier numéro de la revue dada Littérature (celles mêmes qu’il lut à Dorothy à « Merton House » ?), avec leur exhortation débridée à la rupture et au renouvellement de soi, portent l’empreinte des journées calmement exultantes de Cambridge.
Des influences anglo-saxonnes (Le Grillon du foyer de Dickens, la carrière des jeunes aveugles Laura Bridgman et Helen Keller) étaient déjà entrées dans la composition de La Symphonie pastorale, et il est tentant de penser que Gide y distilla aussi l’essence de Cambridge, qui se serait dissoute dans l’atmosphère alpine plus raréfiée du livre, directement inspirée par d’autres vacances, mais montagnardes et suisses, passées avec Marc en l’été de 1917152. Les « Backs » de Cambridge, comme l’avait remarqué [67] Larbaud, ne sont dénués ni d’harmonie pastorale, ni, parfois, de pasteurs. Le premier des deux « cahiers » du texte, celui qui est le plus pénétré d’illusion lyrique, fut terminé avant le départ pour l’Angleterre et c’est avec difficulté que Gide s’attela à la rédaction du second « cahier », s’astreignant à la lecture de Pascal et des Évangiles, afin de recapturer l’atmosphère du commencement et bâclant quelque peu la fin le 18 octobre, trois semaines à peine après son retour en France. Et pourtant on sait que Gide avait emporté le manuscrit en Angleterre, car c’est là qu’il a « montré le commencement » de son récit à Dorothy153.
Se peut-il que, dans cette deuxième partie, dans la différence d’atmosphère qu’il imagine régner d’une part dans la maison du pasteur, d’autre part à « La Grange » où déménage Gertrude, il y ait des échos de la différence entre le grave Cuverville et le pétillant ménage Strachey à Grange Road ? Gide escomptait-il, à Cambridge, pousser plus avant la rédaction de son texte ? L’a-t-il fait ? S’est-il en revanche contenté, au gré des courants de la Cam, de laisser mûrir en lui les multiples possibilités narratives ? Ou ne serait-ce pas plutôt que les journées anglaises coïncident avec la cassure qui s’ouvre entre la composition du « Premier Cahier » et celle du « Deuxième Cahier » de ce journal du pasteur qui prête sa forme au roman ? On peut supposer que les mots liminaires du Cahier II : « J’ai dû laisser quelque temps ce cahier », sont à la fois une expression de la vérité concernant la composition du récit par Gide et l’indice qu’aucune rédaction de la Symphonie ne se fit à Cambridge. Cambridge, pour lui, comme la pause dans le journal du pasteur, aurait constitué un calme hiatus avant la catastrophe à venir. Le parallèle ne peut guère être poursuivi plus loin, cependant. Dans la faille médiane de son journal, qui représente une lecture et non une écriture — reprise seulement ensuite — le pasteur qui a le privilège inhabituel d’être à la fois écrivain, narrateur, personnage et lecteur de son texte, se rend compte qu’imperceptiblement il est tombé amoureux de Gertrude. C’est à partir de ce moment-là seulement que sa conduite dégénère de l’aveuglement en mauvaise foi. Gide, en revanche, était depuis longtemps conscient de son engagement émotionnel envers Marc. Cambridge en était la concrétisation et aucunement une prise de conscience. C’est néanmoins la Symphonie, ce livre au titre ironique voire calembourdesque, qui nous montre à quel point Gide était conscient que l’altruisme pédagogique peut être entaché de pulsions sexuelles et que la liberté et le bonheur avec Marc ne pouvaient être acquis qu’au prix du chagrin de Madeleine.
Lorsque Gide se mit à écrire Les Faux-Monnayeurs, la correspondance [68] avec Dorothy Bussy était bien engagée. L’expérience de Cambridge et ses séquelles avaient pénétré bien avant dans ses strates mentales. Le roman comporte des réminiscences superficielles de l’Angleterre et ses suites. La découverte d’une correspondance compromettante et la destruction par le feu de lettres précieuses y apparaissent comme un leitmotiv obsessionnel 154. Comme Gide, le personnage central, Édouard, arrive d’Angleterre via Dieppe (on ne peut que supputer si Gide lut Le Grand Écart de Cocteau, comme Édouard lit La Barre fixe de Passavant pendant le voyage), mais au contraire d’Édouard, dont la première visite à Paris sera à un bordel, Gide n’eût pu prétendre avoir été sevré de plaisir sexuel outre-Manche155. Peut-être plus proches des sentiments ambigus de Gide à l’époque sont les lignes qu’Édouard consigne avec une certaine angoisse dans son journal, encore que le « soudain » soit de trop : « Je m’embarque demain pour Londres. J’ai pris soudain la résolution de partir. Il est temps. “Partir parce que l’on a trop grande envie de reste !... Ah ! si je pouvais ne pas m’emmener 156. » Les personnages de Laura et de Félix Douviers, ce dernier « petit professeur de français en Angleterre », qui prépare une thèse sur Wordsworth, semblent mêler inextricablement, d’une part Madeleine Gide et Dorothy Bussy, d’autre part Simon Bussy et Louis de Glehn, tandis que Bernard Profitendieu, dans son attirance et sa résistance envers Édouard, rappelle Marc Allégret, quand il n’évoque pas (dans sa lecture de textes anglais pendant deux heures chaque matin avec Laura, par exemple) Gide élève de Dorothy157. D’un plus grand intérêt cependant que la recherche de la bio-génétique des personnages dans Les Faux-Monnayeurs, est l’apparition dans le roman de deux courants de pensée nouveaux en ce qui concerne l’œuvre de Gide et qu’il est permis d’attribuer en partie à l’influence anglaise dans la mesure où ils découlent d’événements ou de rencontres ayant eu lieu à Cambridge : le féminisme et la psychanalyse freudienne.
Les Faux-Monnayeurs sont le premier ouvrage romanesque européen qui incorpore un cas de psychanalyse infantile, et même l’un des tout premiers romans, aux côtés du Némésis de Paul Bourget, de La Montagne magique de Mann, de La Conscience de Zeno de Svevo et du Chercheur d’âmes de Georg Groddeck, à exploiter la théorie freudienne à des fins d’analyse psychologique littéraire. Pour de nombreuses raisons, chauvinisme anti-allemand d’une part, catholicisme et rôle de la confession [69] d’autre part, la psychanalyse ne filtra à l’attention de l’intelligentsia française (et alors même d’une élite de rares intéressés seulement) que vers 1921. En Angleterre, pourtant, elle fut connue d’artistes et d’écrivains bien avant la Grande Guerre. Nombre de personnalités de Bloomsbury, notamment Virginia et Leonard Woolf, Fry, les Strachey, en étaient informés, sinon en détail, du moins quant à ses grandes lignes. James, le frère cadet de Dorothy, grand ami de Brooke, avait fait des études de médecine, puis les avait abandonnées pour devenir critique dramatique de The Athenaeum. Il s’intéressait aux théories freudiennes dès 1918 et, en 1920, allait se rendre à Vienne, avec sa jeune épouse Alix, pour se faire analyser par Freud et devenir ensuite son élève. Par la suite, et lui et Alix devinrent psychanalystes et il entama et enfin mena à bien la traduction et l’édition, en anglais — tâche monumentale — de The Complete Psychological Works de Freud158.
On ne sait si le sujet de Freud et ses théories fut abordé dans les conversations avec Fry ou les Strachey à Cambridge. Ce n’est pas avant le 2 juin 1920 que Dorothy écrivit en annonçant le départ de James pour Vienne afin d’étudier avec « le grand Freud en personne 159 ». Gide et James s’étaient rencontrés en 1918 et, lorsque le romancier revint passer l’été de 1920 en Grande-Bretagne, le nom de Freud ne put ne pas être évoqué dans le contexte des activités de James. Le printemps suivant, lisant Freud pour la première fois, dans une traduction française parue dans La Revue de Genève, il fut si passionné qu’il éprouva le besoin de le contacter personnellement sans attendre. Avec, admettons-le, une certaine naïveté, il entrevit la possibilité d’obtenir de lui une préface à une édition en allemand de son Corydon, son apologie de la pédérastie, traduction qu’il pensait pouvoir précéder l’édition française (les Allemands n’avaient-ils pas à Berlin l’Institut de Recherches Sexuelles du Dr Magnus Hirschfeld ?) qu’il n’avait pas encore osé livrer au public. C’est donc sans tarder qu’il écrivit à Dorothy en lui demandant de contacter James afin d’obtenir son avis sur le meilleur moyen d’entrer en relation avec Freud et sur le choix d’un livre de Freud pour une première traduction d’un de ses écrits par la N.R.F. Ce fut la longue réponse détaillée de James qui facilita la démarche de Gide auprès de Freud, renforça son intérêt dans la psychanalyse et fut à l’origine des nombreuses traductions de Freud publiées par les éditions de la N.R.F. Pendant un temps la psychanalyse rivalisa, dans l’esprit de Gide, avec le roman et l’autobiographie comme la voie royale pour la compréhension de la personnalité humaine. Plus tard, lorsque la [70] théorie de Freud, et notamment sur l’homosexualité, lui fut plus familière, il changea d’avis et, dans Les Faux-Monnayeurs, par le biais du personnage de la doctoresse Sophroniska et de son traitement des symptômes sexuels de Boris, l’enfant névrosé, il présenta le freudisme sous un jour nettement critique. Ce fut un aspect du roman qui amena E. M. Forster à très discrètement lui remontrer « que Gide était mal avisé de prétendre écrire des romans subconscients tout en y raisonnant si lucidement et longuement sur le subconscient même 160 ».
Si des hommes émancipés et des enfants libres étaient depuis longtemps des traits de l’œuvre de Gide, il n’en était pas de même des femmes, dont, au milieu de sa vie, il avait écrit que « les plus belles figures de femmes que j’ai connues sont résignées 161 ». À l’exception peut-être de la Wanda des Caves du Vatican, les femmes libérées ne font pas leur apparition dans ses écrits avant Les Faux-Monnayeurs. Son entourage ne manquait pourtant pas de femmes à l’intelligence vive et à l’esprit libertaire, Maria Van Rysselberghe et sa fille Élisabeth (elle-même fort marquée par des influences et des amitiés anglaises), pour n’en nommer que deux. La famille Strachey, quant à elle, était plus qu’un groupe comprenant un certain nombre de femmes intelligentes et émancipées, c’était un véritable foyer de féminisme militant. Philippa était la secrétaire de The London and National Society for Women’s Suffrage. Sa belle-sœur Ray était l’une des figures de proue du mouvement féminin. En sa qualité de professeur de langues modernes et plus tard Président de Newnham College, l’autre sœur de Dorothy, Pernel, occupait une position idéale pour propager les idées féministes dans un environnement intellectuel et pédagogique. Dorothy elle-même était une féministe fervente et, pendant toute sa correspondance et son amitié avec Gide, le confronta, parfois pour son grand inconfort, avec l’esprit du féminisme anglais. C’est une attitude qui est reflétée dans son roman, sous un jour parfois positif, parfois négatif, dans, par exemple, les personnages de Lady Griffith et de Sarah Vedel.
Gide portraiture Lilian Griffith comme une femme égoïste, éhontément amorale et arriviste, en apparence sophistiquée, mais sans profondeur : « De tels personnages sont taillés dans une étoffe sans épaisseur. L’Amérique en exporte beaucoup, mais n’est point seule à en produire. Fortune, intelligence, beauté, ils semble qu’ils aient tout fors une âme 162. » Le féminisme de Sarah Vedel, en revanche, même s’il n’est pas [71] uniquement limité à l’enrichissement de sa propre personnalité, est représenté comme vicié par un laxisme qui est né de sa réaction assez simpliste devant la sévérité répressive de son éducation morale. L’une des leçons du roman, exprimée sous forme de paradoxe, est qu’« il est bon de suivre sa pente, pourvu que ce soit en montant 163 ». Dans le cas de Sarah, il semblerait qu’il lui manque ce sens de l’élévation. Elle vient de rentrer d’un séjour anglais et Gide décrit son féminisme comme fortifié par l’influence de son amie et condisciple Miss Aberdeen (écho de l’expérience de Beth Van Rysselberghe aux côtés d’Enid McLeod et d’Ethel Whitehorn, sinon de la sienne propre aux côtés de Dorothy Bussy) :
Durant son séjour en Angleterre elle avait su chauffer à blanc son courage. De même que Miss Aberdeen, la jeune pensionnaire anglaise, elle était résolue à conquérir sa liberté, à s’accorder toute licence, à tout oser… N’avait-elle point, et sur n’importe quel sujet, ses opinions à elle, ses idées ? Sur l’égalité des sexes, en particulier ; et même il lui semblait que, dans la conduite de la vie, et, partant, des affaires, de la politique même au besoin, la femme fait souvent preuve de plus de bon sens que bien des hommes 164.
Éventuellement Sarah quitte la France pour l’Angleterre afin d’y vivre une existence plus émancipée. Toute la question de la libération des femmes sera traitée plus tard et en plus grand détail par Gide dans L’École des femmes et surtout sa troisième section, Geneviève165.
Mais peut-être Cambridge eut-il sur Gide une influence plus subtile et plus durable que les traces qu’on peut en discerner dans ses écrits postérieurs à 1918. La relative facilité avec laquelle il s’installa parmi Bloomsbury, ou du moins cette partie de Bloomsbury qu’il connut, était due en partie au fait que l’homosexualité, masculine ou féminine, y était, dans une large mesure, acceptée ou comprise. En outre, le cercle de Bloomsbury était, à quelques exceptions près (dont Raverat, mais qui se mouvait à l’extrême marge du groupe), pacifiste et socialiste, parfois d’une manière militante. En 1918, Gide n’était ni socialiste, ni pacifiste : « Pourvu que les socialistes de France, les pacifistes d’Angleterre (ils sont plus nombreux [72] que l’on ne sait ici) n’arrêtent pas le bras de Foch », écrivit-il à Ghéon, quelques jours seulement après son retour 166. Néanmoins, il est tout à fait possible que des germes aient été plantés dans son esprit au cours des discussions qu’il eut en Angleterre avec des hommes tels que Dickinson et Fry, ainsi qu’avec les Strachey eux-mêmes, qui furent ultérieurement responsables des changements progressifs qui se firent dans sa conscience politique et sociale au cours des deux décennies qui suivirent la guerre et dans son adhésion éventuelle au socialisme militant devant la montée du fascisme et du nazisme.
Bien que Gide eût trouvé à Cambridge plus de stimulants et de satisfactions qu’il ne s’y attendait, revenant « tout gonflé de choses à raconter » (même l’amère conséquence des lettres brûlées, la culpabilité, la colère et la détresse ne purent abolir le plaisir et le profit du séjour) et qu’il choisît de retraverser la Manche avec Marc de nouveau deux ans plus tard, encore une fois en 1937 pour voir les Bussy à Londres, et une fois de plus, vers la fin de sa vie, pour recevoir son doctorat d’Oxford, il n’éprouvait pas de véritable enthousiasme pour l’Angleterre, ne s’y sentait, comme il le confia à Martin du Gard, jamais vraiment à l’aise 167. Tout pivotal qu’il ait été dans sa vie sentimentale, intellectuelle et culturelle — financière aussi, puisqu’avec les traductions de Dorothy s’ouvrira peu à peu, pour ses écrits, le marché anglo-américain, — Cambridge n’inspira pas, à quelques rarissimes lignes près, de journal ou de carnet de voyage. Et pourtant la remarque d’Édouard, dans Les Faux-Monnayeurs, qui, lui, note dans son journal : « Ce journal s’arrêtait à mon départ pour l’Angleterre. Là-bas j’ai tout noté sur un autre carnet que je laisse, à présent que je suis de retour en France », ne nous intrigue-t-elle pas, avec l’hypothèse que, peut-être, de quelque fichier enseveli, refera surface, un jour 168… ?. La correspondance avec Rivière laisse entrevoir le vague projet, jamais vraiment poursuivi, de cette « Lettre ouverte à Roger Fry », qui peut-être eût traité — qui sait ? — du pacifisme, de l’art, des rapports intellectuels ou culturels entre la France et l’Angleterre. Deux ans plus tôt, il avait laissé passer l’occasion de répondre à l’article « La France et l’Angleterre ; l’avenir de leur relations intellectuelles », que Gosse avait fait paraître dans La Revue des Deux Mondes du 1er octobre 1916 et qu’il désapprouva en partie. Se cramponnant à un terrain plus familier, il préférera donner ses « Rapports intellectuels entre la France et l’Allemagne », [73] qui parurent en novembre 1921 dans La N.R.F. (pp. 513-21169). Décidément il se sentait mieux outre-Rhin qu’outre-Manche.
Et pourtant une certaine anglophilie, ou plutôt son enthousiasme certain pour la littérature anglaise, perce dans un projet dont il s’ouvrit à Schlumberger dès son retour :
Je voudrais savoir s’il y a à Paris une bibliothèque de livres anglais. Ne crois-tu pas qu’il serait opportun d’en fonder une et que nous pourrions à quelques-uns prendre l’initiative de cela ? L’argent nécessaire serait, je crois, très facile à trouver. Je suis tout prêt à donner l’exemple, pour réunir les premiers fonds […] et, moyennant une légère somme, ceux qui voudraient profiter des livres s’inscriraient et feraient partie de cette association franco-anglaise. Ils auraient le droit d’indiquer leur desiderata, à quoi l’on s’efforcerait de répondre 170.
Cette branche qu’il songe à greffer sur le tronc de la N.R.F. ne prendra pas, mais l’idée était belle et, comme l’indiquent les éditeurs de la Correspondance Gide-Schlumberger, si elle ne mena pas directement à l’ouverture, le 17 novembre 1919, de la librairie « Shakespeare and Company » de Sylvia Beach, 12, rue de l’Odéon (presque en face de la « Maison des Amis des Livres » d’Adrienne Monnier), activement patronnées toutes les deux par Gide, elle la préfigura d’une manière curieusement exacte. L’Ulysse de Joyce, pour un peu, eût été publié par la N.R.F.
Gide avait eu, à Cambridge, des fréquentations charmantes et gratifiantes ; il y avait rencontré plusieurs des hommes et des femmes les plus éminemment distingués et les plus originaux de l’époque, mais l’Angleterre était un pays auquel il était difficile de s’adapter. De surcroît, l’écrivain était sensible au fait que, et le public, et le monde de l’édition britanniques s’étaient montrés lents à s’adapter à son œuvre : « Certains pays », écrivit-il à Klaus Mann en 1936, « restent réfractaires à certains auteurs. C’est ainsi que je n’ai été accepté en Angleterre que très difficilement et seulement par carambolage de l’Amérique, où, au contraire, j’étais accueilli chaudement. Et pourtant j’avais en Angleterre d’excellents et nombreux amis 171. » Toutefois, il se peut que l’influence de l’Angleterre sur Gide et de Gide, à travers ses livres, sur l’Angleterre, se soit montrée d’autant plus durable qu’elle fut lente, de même que, sept ans plus tard, au plus profond du Congo, certains contours du paysage équatorial lui rappelleront la campagne écossaise 172. Attribuant au décor et à la vie [74] de l’Afrique du Nord les changements qui avaient métamorphosé sa jeunesse, il citait volontiers, de Lessing, le « Es wandelt niemand unter Palmen unbestraft ». Convenons qu’il est bien des lieux sur terre où l’on ne s’aventure pas impunément, dont — qui sait ? — les chemins de Grantchester, les méandres de la Cam et les pelouses des collèges de Cambridge.
1. Gide, « Avant-propos » à Si le grain ne meurt, ed. by V. F. Boyson, Oxford : Clarendon, 1925, p. 3, et Les Nouvelles Nourritures, dans Romans, récits et soties, œuvres lyriques, Paris : Gallimard, « Bibl. de la Pléiade », 1958, p. 258.
2. Cité dans Gide, Journal , t. I, 1887-1925, éd. Éric Marty, Paris : Gallimard, « Bibl. de la Pléiade », 1996, p. 1044 (30 oct. 1917), et t. II, 1926-1950, éd. Martine Sagaert, même éd., 1997, p. 217 (25 juillet 1930).
3. Voir P. Masson, André Gide, Voyage et écriture, Lyon : P.U.L., 1983.
4. Roger Martin du Gard, Journal, t. II, lettre à sa femme du 2 août 1928, et Correspondance Gide-Martin du Gard, Paris : Gallimard, 1968, t. I, p. 151 (5 juillet 1920).
5. Molière, Le Bourgeois gentilhomme, acte II, sc. 4, cité dans Dorothy Bussy, « Quelques souvenirs », La N.R.F., nov. 1951, p. 38.
6. Jean Delay, La Jeunesse d’André Gide, Paris : Gallimard, 1956-57, t. I, p. 318 et t. II, p. 450.
7. Claude Martin, André Gide ou la vocation du bonheur, t. I, Paris : Fayard, 1998, p. 454.
8. Gide, “The French Language”, dans From the Third Programme : A Ten Years Anthology, ed. John Morris, Londres, 1966, pp. 199-200.
9. Henri Ghéon--André Gide, Correspondance, Paris : Gallimard, 1976, pp. 745 et 768.
10. Voir Journal, t. I, p. 734.
11. Ainsi soit-il, dans Journal 1939-1949, Souvenirs, Paris : Gallimard, « Bibl. de la Pléiade », 1954, p. 1190.
12. R. Lhombreaud, Arthur Symons. A Critical Biography, Londres, 1963, p. 275.
13. Gide, « Avant-propos » à l’éd. citée de Si le grain ne meurt, pp. 4-5.
14. Gide, « The French Language », pp. 199-200.
15. Ainsi soit-il, p. 1190.
16. Je vais partir avec Rosenberg et Paul Laurens pour Londres où je ne resterai que quelques jours, le temps de laisser Madeleine ouvrir Cuverville « (lettre à Eugène Rouart citée dans le BAAG d’avril 1984, p. 306.
17. Voir Jacques Copeau, Journal, Paris : Seghers, 1991, t. i, p. 427, et Jean Schlumberger, « Vu de Londres », Échange(revue internationale, Paris), n° 2, 1945, pp. 57-65.
18. Correspondance André Gide--Arnold Bennett (1911-1931), éd. L. F. Brugmans, Genève : Droz, 1964, p. 12.
19. Paul Claudel et André Gide, Correspondance (1899-1926), Paris : Gallimard, 1949, p. 177.
20. Maria Van Rysselberghe, Les Cahiers de la petite Dame, t. I, Paris : Gallimard, « Cahiers André Gide 4 », 1973, p. 254.
21. Voir Lhombreaud, op. cit., p. 275. Née en Californie en 1864, Agnes Tobin était une amie intime d’Alice Meynell et était liée tout aussi bien avec des écrivains catholiques en France qu’avec des intellectuels catholiques britanniques. Ce fut Jammes qui la présenta à Larbaud, avec qui elle partagea un intérêt pour Coventry Patmore, en 1911 ; voir J. L. Brown, « Larbaud et quelques amis américains », dans Valey Larbaud : la prose du monde, 1981, pp. 195-8. Une photo, prise sans doute par Agnes Tobin, de Conrad, Mme Conrad, un de leurs deux enfants, Gide et Larbaud, dans le jardin de Capel House, est reproduite dans l’Album Gide, Paris : Gallimard, 1985, p. 137. Une lettre de Larbaud à sa mère, du 18 juillet 1911, publiée par Béatrice Mousli (Valery Larbaud, Paris : Flammarion, 1998, p. 183), balaye l’incertitude qui a régné jusqu’ici sur les dates de cette visite et l’ordre des événements. Voir aussi Cecily Mackworth, English Interludes, Londres 1974 ; Correspondence of A. Gide and E. Gosse, New York, 1959, p. 60 ; G. Jean-Aubry, Valery Larbaud, sa vie et son œuvre, Monaco, 1949, pp. 175-8 ; Valery Larbaud, Lettres à André Gide, La Haye, 1948, p. 154 ; Valery Larbaud--Marcel Ray, Correspondance, Paris : Gallimard, 1980, t. II, pp. 131 et 297 ; Gide, « Joseph Conrad », La NRF, déc. 1924, pp. 659-60.
22. Correspondance Gide-Gosse, pp. 87-8.
23. Jean Schlumberger, Madeleine et André Gide, Paris : Gallimard, 1956, p. 157.
24. Ivo Vidan, « Thirteen Letters of André Gide to Joseph Conrad », Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, vol. 24, 1967, pp. 151-4 ; Joseph Conrad, Lettres Françaises, Paris : Gallimard, 1929, pp. 113-23.
25. Voir Journal, t. I, pp. 733-6.
26. Voir Jean-Aubry, op. cit., p. 232.
27. Correspondance Gide-Gosse, p. 106.
28. Larbaud, Lettres à André Gide, pp. 77-8. Pour Larbaud et l’Angleterre, voir R. D. D. Gibson, « Valery Larbaud’s views of England », Humanitas : Studies in French Literature presented to Henri Godin, Coleraine (Irlande du Nord), 1983, M.L.A. de l’Irlande du Nord ; C. Mackworth, op. cit. ; Patrick McCarthy, Valeyr Larbaud, Critic of English Literature, thèse de l’Université d’Oxford, 1968 ; et la « grande biographie » de B. Mousli, citée supra.
29. Gide, Journal, t. I, pp. 818-9, et Correspondance Gide-Bennett, p. 86.
30. » L’une des premières formes sous lesquelles le monde extérieur se mit à parler à mes sens, c’est cette odeur mêlée de brasserie, de saumure et de tabac anglais que je respirais dans certains quartiers de Londres, le matin, par un beau jour, lâché par mon père que retenait ses affaires. Je n’avais pas beaucoup plus de douze ans. Et déjà je ressentais à fond « la concupiscence de la chair, le désir des yeux et l’orgueil de la vie ». « (Copeau, Journal, t. II, pp. 601-2).
31. Voir l’assez époustouflant récit qu’en fait Martin du Gard, Journal, t. I, pp. 468-82.
32. Gide, Journal, t. I, pp. 892-3, et Correspondance Gide-Bennett, p. 86.
33. Gide, Journal, t. I, pp. 868-9, et II, pp. 1011-2.
34. Les Cahiers de la petite Dame, t. I, p. 150 ; Enid McLeod, Living Twice, Londres, 1982, p. 40.
35. Les Cahiers de la petite Dame, t. I, p. 149-51.
36. Lettres du Lieutenant de vaisseau Pierre Dupouey, préface d’André Gide, Paris : NRF, 1922. Dupouey avait donné une traduction des Notes sur l’art et la vie de D. G. Rossetti (Chapelot et Cie, 1906).
37. Ghéon-Gide, Correspondance, p. 887 (2 juillet 1915).
38. Il s’agit du tout dernier texte que James devait écrire, sa préface au livre posthume de Brooke, Letters from America, New York, 1916.
39. Gide-Gosse, Correspondance, pp. 118-21 et 122-3 (mai-juillet 1915).
40. Jacques Cotnam, » Le « Subjectif » d’André Gide », Cahiers André Gide 1, Paris : Gallimard, 1969, p. 56. Voir aussi, pour les lectures anglaises de Gide en général, André Gide et l’Angleterre, éd. P. Pollard, Londres, 1986.
41. Cotnam, art. cité, pp. 62 et 70.
42. Journal, t. I, p. 909 (7 déc. 1915).
43. Journal, t. I, p. 1064.
44. Journal, t. II, pp. 515-56.
45. Journal, t. I, p. 1169, et II, p. 607.
46. Gide-Ruyters, Correspondance, Lyon : P.U.L., 1990, t. II, p. 154 (lettre du 22 mars).
47. Journal des Faux-Monnayeurs, Paris : Gallimard, 1927, p. 21.
48. Voir, pour les rapports Gide-famille Allégret dans cette période pré-Cambridge, le fascinant article de Daniel Durosay, « Les Faux-Monnayeurs de A à S — et Z », BAAG, oct. 1990, pp. 436-8 etc.
49. Nulle trace, pour l’heure, des quelques lettres échangées entre les deux hommes. De souche cosmopolite, parlant parfaitement l’anglais, le français et l’allemand, auteur de plusieurs textes pédagogiques, Louis von Glehn, ensuite de Glehn (1869 Sydenham - 1951 Grantchester) avait fait ses études à Brighton College et à King’s College de Cambridge avant d’être nommé, après deux postes précédents, à la Perse School en 1902, y poursuivant une brillante carrière de professeur de langues à la pointe de sa discipline, jusqu’à sa retraite en l’été de 1932. Personnalité cambridgienne très connue, et par ses théories pédagogiques (méthode directe et ludique) et ses talents d’acteur amateur, il était, en 1918, encore célibataire, n’épousant Marion Cassels qu’en 1920. Lorsque Gide parle donc dans sa lettre à Blanche du 26 juillet d’une « excellente famille », il englobe probablement, soit la sœur Rachel Marsh (née von Glehn) et ses enfants, en séjour à Grantchester pendant la belle saison, soit le frère peintre, Wilfrid de Glehn (1870-1951) et sa femme Jane, peintre elle-même. Pour Louis de Glehn, Gide n’avait que louanges, à la fois comme « excellent professeur » (lettre à Schlumberger du 2 août 1918) et comme homme. Pour de plus amples renseignements sur de Glehn et son entourage, voir, dans le présent numéro, mon article « Louis de Glehn et son milieu, Grantchester 1918 ».
50. Voir Gide-Schlumberger, Correspondance, p. 687. Le Rév. Hugh Fraser Stewart (1863-1948), professeur de français et Fellow de Trinity College (après avoir été « Fellow » et « Dean » de St. John’s College), était un spécialiste du romantisme français et de Pascal, sur lesquels il publia plusieurs études. Ami, via Pascal, de Paul Desjardins, Stewart collaborera avec lui dans la publication de French Patriotism in the Nineteenth Century (1814-33) Traced in Contemporary Texts, Cambridge : C.U.P., 1923. Avec sa femme Jessie, il assista, pendant de nombreuses années, aux Entretiens de Pontigny (où Gide a dû faire sa connaissance, du reste) et avant et après la Grande Guerre, voir BAAG, oct. 1997, p. 372.
51. Journal, t. I, p. 1065.
52. Schlumberger, op. cit., pp. 188-9.
53. Ghéon-Gide, Correspondance, pp. 929-30.
54. Schlumberger, op. cit., p. 189.
55. Journal, t. I, p.1070. Le mélange de détermination et de désarroi chez Gide, au moment de son départ, explique peut-être pourquoi Jacques-Émile Blanche se sentit si interloqué devant ce qu’il appelait, dans une conversation avec Maurice Martin du Gard, la déraison de son ami : « En 1918, vous l’ai-je raconté ? il m’arrive un matin en juin. Il est en ébullition : “Nous sommes perdus, cher Jacques-Émile, et Madeleine est toujours à Cuverville. Cette fois encore, elle ne voudra pas quitter la Normandie et c’est mille fois plus dangereux qu’en août 1914. Les Anglais naturellement vont laisser prendre Rouen. Aussi ma détermination est prise ; je pars pour Cuverville où je passerai avec ma femme les tristes années de l’occupation.” Je laisse mon travail, je sors avec Gide. Au moment des adieux, dans la rue, il m’embrasse, il pleure et, dans un hoquet : “Mon vieil ami ! Peut-être ne nous reverrons-nous jamais !” Trois jours après, je recevais une carte postale d’Oxford où André s’extasiait sur de “jeunes merveilles” qu’il venait de découvrir dans un collège. Ce cher André, c’est un fou ! » Mauvaise langue à ses heures, Blanche avait aussi mauvaise mémoire, puisque Gide était allé non à Oxford, mais à Cambridge, lui avait envoyé non une carte postale, mais une lettre (à moins qu’une carte ne soit perdue) et dans laquelle il n’y est fait aucune mention de « jeunes merveilles » ; voir M. Martin du Gard, Les Mémorables 1924-30, 3 vol., 1960, t. II, pp. 219-20 ; J.-Ém. Blanche, Nouvelles Lettres à André Gide 1981-1925, Genève : Droz, 1982, pp. 138-9 ; Correspondance André Gide--Ém. Blanche 1892-1939, Paris : Gallimard, « Cahiers André Gide 8 », 1979, pp. 226-7 et 339-40.
56. Gide-Schlumberger, Correspondance, p. 681 (lettre du 23 juin 1918).
57. Corr. Gide-Gosse, p. 155 (10 juin 1918) ; William Rothenstein, Men and Memories, Londres, 1932, t. II, pp. 343-5 ; Corr. Gide-Bennett, p. 90.
58. Gide-Schlumberger, Correspondance, p. 682 (lettre du 23 juin).
59. Corr. Gide-Gosse, p. 157 (31 juillet 1918).
60. Davray (1873-1944), critique au Mercure de France, traducteur de Wilde, de Wells et d’autres auteurs anglais, était alors le correspondant londonien du Petit Parisien. Jules Delacre, auteur de L’Offertoire (1905, Les Roses blanches (1906), Chant provincial (1913), tous publiés chez H. Lamertin à Bruxelles.
61. Katherine (Ka) Laird Cox (1887-1938), orpheline dès son entrée comme étudiante à Newnham College, devint une amie intime de Raverat qu’elle refusa pourtant, à plusieurs reprises, d’épouser. Elle eut un enfant, mort-né, d’une liaison subséquente et fort complexe avec Rupert Brooke. En 1918 elle épousa Will Arnold-Foster et séloigna ensuite de la plupart de ses amis de jeunesse.
62. Journal, t. I, pp. 869 et 1011-2.
63. Auguste Bréal (1869-1941), fils du philologue Michel Bréal, avait passé une année à Cambridge en 1887-88, en tant qu’étudiant orientaliste, mais se consacra ensuite à la peinture. Gide l’avait connu sur les bancs de l’École Alsacienne. Bussy et Bréal avaient été étudiants ensemble sous la direction de Gustave Moreau.
64. Assailli par une vague de nostalgie, Brooke avait écrit ce poème en 1912 à Berlin.
65. Journal, t. I, p. 1070.
66. Marc Allégret, « Notes prises en courant… », 7 juillet, infra p. 92.
67. Selected Letters of A. Gide and D. Bussy, Oxford : O.U.P., 1983, p. 35 (8 oct. 1919).
68. Corr. Gide-Bussy, t. I, p. 156.
69. Journal, t. I, p. 1070.
70. Journal, t. I, pp. 1070-1 (15 juillet 1918).
71. Les Cahiers de la petite Dame, t. I, p. 14. Pour une analyse de cet incident, voir mon « Gide à Cambridge 1918, Considérations géo-sexuelles », dans Le Désir à l’œuvre : André Gide à Cambridge, 1918, éd. Naomi Segal, à paraître chez Rodopi en 2000.
72. Corr. Gide-Bennett, pp. 93-4 et 97. Allusion au poème de Brooke, The Old Vicarage, Grantchester, dont les deux derniers vers, assez célèbres, sont :
Stands the Church clock at ten to three?
And is there honey still for tea?
(« L’horloge de l’église marque-t-elle toujours trois heures moins dix ? Et sert-on toujours du miel au goûter ? »).
73. Blanche, Nouvelles Lettres à André Gide, p. 139.
74. Journal, t. I, p. 1187 (3 sept. 1922).
75. Gide-Schlumberger, Correspondance, pp. 686-7.
76. Fragment de lettre publiée dans le BAAG, n° 27, juillet 1975, p. 59. Cette lettre du 19 août, en partie inédite, est reproduite en entier, avec l’aimable autorisation de Mme Catherine Gide, dans mon article, « Considérations géo-sexuelles, Gide à Cambridge 1918 », dans les actes du colloque Gide de Cambridge, cités supra, note 71.
77. Noel Annan, introduction à The Autobiography of Goldsworth Lowes Dickinson, éd. Dennis Proctor, Londres, 1973, p. xi ; voir aussi E. M. Forster, Goldsworthy Lowes Dickinson, Londres, 1934.
78. Correspondance Gide-Bussy, t. I, pp. 121, 191 et 199-200.
79. Les Cahiers de la petite Dame, t. I, p. 46. Pour les rapports et les lettres Gide-Forster-Dickinson, on consultera l’excellent article de Michael Tilby, « Gide, E. M. Forster et Lowes Dickinson », M.L.R., oct. 1985, pp. 817-32.
80. Correspondance Gide-Bennett, p. 95 (21 juillet 1918).
81. Blanche, Nouvelles Lettres à André Gide, p. 138.
82. Pour les imbroglios sexuels concernant Lytton, Carrington et autres, on peut se référer au film de Christopher Hampton, Carrington (GB/France, 1995).
83. Dans sa lettre à Blanche du 26 juillet 1918 (J.-Ém. Blanche, Nouvelles Lettres à André Gide, Genève : Droz, 1982, pp. 138-9), Gide dit y être allé le soir du 24, après Le Coq d’or, ce qui contredit les indications détaillées des « Notes prises au courant… » de Marc Allégret.
84. BAAG, juillet 1975, p. 59 ; Correspondance Gide-Gosse, pp. 157-8 (31 juillet 1918).
85. Gide-Schlumberger, Correspondance, p. 685.
86. Imperfect Encounter. Letters of William Rothenstein and Rabindranath Tagore 1911-1941, Cambridge (Mass.), 1972, p. 142 (4 déc. 1913).
87. Gide-Ruyters, Correspondance, t. II, p. 190 (lettre du 11 août).
88. Valéry-Gide, Correspondance, Paris : Gallimard, 1955, p. 474 (29 juin 1918).
89. Alors âgé de 36 ans, John Drinkwater (1882-1937), poète, dramaturge et acteur, avait abandonné une carrière dans les assurances pour le théâtre et la littérature. Co-fondateur du Birmingham Repertory Theatre, auteur de Poems 1908-14, il connut la célébrité, en cette même année 1918, avec sa pièce historique Abraham Lincoln. Les deux volumes de son autobiographie, Inheritance et Discovery (Londres : Benn, 1931 et 1932) ne le mènent qu’en 1913.
90. Rothenstein, Men and Memories, t. II, pp. 343-5 et, p. 324, la reproduction d’un portrait : « André Gide, dessin à la sanguine, coll. privée, États-Unis ». Voir aussi John Rothenstein, Summer’s Lease : Autobiography 1901-1938, Londres, 1965, p. 44, et William Rothenstein, Twenty-Four Portraits, First Series, Londres, 1920, où le portrait de Gide se trouve être le 12e des 24 illustrations, avec, en face, un texte non signé (mais de Gosse) le concernant.
91. Lettre autographe inédite, publiée avec l’aimable permission de Sir John Rothenstein et de Mme Catherine Gide.
92. Gide-Gosse, Correspondance, p. 160 (9 août 1918).
93. Gide-Bussy, Correspondance, t. I, p. 518.
94. Gide-Gosse, Correspondance, pp. 160-5.
95. Henry Tertius Norton (1886-1973). « Apôtre » et mathématicien, sujet à des crises dépressives, il dut prendre une retraite anticipée en 1920, à la suite d’une sérieuse dépression nerveuse.
96. Gide-Ruyters, Correspondance, t. II, pp. 191-2.
97. Gide-Bussy, Correspondance, t. II, p. 243 (10 oct. 1929).
98. Gide-Ruyters, Correspondance, t. II, pp. 182-8.
99. Ibid., p. 191.
100. Pour les détails, voir « Notes prises en courant… ». Le colonel William Egerton Edward Anstruther (1855-1925), M.V.O., D.S.O., Légion d’Honneur, avait servi en Afrique du Sud. Commandant des Second Life Guards, il s’était retiré depuis 1907 dans sa demeure de Charleton dans le Fife.
101. Les Cahiers de la petite Dame, t. I, pp. 8-9 et 421 ; Gide-Bussy, Correspondance, t. I, p. 115 ; Gide-Copeau, Correspondance, t. II, p. 197 ; Enid McLeod, Living Twice, pp. 40-1.
102. Barbara Strachey, Remarkable Relations, Londres, 1980, p.246. Voir aussi C. R. Sanders, The Strachey Family 1588-1932, Durham (North Carolina), 1953 ; Betty Askwith, Two Victorian Families, Londres : Chatto, 1971 ; Elizabeth French Boyd, Bloomsbury Heritage. Their Mothers and their Aunts, Londres : Hamish Hamilton, 1976.
103. Beatrice Chamberlain, directrice d’un collège de jeunes filles à Cambridge et qui mourut quelques semaines seulement après le retour de Gide en France, aurait inspiré, selon Richard Tedeschi, le personnage de Laura dans l’Olivia (Londres, 1949) de Dorothy Bussy, voir Corr. Gide-Bussy, t. I, pp. 106-7. Pour Jane Harrison, qui adopta comme amie intime son ex-étudiante de Newnham, la jeune poétesse et romancière Hope Mirrlees, voir Sandra J. Peacock, Jane Ellen Harrison, New Haven : Yale U. P., 1988, Les Cahiers de la petite Dame, t. I, pp. 214 et 430, et Jane Harrison, Reminiscences of a Student’s Life, Londres : L. & V. Woolf, 1925. Son livre le plus important était Themis. A Study of the Social Origins of Greek Religion, Cambridge, 1912.
104. Voir D. A. Steel, « Écrivains et intellectuels britanniques à Pontigny, 1910-1939 », BAAG, oct. 1997, pp. 367-94 (ill.).
105. Gide, Anthologie de la poésie française, Paris : Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1949, pp. 7-9.
106. La traduction française, par Paul Franck, qui parut à la N.R.F. en 1920, attira une critique assez acerbe de Paul Morand dans les pages de la revue (juin 1920). Le livre, qui malmenait la politique de revanchisme économique poursuivie par les leaders français lors du Traité de Versailles, devint par la suite, selon Roger Fry, l’objet d’une certaine gêne dans le milieu N.R.F. Voir mon article : « Les Strachey, Bloomsbury, Gide et le groupe de la Nouvelle Revue française », BAAG, oct. 1989, pp. 413-5, et Corr. Gide-Bussy, t. I, p. 175.
107. On peut voir une illustration des costumes imaginés par Grant pour Saül dans l’Album Gide, p. 153.
108. Nina Hamnett, Laughing Torso, Londres : Constable, 1932, pp. 130-2. Nina Hamnett (1890-1956) écrivit aussi un deuxième volume d’autobiographie Is She a Lady ? Elle fit des portraits de Sickert et de Gosse et fut elle-même le sujet d’un excellent portrait par Fry dont elle était une amie. Elle eut sa première exposition en 1926 à la Claridge Gallery.
109. Letters of Roger Fry, ed. Denys Sutton, Londres, 1972, 2 vol., t. II, p. 433, lettre à Philippa Strachey du 17 sept. 1918.
110. Letters of Aldous Huxley, ed. Grover Smith, Londres, 1969, p. 163 (lettre du 14 sept. 1918 à Juliette Baillot).
111. Bell, Old Friends, pp. 146-8. Gide cite l’expression de Huxley dans son Journal, t. II, p. 169 (30 nov. 1929).
112. Journal, t. II, pp. 169, 204, 263-5 et 554 ; Les Cahiers de la petite Dame, t. I, pp. 102 et 131.
113. Gide-Bussy, Correspondance, t. II, p. 290.
114. Jean Schlumberger, Notes sur la vie littéraire (1902-1968), Paris : Gallimard, 1999, p. 321.
115. Letters of Aldous Huxley, pp. 216 et 281-2 (à Robert Nichols, 2 juillet 1923 et 18 janv. 1927), et voir Norma Rinsler, « Aldous Huxley and French Literature : A Reconsideration », R.L.C., 1982, pp. 78-91.
116. Sybille Bedford, Aldous Huxley. A Biography, Londres, 1974, t. II, p. 106.
117. Voir Marc Allégret, « Notes prises en courant… », aux dates appropriées, infra pp. 110 et 111.
118. Letters of Roger Fry, t. II, p. 431. Il semblerait que cette excursion programmée pour le 14 septembre à la galerie de Dulwich College, dans la banlieue sud de Londres, fut empêchée par des contretemps ; voir les « Notes… » de Marc Allégret, infra p. 111.
119. Ibid., t. II, p. 432 (5 sept. 1918).
120. Ibid., t. II, p. 433.
121. Ibid., t. II, p. 444 (lettre à Vildrac du 9 févr. 1919).
122. Lettre autographe inédite, signée et datée, aimablement communiquée par Mme Pamela Diamand et publiée ici avec sa permission et celle de Mme Catherine Gide, auxquelles j’exprime mes remerciements. Le « mythique Julian » est sans doute une référence à Julian Bell, le fils de Clive et de Vanessa. « Lalla » Vandervelde (Hélène Speyer, 1870-1964), une exilée devenue l’amie de Fry, qui fit son portrait, avait pour deuxième mari le ministre socialiste belge Émile Vandervelde. Denys Sutton reproduit trois lettres de Fry à Gide, datées du 9 févr. 1919, du 15 déc. 1922 et du 27 sept. 1927. Des lettres de Gide à Fry je n’ai pu retrouver trace.
123. Letters of Roger Fry, t. II, p. 486 (lettre à Virginia Woolf du 10 août 1920).
124. Les Cahiers de la petite Dame, t. I, p. 117 ; Gide-Bussy, Correspondance, t. I, p. 342 ; Journal, t. I, pp. 1134 et 1257 ; Letters of Roger Fry, t. II, pp. 524-5 et 597-8.
125. Pour Fry à Pontigny, voir mon article : « Roger Fry et Charles Mauron à Pontigny », BAAG, oct. 1997, pp. 395-421 (ill.).
126. Letters of Roger Fry, t. II, pp. 616-7.
127. Voir Gide-Rivière, Correspondance, Paris : Gallimard, 1998, pp. 558 ; 561, 567 et 763 ; le projet prit parfois le titre de « Lettre ouverte à Roger Fry » (que Rivière écrit erronément « Frey »), p. 558, lettre du 20 juillet 1919.
128. Gide-Bussy, Correspondance, t. II, pp. 543-6 (12 sept. 1934).
129. Lettre autographe signée, archives du Strachey Trust, publiée ici avec son aimable autorisation.
130. Lettre autographe signée, inédite (Bibl. Doucet g 810-1), la seule de Lytton à Gide qui soit conservée dans le Fonds Gide, reproduite avec l’aimable autorisation de Mme Catherine Gide, M. François Chapon et l’Estate of Lytton Strachey. [Traduction : « Cher M. Gide, Vous serait-il possible de venir passer ici le week-end samedi prochain, le 28 ? Ma sœur Dorothy sera là et ce serait un grand plaisir d’avoir aussi votre présence. Je ne sais si Monsieur Marc… (dont je ne connais pas le nom de famille) est avec vous à présent et s’il pourrait se joindre à vous, mais s’il le pouvait, je serais ravi de l’accueillir. Invitez-le de ma part, je vous prie. Mlle Carrington sera des nôtres. Il n’est pas difficile de se rendre chez nous. Nous ne sommes qu’à une heure de Londres. Sincèrement vôtre, Lytton Strachey. »]
131. Gide-Bussy, Correspondance, t. I, pp. 93-4. À part cette lettre, les premières lignes de quelques lettres du tout début de leur correspondance et quelques expressions occasionnelles, Gide écrivait à Dorothy en français. De son côté, tout en ayant une maîtrise de plus en plus parfaite du français, elle lui écrivait, à l’exception d’une seule lettre, en anglais. Voir l’introduction par Jean Lambert de Selected Letters of André Gide and Dorothy Bussy, ed. Richard Tedeschi, Oxford / New York : O.U.P., 1983, pp. xxi-xxiii.
132. Lettre autographe signée et datée, archives du Strachey Trust, en partie inédite. Michael Holroyd, envers qui je reconnais ma dette pour ce qui concerne certains détails des rapports Gide-Lytton, en cite un fragment dans une note, p.737, de son excellent Lytton Strachey. A Biography, Londres, 1971, Harmondsworth (Penguin Bks.).
133. Gide-Bussy, Correspondance, t. I, pp. 93-4.
134. Gide-Blanche, Correspondance, p. 234 (lettre du 26 oct. 1918). En conséquence d’une lecture erronée d’un passage du Journal du 20 octobre 1918 (I, p. 1073), Michael Holroyd fait erreur en ce qui concerne l’avis de Gide sur le livre, voir son Lytton Strachey, p.737. Il fallut attendre la mort de Lytton avant qu’une traduction de Victoriens éminents parût à la N.R.F. en 1933, mis en français par Jacques Heurgon, sous le pseudonyme de Jacques Dombasle.
135. Gide-Bussy, Correspondance, t. I, pp. 341, 343 et 349.
136. Lettre autographe signée et datée, archives du Strachey Trust, inédite à part deux extraits cités par Michael Holroyd, op. cit., p. 859.
137. Les Cahiers de la petite Dame, t. I, p. 148. Pour ce séjour, voir Holroyd, op. cit., p. 859, et Steel, art. cité supra, note 103.
138. Gide-Bussy, Correspondance, t. I, p. 443.
139. Holroyd, op. cit., p. 860, et Steel, « Écrivains et intellectuels britanniques à Pontigny, BAAG, oct. 1997, pp. 385-7.
140. Gide-Bussy, Correspondance, t. I, p. 452.
141. Lettre autographe inédite, datée et signée, archives du Strachey Trust.
142. Jacques Dombasle (pseudo. de J. Heurgon), » Lettres étrangères » , La N.R.F., avril 1932, pp. 762-5 ; La Revue hebdomadaire, 23 juillet 1932, pp. 395-410 ; « Lytton Strachey », La Revue de Paris, oct.-nov. 1932, pp. 438-57 ; Lytton Strachey, Victoriens éminents, N.R.F., 1933.
143. Gide-Bussy, Correspondance, t. I, p. 118.
144. Gide-Paulhan, Correspondance, Paris : Gallimard, 1998, p. 22 (lettre du 10 oct. 1918) ; il s’agissait du manuscrit du Pont traversé.
145. Journal, t. I, p. 1071.
146. Schlumberger, Madeleine et André Gide, p. 190.
147. Gide-Copeau, Correspondance, t. II, pp. 196-7.
148. Journal, t. I, pp. 1071-4, et Gide-Bussy, Correspondance, t. I, pp. 94-5 [Traduction : « C’est avec émerveillement que je plonge et replonge au hasard dans Browning. Quelle merveille que ce poème de Prospice ! Et combien pénétrant Mr. Sludge (vous le connaissez, bien entendu). Comme c’est fascinant […]. Je ne me souviens guère avoir éprouvé un plaisir si complet et satisfaisant à la lecture d’un poète anglais — à l’exception de Shakespeare. »]
149. Journal, t. I, pp. 658-9. La N.R.F. d’avril 1921, pp. 417-61, donnera une traduction de Mr. Sludge par Paul Alfassa et Gilbert de Voisins, précédée d’un texte : « L’œuvre de Robert Brownin », signé des deux traducteurs et de Gide.
150. Schlumberger, Madeleine et André Gide, pp. 191-2 et 197. Voir également Et nunc manet in te, Neuchâtel, 1947, pp. 78-83. On remarquera que, dans son Journal du 29 mars 1906 (t. I, p. 515), cherchant nourriture pour alimenter La Porte étroite, Gide offre une évaluation littéraire différente de ses lettres à sa femme : « j’y contemple à nu tous les défauts de mon esprit », etc. On consultera aussi, de Pierre Masson, « Les lettres brûlées ou le chef-d’œuvre inconnu d’André Gide », BAAG, avril-juillet 1988, pp. 71-86.
151. Notes sur André Gide, Paris : Gallimard, 1951, p. 83.
152. Pour les sources anglo-américaines (auxquelles il faut ajouter, de Dickens aussi, Martin Chuzzlewit, voir BAAG, avril 1995, pp. 303-5), on consultera l’introduction de Claude Martin à son édition critique du récit, Paris : Lettres modernes, 1970. Assez curieusement, Gide associa ces vacances helvétiques, passées avec Marc en 1917, avec une vision imaginaire d’Oxford : « L’on aurait pu se croire à Oxford ou en Arcadie » (Journal, t. I, p. 1036, 7 août 1917).
153. Gide-Bussy, Correspondance, t. I, p. 106.
154. Romans, récits et soties, pp. 993, 1116 et 1133.
155. Ibid., pp. 957, 983 et 985.
156. Ibid., pp. 1031-2.
157. Ibid., pp. 970, 986 et 1077.
158. Holroyd, Lytton Strachey, pp. 648, 825 et 835.
159. Gide-Bussy, Correspondance, t. I, p. 190.
160. E. M. Forster, Aspects of the Novel, Londres : Abinger ed., 1974, p. 71.
161. Journal, t. I, p. 573 (16 juin 1907).
162. Romans, récits et soties, p. 1110. Citons, avec approbation, bien entendu, le mot de Lady Griffith : « Tu me rappelles certains Anglais : plus leur pensée s’émancipe, plus ils se raccrochent à la morale ; c’est au point qu’il n’y a pas plus puritain que certains de leurs libres penseurs » (p. 979) ; on soupçonne que Gide devait s’y reconnaître.
163. Ibid., p. 1215.
164. Ibid., pp. 1165 et 1216.
165. Voir, pour un développement de cette question, Emily Apter, « La nouvelle Nouvelle Héloïse d’André Gide : Geneviève et le féminisme anglais », André Gide et l’Angleterre, Londres, 1986, pp. 95-9.
166. Ghéon-Gide, Correspondance, p. 942 (lettre du 15 oct. 1918).
167. Les Cahiers de la petite Dame, t. I, p. 5.
168. Romans, récits et soties…, p. 1057.
169. Journal, t. I, p. 965 (9 oct. 1916).
170. Gide-Schlumberger, Correspondance, p. 689 (lettre du 17 oct. 1918).
171. » André Gide--Klaus Mann : Ein Briefwechsel », éd. M. Grünewald, Revue d’Allemagne, oct.-déc. 1982, p. 638.
172. Voyage au Congo, p. 801, et Le Retour du Tchad, p. 959, dans Journal 1939-1949, Souvenirs, Paris
Extrait de : BAAG, n° 125, janvier 2000, pp. 11-74.
Voir également : David Steel, "Antécédents gidiens", article disponible en PDF.
Daniel MOUTOTE
Gide et Uzès
Gide n’est qu’à demi l’enfant d’Uzès. Son œuvre n’est pas enracinée dans un terroir. On connaît l’apostrophe célèbre à Barrès :
Né à Paris d’un père uzétien et d’une mère normande, où voulez-vous, Monsieur Barrès, que je m’enracine ? J’ai donc pris le parti de voyager. 1
[6] Uzès sera une étape de ces voyages, et une étape privilégiée. Gide foncièrement fidèle n’a jamais renié aucune de ses deux origines. Il n’évoque jamais l’une sans l’autre, refusant d’opter pour l’une ou pour l’autre :
Entre la Normandie et le Midi je ne voudrais ni ne pourrais choisir et me sens d’autant plus Français que je ne le suis pas d’un seul morceau de France, que je ne peux penser et sentir spécialement en Normand ou en Méridional, en catholique ou en protestant, mais en Français et que, né à Paris je comprends à la fois l ’Oc et 1’Oïl, l’épais jargon normand, le parler chantant du Midi, que je garde à la fois le goût du vin et le goût du cidre, l’amour des bois profonds, celui de la garrigue, du pommier blanc et du blanc amandier. 2
Ou plutôt il ne voit l’une qu’à partir de l’autre, nullement déchiré, mais composant ainsi les deux côtés de son univers imaginaire, les deux faces de son Moi, inséparables et contraires, complémentaires vraiment :
Du bord des bois normands j’évoque une roche brûlante — un air tout embaumé, tournoyant de soleil, et roulant à la fois confondus les parfums des thyms, des lavandes et le chant strident des cigales. 3
C’est ainsi qu’il grave le blason d’Uzès, berceau de sa famille paternelle et paradis de son enfance :
J’évoque à mes pieds, car la roche est abrupte, dans l’étroite vallée qui fuit, un moulin, des laveuses, une eau plus fraîche encore d’avoir été plus désirée. J’évoque un peu plus loin la roche de nouveau, mais moins abrupte, plus clémente, des enclos, des jardins, puis des toits, une petite ville riante : Uzès — c’est là qu’est né mon père et que je suis venu tout enfant. 4
L’Uzès de Gide est presque tout entier dans ces quelques lignes : un nom musical, au bout d’une longue phrase comme la petite ville aimée au terme d’un pèlerinage, la paisible vallée où coule une eau fraîche, la roche abrupte, le pays paternel, le refuge d’un enfant poète, peut-être le meilleur de son âme.
Quand André Gide est-il venu à Uzès ? Cette question n’est pas sans embarrasser parfois le chercheur, soit que les récits qui évoquent Uzès datent d’une époque où l’homme était bien loin de l’enfant qui les avait vécus, soit que les documents se dissimulent au hasard du Journal ou des Correspondances de l’écrivain.
Le plus ancien souvenir d’Uzès est relaté à la seconde page de Si le grain ne meurt perdu dans les brumes de [7] l’enfance. André Gide le rappelle avec d’autant plus d’empressement que c’est un de ses premiers exploits, et des plus caractéristiques, ennobli d’ailleurs par un illustre précédent littéraire, celui de Stendhal : c’est le « grand coup de dents » dont l’enfant gratifie l’épaule de sa belle cousine de Flaux. « Je ne devais avoir guère plus de quatre ans ; cinq ans peut-être » 5 : confirmation de l’âge est donnée par l’Album de famille exposé à Uzès pour le Centenaire en 1969, où l’on pouvait revoir en particulier Mme de Flaux, et André Gide à quatre ans 6. Ce Premier contact eut donc lieu sans doute vers Pâques 1874, si l’on tient compte des indications que Gide donne par ailleurs :
Les vacances du nouvel an, nous les passions à Rouen dans la famille de ma mère ; celles de Pâques à Uzès, auprès de ma grand’mère paternelle. 7
… et longtemps encore, ensuite, nous retournions à Uzès, ma mère et moi, aux vacances de Pâques… 8
Il est malaisé de distinguer l’un de l’autre les premiers séjours à Uzès. Non seulement André Gide a du mal à localiser ses souvenirs : « comme je le disais déjà, je les situe moine aisément dans le temps que dans l’espace (…) » 9, mais encore le souci littéraire le porte au bariolage des temps dans Si le grain ne meurt. Tous les événements de son enfance à Uzès y sont réduits à l’unité d’une vision globale, aussi peu analysable que l’amour profond qu’il porte à ces lieux charmants. On peut rattacher à la petite enfance la promenade aux « abords du Gardon » dans le lit duquel il découvre « une flore quasi tropicale »… C’est la petitesse de l’enfant qui lui a fait voir la végétation si importante. De même la présence de Paul Gide, mort en octobre 1880, localise ces souvenirs avant cette date. Egalement celle de Charles Gide jeune, « un grand jeune homme aux cheveux noirs longs et plaqués en mèche derrière les oreilles, un peu myope, un peu bizarre, silencieux et on ne pont plus intimidant » 10. Ce souvenir est nommément rattaché, dit l’auteur, « au temps de ma première enfance ». D’après 1880 datent peut-être les souvenirs comme la remise en marche des pendules de grand’mère, si l’on en juge par l’attendrissement de cette dernière sur son petit-fils désormais livré en principe à lui-même et dont elle se plaît à saluer avec tendresse le savoir-faire : "Eh ! dites-moi, Juliette ! ce petit… » 11. Peu avant cette date, sans doute, les premières promenades avec Marie sur le « mont Sarbonnet ». Peu après, les promenades solitaires : « (…) je gagnais en courant la garrigue ». Le goût manifesté un temps pour l’entomologie peut dater du passage en cinquième au Lycée de Montpellier. Et il n’est pas certain [8] que les cures à Lamalou, puis à Gérardmer aient détourné André Gide et sa mère d’Uzès, au printemps de 1881, non plus qu’à la fin de l’année 1882 le séjour sur la Côte d’Azur, à Hyères et à Cannes.
Mais le premier séjour qui ait été noté immédiatement est celui du 14 au 25 avril 1889 12. Ce séjour studieux, lié à la préparation de la Nouvelle Éducation sentimentale, marque la naissance de l’écrivain et nous y reviendrons. C’est d’alors que datent les souvenirs célèbres sur la fontaine d’Eure et la garrigue :
14 avril.
Je revois Uzès (…). Cette après-midi course folle partout (…).
J’ai vu un endroit charmant près de la rivière (…). Je me souviens de m’être étendu sur une pierre plate (…) au ras de l’eau.
Il faisait très chaud ; le soleil avait chauffé la dalle — ma main plongeait dans l’eau très profonde. (…) sur la garrigue le vent soufflait (…) c’était un grand étourdissement.
Il revoit la grotte où, il y a deux ans dit-il, "j’avais lu René. Ce qui authentifie un séjour au printemps de 1887. En avril 1889, il note qu’il y a « lu quelques pages de Stello », ce qui date par ricochet la parenthèse sur le grenier où il passait son temps les jours de pluie : « C’est là que plus tard je lus Stello » 13. Il renonce bien vite à prendre des notes, tant il est requis par le charme des lieux :
Je renonce à transcrire la sensation au moment où elle m’émeut. L’esprit est distrait de l’émotion lorsqu’il l’analyse, et le charme est rompu.
Il vaut mieux s’abandonner tout entier aux choses présentes — à la perception seule rendue plus intense encore par le désir d’en jouir — et laisser plus tard l’imagination en évoquer l’ivresse toute transposée pour être décrite. 14
Le reste du séjour est vécu dans une ivresse sensible qui se passe de mots et laisse l’émotion se poétiser dans l’âme par le souvenir. Cette vibration poétique du moi gidien reparaîtra en 1916 dans le chapitre II de Si le grain ne meurt. Mais elle aura, entre temps, été transposée toute fraîche dans les paysages de Lamalou, de la Côte d’Azur, et plus tard de la Tunisie et de l’Algérie, pour Les Nourritures terrestres et Amyntas.
L’achèvement des Cahiers d’André Walter à Menthon-Saint-Bernard de mai à juillet 1890 écarte André Gide [9] d’Uzès en 1890. C’est le futur Pierre Louÿs qui assiste à sa place aux fêtes du sixième centenaire de l’Université, à Montpellier, où il rencontre Paul Valéry. Mais 1891 ramène André à Uzès. Il s’en excuse auprès de Valéry, donnant du même coup la raison des séjours : « Ma grand’mère que surtout nous allions voir à Montpellier s’en est revenue à Uzès » 15. Et surtout ce projet, qui prolonge peut-être celui de 1889 :
Combien de temps resterai-je là bas ? Je ne sais encore. J’y veux reprendre l’énergie qui relèvera ma tête et recommencer quelque noble travail que je rêve.
En fait, André Gide sera à Uzès durant la première quinzaine de juin 1891 et y préparera son Voyage d’Urien(16).
La note du Journal, page 30 : « 20 janvier (1892). A Uzès de nouveau » permet de préciser un souvenir de Si le grain ne meurt qu’André Gide reporte avec hésitation à sa « dix-huitième (?) année »(17) : c’est l ’heureuse mésaventure du jeune lecteur de Balzac qui oublie de changer de wagon, est remisé sur une voie de garage et n’a d’autre ressource que d’aller frapper à un mas du voisinage. Il tombe sur une famille chrétienne qui l’accueille comme un des siens à sa table et à son culte et l’héberge pour la nuit. L’auteur rapporte son étourderie à la lecture du Cousin Pons, ajoutant : « (…) ce jour-là, je le découvrais. J’étais dans le ravissement, dans l’extase, ivre, perdu… » Or le Cahier de lectures d’André Gide, tenu de 1889 à 1893, donne cette date sans erreur possible : « Le Cousin Pons (18 au 25) janvier 1892 » 18. Gide est en fait dans sa vingt troisième année.
Nouvelle visite a Uzès en octobre 1893, au départ du grand voyage pour l’Afrique du Nord avec P. A. Laurens :
Je suis arrivé à Uzès lundi soir, un jour plus tôt qu’on ne m’attendait ; j’aime mieux cela, car ma grand’mère en a vingt-quatre heures de moins d’inquiétude. C’est la première visite, je crois, que je lui fais tout seul. 19
Cette lettre déborde, non moins que d’humour sur la vieillesse de sa grand’mère, d’une tendresse qui explique rétrospectivement les voyages annuels à Uzès.
André Gide conduisit-il sa jeune ferme au pays de son père, quand, en octobre 1895, au début de leur voyage de noces, tous deux font un crochet par Bellegarde, où les Charles Gide les reçoivent dans leur propriété des Sources ? Il y a tout lieu de penser que ce pèlerinage aux sources s’en tint là 20. Nous serions tenté d’admettre que la mort de sa grand’mère marque, pour André Gide, le terme de ses séjours annuels à Uzès.
[10] Désormais ces passages ne seront plus qu’exceptionnels. Notons celui de 1903, qu’atteste une lettre à Marc Lafargue :
[…] cet été, une heureuse nécessité me rappela dans la petite ville d’Uzès, que je n’avais pas revue depuis douze ans. [En fait, dix !] Depuis bien plus longtemps encore, je n’avais plus entendu crisser les cigales. J’aime Uzès, comme vous pouvez aimer Toulouse ; à chaque pas j’y revois quelques souvenirs, dont les plus anciens sont ceux de ma première enfance. Située un peu à l’écart des trafic, Uzès s’est mieux préservée que d’autres villes, et mériterait plus que beaucoup d’autres d’être préservée. 21
Le dernier passage date de 1939. Gide en fait mention dans sa lettre à André Rouveyre du 4 février 1940 :
Oui, cette petite ville est charmante entre beaucoup ; les environs immédiats m’ont, hélas ! paru un peu abîmés lorsque j’y suis retourné l’an passé, en particulier les chemins qui descendent vers la Fontaine d’Eure et ce qu’on appelait la Fon di biaou. Me trompé-je ? Ou n’a-t-on pas donné à une rue ou à un boulevard le nom de mon oncle Charles Gide ? 22
L’éditeur ajoute que ce n’est qu’en 1944 que fut donné au boulevard le nom de Boulevard Charles Gide…
La présence d’André Gide à Uzès est ainsi largement attestée. Elle se situe de façon privilégiée pendant la jeunesse de l’écrivain. Voilà qui ne manquera pas de donner sa signification à Uzès dans l’œuvre et la pensée d’André Gide.
Faut-il regretter qu’Uzès ne tienne pas une place de premier plan dans une œuvre qui a noué tant de liens avec l’existence de son auteur ? Toute grande œuvre tend à l’universel. Même un Charles Gide, malgré le vœu qu’il avait fait de se fixer à Uzès, dut composer avec sa vocation d’économiste et se rendre à Bordeaux, Paris. À plus forte raison André Gide, qui, nouveau Fils prodigue, pratiqua et prêcha toute sa vie le « nomadisme » et restera sans doute comme le poète des départs et des quêtes lointaines, au-delà des horizons connus. Tout génie, [11] dans sa grandeur, et celui d’André Gide est éminent, a quelque chose de parfois monstrueux. Félicitons-nous qu’Uzès y occupe une place préservée, incarnant à la fois l’exigence et la poésie de l’enfance.
Tous les lieux qu’a connus André Gide sont liés à l’une de ses œuvres. C’est le propre d’une œuvre authentique, fondée sur une expérience personnelle, que de poser ses bases sur un sol connu. Les Nourritures terrestres sont essentiellement les poèmes de l’Afrique du Nord, de l’Italie et de la grasse Normandie ; L’Immoraliste est le livre de La Roque ; La Porte étroite, le livre de Cuverville ; Isabelle, celui de Formentin ; Les Caves du Vatican, celui de Rome et de Naples ; La Symphonie pastorale, celui de La Brévine ; Les Faux-Monnayeurs, le livre ce Paris… Chacune doit à un paysage ce que Gide nomme son « imagination », c’est-à-dire son cadre réel. De tous les lieux chers à Gide, Uzès est l’un des rares à ne pas avoir été lié à une œuvre de fiction. Sa part est plus secrète.
D’abord, Uzès fut bel et bien choisi pour être le lieu d’élaboration du second projet littéraire d’André Gide, la Nouvelle Éducation sentimentale, — le premier, comme on sait, Allain en préparation depuis 1887, devant en 1890 aboutir aux Cahiers d’André Walter. Dans les cahiers inédits de son Journal, André Gide note, à la date du 8 avril 1889, que l’Éducation sentimentale est encore à faire et qu’il compte en écrire à Uzès quelques pages « qui me demanderont moins de temps à composer que celles d’Allain ». La patrie de son père est un lieu de rigueur et de poésie, dont le futur écrivain attend un style :
Quand je relis certaines de mes pages, je m’en veux de les avoir écrites ; il faut que j’apprenne à ne rien dire que sous une forme qui me satisfasse.
Je veux la soigner à Uzès : écrire peu, quelques pages seulement, mais parfaites, sur des sensations qui me sont chères.
Je veux trouver des phrases frissonnantes, des chuchotements de mots qui murmureraient doucement comme les feuilles de saule au bord des rivières, alors que le soir tombe et que le vent s’élève… de ces sonorités étranges qui semblent des voix endormies dont on se souvient vaguement, comme dans un rêve et qui par le mystère des songes font trembler dans les secrets du cœur des larmes de deuils ignorés… 23
Il est facile de reconnaître la voix secrète d’Uzès, endormie au cœur de Gide, au cœur de l’écriture de Gide dans ces « chuchotements de mots qui murmureraient doucement [12] comme les feuilles de saules au bord des rivières, alors que le soir tombe et que le vent s’élève »… Ce sont eux que nous retrouverons à propos d’Uzès dans Si le grain ne meurt en 1916. Mais on reconnaît aussi dans ce projet la voix dolente d’Allain ! celle d’André Walter, qui est celle d’un André Gide décadent et toujours en deuil de son père, attentif à « ces sonorités étranges qui semblent des voix endormies dont on se souvient vaguement (…) des larmes de deuils ignorés »… Cette voix de sa poésie, André Gide la cultivera bientôt en Bretagne et ce sera celle des Cahiers d’André Walter. Mais l’autre, la voix d’Uzès, Gide l’élève, légèrement orchestrée de quelques harmoniques normands, dans Fragment de la "Nouvelle Éducation sentimentale", gui a été recueilli en tête de toute la production dans les Œuvres complètes d’André Gide en quinze volumes :
Il aimait, quand la chaleur était grande, descendre jusqu’à la rivière. La fraîcheur de l’eau l’attirait. Il savait un endroit, qu’il croyait connu de lui seul ; l’eau semblait y couler plus fraîche et plus limpide, sur un fond de sable que dorait le soleil ; du haut des coudriers qui l’abritaient tombait un grand mystère ; il lui semblait qu’en approchant très doucement, il pourrait surprendre je ne sais quelle intimité secrète, quel amour de fleur et de papillon… 24
La suite du texte, avec sa rêverie d’une « hamadryade se baignant toute nue sous les rameaux penchés » et la baignade du personnage « nu dans cette paix de la nature », n’a déjà plus la réserve qui est le charme d’Uzès dans l’œuvre d’André Gide. Elle annonce la poésie plus sensuelle des Nourritures terrestres. Mais la pureté de ce premier texte me semble se rattacher au thème uzétien de l’enfance préservée et pure, qui mettra une note si claire, en opposition à la perversité enfantine, dans le second chapitre de Si le grain ne meurt.. Cette Nouvelle Éducation sentimentale tourne court, et l’on en devine la cause : la sensualité, qui déjà trouble ce premier texte, devait s’épancher d’une manière plus dramatique dans les Cahiers d’André Walter et, se cultivant d’œuvre en œuvre, éclater avec la force que l’on sait dans les Nourritures terrestres. Mais il est bon de conserver dans l’oreille cette note si pure de son enfance que Gide entendit pour la première fois à Uzès et qui restera l’harmonique le plus irremplaçable de sa poésie. Toujours dans ses œuvres, même les plus troubles, au départ s’entendra un accent :
La brise vagabonde
A caressé les fleurs
Je t’écoute de tout mon cœur
Chant du premier matin du monde…
[13] Toujours paraîtra un enfant, comme Jérôme que blesse son équivoque cousine au début de La Porte étroite… Et ce sera, en contrepoint dans l’ardente symphonie poétique, la note gidienne par excellence, la note cristalline de l’enfance, celle d’Uzès.
Uzès reparaît dans l’œuvre à l’époque de la controverse sur l’enracinement. Sans reprendre ces textes célèbres, on se souvient qu’Uzès y est invoqué pour faire contrepoids à Paris et à la Normandie dans la supputation de ses origines à laquelle se livre l’écrivain, pour équilibrer le sang catholique et le sang protestant dans l’économie de son être spirituel, bref pour fonder sa liberté humaine. C’est bien à se libérer qu’il avait employé sa jeunesse, ainsi qu’en fait foi son journal, et il poussera cet effort jusqu’au grand manuel poétique de délivrance que sont Les Nourritures terrestres en 1897, puis contre Barrès et l’enracinement. D’où le recours à Uzès contre Cuverville et La Roque, durant toute la jeunesse. Uzès déprend de la Normandie et assume un rôle d’étape vers l’Afrique du Nord émancipatrice.
Mais plus profondément Uzès joue un rôle dans la vocation artistique d’André Gide, ainsi que ce dernier le reconnaîtra dans Si le grain ne meurt.. C’est en effet dans les « mémoires », comme on pouvait s’y attendre, que paraît pour la dernière fois une évocation importante d’Uzès dans l’œuvre. (On notera, par exemple, que pour l’anecdote la mention faite par Gide du nom, d’ailleurs étonnant, de ce bateau sur lequel il descend le Chari jusqu’au lac Tchad : le Jacques d’Uzès 25. Les « mémoires » ne sont pas tant qu’il veut bien le dire le récit naïf de son existence que la suite des efforts et des chances par lesquels s’annonce un libre esprit et se compose une personnalité d’écrivain. C’est pourquoi il les intitule Si le grain ne meurt, titre qu’il emprunte à l’Évangile (Jean XII, 24). C ’est moins un livre de souvenirs qu’une leçon de morale en action, où il y a plus de logique qu’il ne semble, en dépit de l’affectation de désordre. Ainsi après avoir rappelé que sa famille maternelle est normande, sa famille paternelle uzétienne, il commente :
Rien de plus différent que ces deux familles ; rien de plus différent que ces deux provinces de France, qui conjuguent en moi leurs contradictoires influences. Souvent je me suis persuadé que j’avais été contraint à l’oeuvre d’art, parce que je ne pouvais réaliser que par elle l’accord de ces éléments trop divers, qui sinon fussent restés à se combattre, ou tout au moins à dialoguer en moi. (…) les produits de croisement en qui coexistent et grandissent, en se neutralisant, des exigences opposées, c’est parmi eux, je crois, que se recrutent [14] les arbitres et les artistes. 26
Uzès fait donc entendre sa voix dans le dialogue intime de l’écrivain, entre comme composante ou pôle dans la personnalité ambivalente de l’artiste. Et l’on sait que ce dernier s’est plu à cultiver l’antithèse de ses deux origines, qu’il oppose par le parler, le goût, la religion.
Il les oppose aussi par la tendresse délicate et poétique qu’il a toujours gardée pour Uzès. Uzès est bien resté un lieu préservé de son cœur, le sanctuaire de son âme habituée pourtant à se pencher sur les abîmes intérieurs, et de son esprit habile pourtant à tourner en dérision les valeurs reçues. Dans l’universelle remise en question gidienne, deux êtres du moins sont restés et se sont éloignés sans qu’il y pût mordre : Em., son épouse et inspiratrice, et Uzès. Dans Si le grain ne meurt., après les aveux liminaires sur l’enfant pervers dans le chapitre I, le second chapitre s’ouvre comme une oasis de fraîcheur. D’abord l’arrivée à Uzès venant de Nîmes :
[…] c’était la Palestine, la Judée. Les bouquets des cistes pourpres ou blancs chamarraient la rauque garrigue, que les lavandes embaumaient. Il soufflait par là-dessus un air sec, hilarant, qui nettoyait la route en empoussiérant l’alentour. 27
Puis c’est la promenade au bord du Gardon, qui révèle un Paul Gide aimant la poésie. La description de l’appartement de la grand’mère est l’occasion de noter la bizarrerie de l’oncle Charles Gide, mais c’est pour mettre valeur Paul Gide qui « avait accaparé toute l’aménité dont pouvait disposer la famille ». Il y a certainement plus d’admiration que d’ironie sur l’austérité de Tancrède, comme le prouve l’anecdote de la nuit passée au mas dans une famille chrétienne. De même, malgré l’ironie légère sur la surdité, l’évocation à la fois tendre et admirative des vieux protestants d’Uzès. Et toute la gentillesse et même l’esprit dont est créditée la grand’mère qui « se mettait en quatre »pour son petit fils. On peut croire que, pour Gide comme pour Proust, par une mystérieuse tendresse, la grand’mère reste une figure sacrée de son enfance. De même enfin l’âme pieuse de Gide reporte sur le paysage environnant l’admiration respectueuse, un peu mystique, qu’il éprouve pour ses habitants :
J’aimais passionnément la campagne aux environs d’Uzès, la vallée de la Fontaine d’Eure et, par-dessus tout, la garrigue. 28
Longtemps dans l’œuvre, comme dans Les Nourritures terrestres, s’entendra le bruit des laveuses non loin [15] d’une petite rivière sous un ciel très pur dans une petite ville qui n’est pas nommée : c’est bien l’écho discret d’Uzès.
Quelle place tient donc finalement Uzès dans la pensée intime d’André Gide ? Uzès ramène à une couche première du psychisme gidien : à un type d’homme, à un paysage élémentaire et à la vertu fondamentale classique d’André Gide : la réserve.
Autant Gide a toujours regimbé contre l’autorité de sa mère, autant il a toujours aimé et regretté ce Père savant, humain et poète dont il rappelle que ses collègues l’appelaient Vir probus. Cette probité est la marque d’Uzès. Gide la vénère en son grand’père Tancrède Gide, quoique sous un masque de rudesse, et la porte jusqu’à la mysticité, dans le portrait admirable que lui en donne sa mère :
Elle m’en parlait comme d’un huguenot austère, entier, très grand, très fort, anguleux, scrupuleux à l’excès, inflexible, et poussant la confiance en Dieu jusqu’au sublime. 29
Sans doute André Gide ne serait-il pas sincère s’il n’ironisait pas un peu sur les excès de ce mysticisme, quitte à corriger en note ce que le trait a d’excessif, après une remise au point sans équivoque de son oncle Charles 30. Mais il étend cette confiance en Dieu, qui rappelle les temps bibliques, à Uzès et à sa région :
Certains s’étonneront peut-être qu’aient pu se conserver si tard ces formes incommodes et quasi paléontologiques de l’humanité ; mais la petite ville d’Uzès était conservée tout entière ; des outrances comme celles de mon grand’père n’y faisaient assurément point taches ; tout y était à l’avenant ; tout les expliquait, les motivait, les encourageait au contraire, les faisait sembler naturelles ; et je pense, du reste, qu’on les eût retrouvées à peu pris les mêmes dans toute la région cévenole, encore mal ressuyée des cruelles dissensions religieuses qui l’avaient si fort et si longuement tourmentée. 31
Le ton de respect auquel s’élève le texte au souvenir des persécutions montre que Gide, « le petit de Monsieur Tancrède », se retrouve aux côtés de ses rudes ancêtres :
Ceux de la génération de mon grand’père gardaient vivant encore le souvenir des persécutions qui avaient martelé leurs aïeux, ou du moins certaine tradition de résistance ; un grand raidissement intérieur leur restait de ce qu’on avait voulu les plier. Chacun d’eux entendait distinctement le Christ lui dire, et au petit troupeau tourmenté : « Vous êtes le sel de la terre ; [16] or si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? »
C’est à de tels souvenirs, au fond de sa conscience comme un granit cévenol, que Gide doit d’avoir été inébranlable dans son attitude contre les abus de son temps : les Grandes compagnies de Voyage au Congo en 1927, contre le stalinisme dans Retour de l’U.R.S.S. en 1936 et dans bien d’autres discussions morales redoutables qui sont au cœur des remises en cause de notre temps. Chaque fois qu’il est question de la liberté et de l’intégrité humaine, André Gide se dresse avec une force qu’on n’attendrait pas d’un artiste, ferme jusqu’au martyre et comme son Thésée capable de vaincre les monstres. C’est aux « tutoyeurs de Dieu » qu’il le doit.
Nulle pose d’ailleurs dans cette attitude. On connaît bien la tendre ironie sur le spectacle savoureux de la petite chapelle d’Uzès. Mais un bel exemple de ces « mégathériums » nous est donné par l’oncle Charles près de mourir, au cours d’un mémorable dialogue que son neveu rapporte dans son Journal. C’est sans doute le plus bel éloge de ce type d’homme sous l’humour de la peinture, qu’on peut lire à la date du 16 janvier 1932 :
Je retourne voir mon oncle, qui a beaucoup baissé depuis ma dernière visite. Je le trouve tout diminué par la fièvre. Mais son esprit reste toujours le même ainsi que son immalléabilité, si je puis dire. Cherchant quoi d’agréable à lui dire, à lui crier plutôt, car il entend de plus en plus mal, et tandis qu’il prend un peu d’orangeade — toute nourriture solide lui étant défendue :
— On en faisait de bien bonne à Uzès.
— De bien bonne quoi ?
— Limonade.
— Où ?
— A Uzès.
— Qu’est-ce qui t’a dit ça ?
— Mais personne ; je me souviens…
— Alors, qu’est-ce que tu en sais ?
— Mais c’est moi-même qui la buvais.
— Tu y es donc retourné ?
— Non ; je me souviens de celle que je buvais quand j’étais enfant.
— On ne faisait pas de limonade.
— Mais si ; je me souviens fort bien. C’était une limonade au riz.
— Pourquoi au riz ?
— Pour enlever l’âcreté du citron ; on faisait bouillir du riz et on jetait l’eau bouillante sur du citron coupé.
— Mais on ne faisait cela que pour les dérangements d’entrailles. Tu n’étais pas malade à Uzès ; pourquoi en aurait-on [17] fait pour toi ?
— Ce qui est certain, c’est que j’en ai bu et que je la trouvais très bonne.
Mon oncle finit par accorder que, en effet, ce n’était pas mauvais. 32
Je laisse à décider qui se révèle le plus têtu, de l’oncle ou du neveu. André Gide d’ailleurs constatera bien des fois qu’on le confond avec son oncle Charles Gide. Il fait suivre ce dialogue d’un commentaire qui est un bel éloge de cet esprit :
Toujours égal et conséquent et fidèle à lui même, il ne pouvait comprendre autrui que par la pensée et comprendre d’autrui que des pensées. Au demeurant fort capable d’émotions, et des plus sublimes et des plus vives, mais d’ordre général ; il restait on ne peut moins soucieux du particulier et de ce qui différencie. (…) Même l’amour et l’amitié devaient se dépersonnaliser pour trouver accès dans son cœur, qui ne battit jamais si fort que pour le collectif.
Ajoutons que la grand’mère, elle, compensait le goût du collectif par une attention toute particulière à la santé de son petit fils, en des repas particulièrement soignés, avec « quelque tendre aloyau aux olives…, un vol-au-vent de quenelles, une floconneuse brandade, ou le traditionnel croutillon au lard ». Ces gourmandises font aussi partie d’Uzès, comme un sourire sur toutes ces austérités.
Uzès, c’est aussi un paysage, et le plus profond de l’imagination d’André Gide. Paysage double, de douceur et d’austérité lui aussi. D’abord paysage d’eau, le plus connu peut-être :
La Fontaine d’Eure est cette constante rivière que les Romains avaient captée et amenée jusqu’à Nîmes par l’aqueduc fameux du Pont du Gard. (…) O petite ville d’Uzès ! Tu serais en Ombrie, des touristes accourraient de Paris pour te voir ! (…) Des terrasses de la Promenade ou du Jardin Public, le regard, à travers les haute micocouliers du duché, rejoint de l’autre côté de l’étroite vallée, une roche plus abrupte encore, déchiquetée, creusée de grottes, avec des arcs, des aiguilles et des escarpements pareils à ceux des falaises marines…
André se plaît à évoquer « la rivière à la Fon di biau », le moulin, une métairie, une sorte d’îlot, où il venait lire, « délicieusement assourdi par le ronflement de la meule, le fracas de l’eau dans la roue, les mille chuchotis de la rivière, et plus loin, où lavaient les laveuses, la claquement rythmé de leurs battoirs » 33. C’est le côté humain, vivant de l’univers d’André Gide, attentif à la fraîcheur de l’eau, de la luxuriance de la flore, au grand élan de la sève universelle.
[18] Mais il est un autre côté d’Uzès, plus typique, plus lié à la rigueur de la religion ancestrale : « la garrigue rauque, toute dévastée de soleil ». C’est là sans doute l’appel de la ferveur gidienne dans la symphonie intérieure des voix d’Uzès :
Mais le plus souvent, brûlant la Fon di biau, je gagnais en courant la garrigue, vers où m’entraînait déjà cet étrange amour de l’inhumain, de l’aride, qui, si longtemps, me fit préférer à l’oasis le désert. Les grands souffles secs, embaumés, l’aveuglante réverbération du soleil sur la roche nue, sont enivrants comme le vin.
Nous touchons là le tuf de l’imaginaire gidien, bientôt retrouvé dans les paysages d’Afrique du Nord que le poète des Nourritures terrestres et d’Amyntas devait chanter, avec la ferveur que l’on sait :
Âpre terre ; terre sans bonté, sans douceur ; terre de passion, de ferveur ; terre aimée des prophètes — ah ! douloureux désert, désert de gloire, je t’ai passionnément aimé. 34
Qui douterait que le désert matériel des Nourritures terrestres ne soit investi d’un amour qui en fait l’ardente poésie ? C’est l’épanouissement poétique de l’austère amour d’un autre « désert » qu’André Gide adolescent avait découvert dans les garrigues d’Uzès.
Car pour André comme pour Charles et pour tous les Gide, Uzès fut un refuge spirituel, un haut lieu de l’âme, le Désert enfin, comme le nomment les Protestants cévenols. Après les persécutions dont André Gide se crut victime au lycée de Montpellier en 1881, les vacances à Uzès étaient bien un tel Refuge. Uzès est également lié aux vacances. C’est pourquoi Uzès constitue une enclave printanière de paix dans l’existence d’André Gide. Une enclave d’affection et de fierté. Tout le monde ne bénéficie pas d’un grand’père comme Tancrède Gide, d’un père comme Paul Gide, d’un oncle comme Charles Gide. Si bien que même lorsqu’à la fin de sa vie André prit ses distances par rapport à la foi de son enfance, l’éminente dignité humaine de sa famille paternelle ne laissa jamais de s’imposer à lui. Et ce n’est pas désaffection, mais bien plutôt respect, si André Gide ne retourne plus guère à Uzès dans les derniers temps de sa vie. Uzès lui reste comme un sanctuaire lointain, comme son amour pour Em. Un peu comme un remords. Mieux même : il put avoir l’impression qu’Em. l’abandonnait après qu’il l’eut abandonnée. La mesure de sa douleur paraît dans Et nunc manet in te, en date du 1er juillet 1927 :
Le lent progrès du catholicisme sur son âme ; il me semble assister à la marche d’une gangrène. 35
[19] Rien de tel dans l’amour d’Uzès et d’André Gide. Il y retourne comme au Dieu de sa jeunesse dans Les Nouvelles Nourritures :
Je reviens à vous, Seigneur Christ, comme à Dieu dont vous êtes la forme vivante. Je suis las de mentir à mon cœur. C’est vous que je retrouve partout, alors que je croyais vous fuir, ami divin de mon enfance. 36
Reste de la religion, mais aussi de la pureté de son enfance, Uzès est pour lui un lieu que n’ont pas encore gâté les méfaits de la civilisation. « Il semblait que le progrès du siècle eût oublié la petite ville ; elle était sise à l’écart et ne s’en apercevait pas. » 37 Il risque même ce mot : « la petite ville d’Uzès était conservée tout entière ». Uzès est un ensemble de souvenirs ténus comme un rêve de Paradis : « Le son angélique des cloches », « Le chant micacé des cigales », « le claquement rythmé des battoirs », la voix de la grand’mère : "Eh ! dites-moi, Juliette ! », la lecture de la Bible, le Notre Père et le baiser du soir…
À mesure que le temps passe le rêve se laïcise. Signe des temps, il se matérialise et vire à l’écologie. Au temps du Retour de l’U.R.S.S., dans les Nouvelles Nourritures, André Gide remplace les regrets par la réprobation contre le gâchis qu’introduit l’homme dans son univers :
Mais ce que les hommes ont fait de la terre promise — de la terre accordée… il y a de quoi faire rougir les dieux. (…) O triste abord des villes ! laideur, désharmonie, puanteur… 38
C’est en ce sens qu’il faut entendre les regrets formulés par André Gide sur Uzès en 1939 : « Les environs immédiats m’ont, hélas ¡ paru un peu abîmés (…), en particulier les chemins qui descendent vers la Fontaine di biau et ce qu’on appelait la Fon di biaou. » Heureux serait-il, s’il revoyait Uzès en 1977, maintenant que ses concitoyens ont réparé les dégâts, donné son nom au chemin aimé, désormais la Promenade d’André Gide, et à la Bibliothèque Municipale, désormais Bibliothèque André Gide...
Uzès, petit trésor spirituel que se réserve une âme de poète dans le fond silencieux de son cœur, a laissé de soi un délicat symbole dans les dernières lignes qu’André Gide consacre à la maison de sa grand’mère dans Si le grain ne meurt. C’est le fameux morceau de la bille, que Gide a dû trouver assez significatif pour l’enregistrer. C’est ce morceau que nous pouvons entendre pour conclure, de la voix même de Gide, comme son ultime hommage [20] à Uzès et son adieu. En voici le texte :
Avant de quitter Uzès avec elle, je veux parler de la porte de la resserre, au fond de la salle à manger. Il y avait, dans cette porte très épaisse, ce qu’on appelle un nœud de bois, ou plus exactement, je crois, l’amorce d’une petite branche qui s’était trouvée prise dans l’aubier. Le bout de branche était parti et cela faisait, dans l’épaisseur de la porte, un trou rond de la largeur du petit doigt, qui s’enfonçait obliquement de haut en bas. Au fond du trou, on distinguait quelque chose de rond, de gris, de lisse, qui m’intriguait fort :
— Vous voulez savoir ce que c’est ? me dit Rose, tandis qu’elle mettait le couvert, car j’étais tout occupé à entrer mon petit doigt dans le trou, pour prendre contact avec l’objet. — C’est une bille, que votre papa a glissée là quand il avait votre âge, et que, depuis, on n’a jamais pu retirer.
Cette explication satisfit ma curiosité, mais tout en m’excitant davantage. Sans cesse je revenais à la bille ; en enfonçant mon petit doigt, je l’atteignais tout juste, mais tout effort pour l’attirer au-dehors la faisait rouler sur elle-même, et mon ongle glissait sur sa surface lisse avec un petit grincement exaspérant…
L’année suivante, aussitôt de retour à Uzès, j’y revins. Malgré les moqueries de maman et de Marie, j’avais tout exprès laissé croître démesurément l’ongle [86] de mon petit doigt, que d’emblée je pus insinuer sous la bille ; une brusque secousse, et la bille jaillit dans ma main.
Mon premier mouvement fut de courir à la cuisine et de chanter victoire ; mais, escomptant aussitôt le plaisir que je tirerais des félicitations de Rose, je l’imaginai si mince que cela m’arrêta. Je restai quelques instants devant la porte, contemplant dans le creux de ma main cette bille grise, désormais pareille à toutes les billes, et qui n’avait plus aucun intérêt dès l’instant qu’elle n’était plus dans son gîte. Je me sentis tout bête, tout penaud, pour avoir voulu faire le malin… En rougissant, je fis retomber la bille dans le trou (elle y est probablement encore) et allai me couper les ongles, sans parler de mon exploit à personne. [39]
1. L’Ermitage, février 1898. Recueilli dans Prétextes (Paris, Mercure de France, 1947), p. 45.
2. L’Occident, 15 juillet 1902, p. 64 (Prétextes, éd. citée, p. 61).
3. Ibid., p. 62.
4. Ibid., p. 67.
5. Si le grain ne meurt, Pléiade p. 350.
6. N° 8 du catalogue André Gide. Exposition du Centenaire, Ville d’Uzès : Musée Municipal, 12 juillet - 17 août 1969.
7. Si le grain ne meurt, éd. citée, p. 358.
8. Ibid., p. 376.
9. Ibid., p. 370.
10. Ibid., pp. 371-2.
11. Ibid., p. 382.
12. Carnet inédit, Bibl. litt. J. Doucet, gamma 1558, pp. 35-6.
13. Si le grain ne meurt, p. 382.
14. Ms. gamma 1558, p. 36 (inédit).
15. GIDE-VALÉRY, Correspondance, p. 81.
16. Lettres des 2, 5 et 11 juin 1891, ibid., pp. 88-93.
17. Si le grain ne meurt, p. 373.
18. V. le « Subjectif » d’André Gide, publié par Jacques COTNAM, Cahiers André Gide 1, p. 54.
19. Lettre d’André Gide à sa mère, Uzès, 10 octobre 1893, citée par Jean DELAY, La Jeunesse d’André Gide, t. I, p. 102.
20. V. Claude MARTIN, La Maturité d’André Gide, pp. 86-7.
21. Lettre d’André Gide à Marc Lafargue, 1903, inédite, citée par Geneviève DONNADIEU dans son mémoire de Maîtrise, André Gide et Le Bas Languedoc (Université Paul Valéry, 1969), p. 39.
22. GIDE ROUVEYRE, Correspondance, pp. 150-1.
23. Ms. gamma 1558, p. 34 v° (inédit).
24. O.C., t. I, p. 3.
25. Voyage au Congo, Pléiade, pp. 825-6 (28 et 30 janvier 1926).
26. Si le grain ne meurt, p. 358.
27. Ibid., p. 370.
28. Ibid., p. 380.
29. Ibid., p. 372.
30. Journal, 1932, Pléiade, pp. 1101-2.
31. Si le grain ne meurt, pp. 372-3.
32. Journal, 1932, Pléiade, pp. 1103-4.
33. Si le grain ne meurt, pp. 381-2.
34. Les Nourritures terrestres, VII, Pléiade, p. 238.
35. Journal 1939-1949, Pléiade, p. 1158.
36. Roman, récits…, Pléiade, p. 266.
37. Si le grain ne meurt, pp. 369-70.
38. Roman, récits…, Pléiade, p. 284.
39. Si le grain ne meurt, pp. 383-4. Disque André Gide vous parle, réf. FLD 4 M Festival (coll. « Leur œuvre et leur voix », publiée sous la direction de Georges Beaune).
Extrait de : BAAG, n° 34, avril 1977, pp. 5-21. Conférence prononcée le 19 février 1977 à Uzès pour le vingt-sixième anniversaire de la mort d’André Gide. De manière à faciliter la référence lors d’une réutilisation, la pagination de l’édition originale dans le BAAG est restituée par l’indication des chiffres de page entre crochets droits, sur le modèle :
[5] par exemple, placé au début de la p. 5.