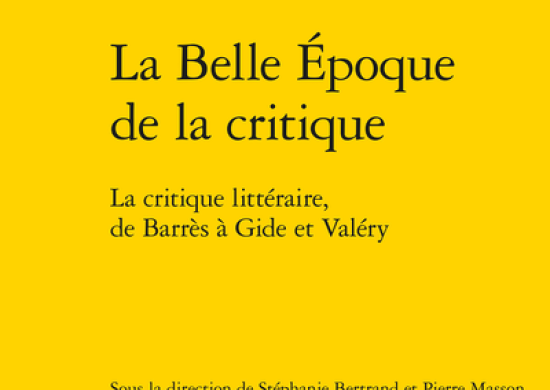L’enjeu des actes du colloque organisé à la Fondation des Treilles par Stéphanie Bertrand et Pierre Masson en 2022, réunis dans le volume La Belle Époque de la critique. La critique littéraire, de Barrès à Gide et Valéry, qui parait en cette fin novembre dans la « Bibliothèque gidienne » des Classiques Garnier, a été de saisir les stratégies des choix d’écriture, et de questionner la figure du critique littéraire : est-il « la meilleure incarnation de l’Intellectuel, dont on salue l’avènement en cette Belle Époque ? »
La critique littéraire, « produit du XIXe siècle », comme indiqué par les deux éditeurs, fut, pour écrivains et chercheurs, l’objet de longs débats sur le style d’écriture à employer pour offrir une interprétation, un jugement esthétique, d’où seraient absentes la légèreté et la subjectivité.
Évaluer, interpréter une œuvre n’est pas chose aisée ! C’est ainsi qu’à peine née, la critique littéraire, « forme supérieure » où se côtoyaient critique normative, historique, ironique, d’intérêt, d’intuition, de pénétration, de sympathie ou de sociabilité, fut menacée de disparition. Celle-ci balançait entre valeurs du passé et désir du présent. Quelques revues, parmi les trois cents qui existaient en 1900, résistèrent à un mouvement qui donnait place à l’immédiateté, et continuèrent à accueillir une critique qui se voulait approfondie, innovante, laissant une place de choix à Barrès, Péguy, Suarès, Proust et Gide, écrivains-critiques les plus influents de la Belle Époque. Cherchant ardemment le sens caché des créations littéraires, ces derniers imposèrent leur théorie « en matière de création et de critique ». Ils étaient lus par un public avide de mieux appréhender controverses littéraires et manifestes, alors que Péguy défendait l’idée que les écrivains bénéficient d’intelligences profondes que les non-écrivains n’ont pas.
La mouche, les orangs-outans et le critique :
Une belle époque sympathique ?
Chantal PIERRE
C’est par le biais de la fable animalière recomposée que Chantal Pierre va à la rencontre de « la nature sympathique de l’acte critique ». La chercheuse met en perspective la querelle sur l’impressionnisme critique au tournant des années 1880-1890, alors que Fernand Brunetière, attaché à la norme, est « contre la littérature personnelle », « facile », et pour un « devenir-scientifique » de l’expression critique. Elle partage les propos livrés par Brunetière qui expose son point de vue sur la critique dans la Revue des Deux Mondes :
[S]’efforcer d’être impersonnelle, et dans ses jugements ne pas plus se soucier des personnes, cela va sans dire, que de ses propres goûts, mais uniquement de la valeur d’exécution des œuvres, de leur signification et de leur importance dans l’histoire des idées et de l’art1.
Désireux de mettre en évidence le passé, Ferdinand Brunetière s’y adosse objectivement, et s’oppose tout particulièrement au dilettantisme et à l’individualisme d’Anatole France et de Jules Lemaître, qui incarnent pour lui un « devenir-artiste », reflet du présent. Adepte de la subjectivité, France décrète que la critique sympathique est « l’expression et l’affirmation de soi », même au sein des œuvres d’autrui. Il considère que le critique devrait dire :
Messieurs, je vais parler de moi à propos de Shakespeare, à propos de Racine, ou de Pascal ou de Goethe. C’est une assez belle occasion2.
Cette controverse mise en lumière par Chantal Pierre permet de réfléchir aux attitudes académiques ou spontanées – aussi recevables les unes que les autres. Cela même si le scientifique peut pencher tout naturellement vers une vision éminemment normative, et l’artiste préférer se référer à la mouche et à l’orang-outan, sinon se glisser dans la peau de Shakespeare pour penser la littérature. Pour le lecteur, place peut ainsi être faite à la relativité.
Chantal Pierre éclaire la pensée de Brunetière conservateur, qui tient à distance la critique sympathique, ne souhaitant être juge que par le biais de l’académisme. Posé, circonspect, sa vision anthropocentriste repousse « l’ironie, la description à vocation documentaire, l’écriture-artiste ». La chercheuse présente France, qui – avec humour – prône « une critique universaliste qui sort de la “caverne”, et tisse des solidarités entre générations et entre individus » aux côtés de Brunetière, armé d’une « critique égotiste située dans la caverne du Moi, limitée en sympathie », quand Lemaître regrette que celui-ci n’accorde pas aux écrivains français la sympathie accordée aux écrivains étrangers. La chercheuse explore la sympathie comme paramètre critique à articuler à la conception de l’œuvre littéraire, telle que pensée par les critiques. Elle convoque Remy de Gourmont, Adam Smith et Édouard Rod, expose les échanges fructueux qui ont cours dans cette période où règne une effervescence autour de l’écriture sympathique.
Pour clore cet article étoffé, Chantal Pierre a cherché au sein de La Revue blanche, « haut-lieu de l’individualisme », une trace de critique sympathique ; un seul et unique texte ressort, le roman naturaliste : Les Emmurés de Lucien Descaves. Le regard rapproché, rapporté – éloigné du gris, du terne, du froid – a permis d’appréhender finement un moment clé de la critique de la Belle Époque.
De l’écriture critique à la chronique littéraire,
le journalisme comme espace d’invention du « moi barrésien » (1883-1888)
Séverine DEPOULAIN
À la fin du XIXe siècle, la carrière littéraire d’un écrivain est indissociable de la pratique journalistique et de la critique littéraire, rappelle Séverine Poulain, qui choisit de réfléchir à une réussite littéraire, marquée par l’écriture critique.
Les premières études critiques de Maurice Barrès portent sur des écrivains qui appartiennent au cercle restreint de La Jeune France. Les salles de rédaction si hasardeuses pour un auteur naissant, s’ouvrent pour Barrès qui ne se disperse pas ; il reste attaché au premier cercle qui l’a accueilli. Il l’encense, le légitime, le révèle, lui faisant grande place dans le cénacle littéraire parisien grâce à sa connaissance des œuvres de cette avant-garde inscrite dans une continuité romantique, et ainsi anoblie. Grâce à son talent, il appartient désormais à une famille d’esthètes triomphants ! Porté par son succès, il crée Les Taches d’encre, une petite revue artistique et satirique qui lui permet de briller encore et d’atteindre ses objectifs, bien que la critique littéraire soit en perte d’influence. L’écriture critique est une étape qui va lui permettre d’accéder à la posture de chroniqueur littéraire, puis de s’affirmer en qualité d’écrivain.
Séverine Poulain a adroitement souligné le détachement progressif de Barrès à l’égard des maîtres, et dévoilé le parcours d’un écrivain qui s’émancipe, délaisse les petites revues, exprime « ses goûts comme ses aversions de façon très nette, dans le but de manifester sa singularité ». L’écriture critique s’efface pour laisser place à l’homme de lettres, et in fine au « Moi barrésien ».
Maurice Barrès, préfacier de ces dames… et demoiselles
Patrick BERGERON
Maurice Barrès s’est intéressé aux œuvres d’autrices, et les a préfacées. Patrick Bergeron s’est interrogé sur le rôle que les écrivaines élues ont pu jouer dans la vie personnelle de l’auteur, et dans la vie intellectuelle de leur époque – bien qu’elles n’aient pas « l’étoffe des maîtres ».
Barrès remarqua le Cantique des Cantiques de sainte Thérèse d’Avila, qu’il lut avec plaisir pour son audace et sa dignité :
Du bon sens, toujours, et rien d’artificiel ni de précieux. Aucune liquéfaction intérieure. Une netteté terrible, l’œil du maître promené sur le visible et l’invisible. Nul roucoulement de colombe, mais la vitalité d’un aigle.
Parmi les autrices de la Belle Époque, Marie Bashkirtseff, Anna de Noailles, Gyp et George Sand retinrent tout particulièrement l’attention du critique, et font l’objet de plusieurs entrées de ses Cahiers.
Patrick Bergeron commente une dizaine de titres d’œuvres féminines préfacées par Barrès, qui semble rechercher la sensation et le curieux de leurs psychologies. En 1889, Rachilde, « bas-bleu » de vingt ans, et néanmoins autrice de Monsieur Vénus, tint une place singulière dans la vie de Barrès, qui noua avec elle « une amitié passionnée », captivé par une « œuvre qui ne vaut que par la perversité cérébrale » et « dont la frénésie sensuelle […] effraya l’opinion ». Dans sa préface d’une vingtaine de pages, il considère que Rachilde écrit ce roman pour « uniquement exciter et aviver ses frissons3 ». Patrick Bergeron relève les moments importants qui marquèrent l’avènement de ce « chef-d’œuvre » dans la vie littéraire, et se tourne vers d’autres autrices et romans fantastiques, sur lesquels Barrès arrêta son regard ; par exemple, celui de Mrs. Oliphant, « magicienne » qui a « l’aisance du génie » et « quelle suite étonnante d’imagination ! »
Au sein de cet article, Patrick Bergeron s’est attaché à nous faire découvrir plusieurs autrices mises en lumière par Maurice Barrès, qui éprouva un respect réel pour ces originales « devancières », qui pénétrèrent la vie intellectuelle de la Belle Époque et y « jou[èrent] un rôle ennoblissant ».
Critique et création : le cas Barrès (1896-1903)
Jessica DESCLAUX
Jessica Desclaux interroge le parcours de l’écrivain Maurice Barrès, et formule l’hypothèse « que le compte rendu ou la présentation d’ouvrage est un lieu privilégié […] pour amorcer ou relancer sa création de voyage […] ».
La critique littéraire et la chronique seraient donc un tremplin pour ce voyageur, qui s’intéresse à l’Orient, à l’Italie, à l’Espagne, se penche sur les œuvres les plus rares, et cherche par le biais du commentaire et de l’actualité littéraire à atteindre son objectif : donner naissance à un « roman de l’énergie nationale ».
Jessica Desclaux montre que Barrès-critique désire créer un lien avec l’écriture de voyage, que Barrès-chroniqueur s’attache à soulever ce qui bruit – avant que de revenir à l’écriture romanesque –, et que le fait journalistique, et plus précisément L’affaire Dreyfus, le retient. Cependant, ce dernier prend le temps de lire et de commenter les œuvres les plus remarquables de cette fin de siècle. Il étudie le cercle maurassien, s’intéresse à La Mort de Venise, à la peinture, à la musique. Barrès-lecteur de ses contemporains continue à écrire et penser sa posture d’écrivain, et de chroniqueur. Jessica Desclaux souligne que sa « veine critique », de 1896 à 1903, a été peu active. Il se consacre aux Déracinés. Toutefois, à partir de 1898, il retient quelques ouvrages qu’il désire révéler au public : Carnets de voyage : notes sur la Province d’Hippolyte Taine, Essais des sciences maudites de Stanislas de Guaita, ainsi que les romans d’Hugues Rebell, Léon Daudet, Victor Giraud, Paul Bourget, Charles Maurras, Philippe Berthelot. La chercheuse suggère que les livres signalés seraient « un prétexte pour se redéfinir publiquement par rapport à son auteur, dans le champ intellectuel, en nouant de manière privilégiée un dialogue polémique ».
Présent au sein de plusieurs chants critiques, l’écrivain lorrain garde en son sein l’amour du régionalisme et d’un romantisme repensé, remodelé. Il réfléchit la création. In fine, Barrès a emprunté plusieurs chemins de l’écriture pour s’affirmer. Il a expérimenté comptes-rendus, critiques, chroniques, et trouvé son miel dans ses lectures de l’âme, et des idées dispensées au sein des arts majeurs, et des paysages. « L’effacement progressif de l’écriture critique au sein de sa pratique du journalisme doit se lire comme un acte d’émancipation. »
Tout en évoquant plusieurs aspects de la carrière de Maurice Barrès, du livre de voyage à la chronique, Jessica Desclaux a mis en évidence La Mort de Venise de Thomas Mann, pour signaler son art consommé « de faire de la critique un moteur de la création ».
Maurice Barrès au miroir des journaux d’écrivains (1890-1920) :
critique diariste et affirmation d’une déontologie auctoriale
Fabien DUBOSSON
Dès 1890, Maurice Barrès est ancré dans la vie littéraire. L’homme et l’œuvre sont cités dans les journaux intimes – révélateurs des sentiments qui animent les diaristes. Fabien Dubosson remarque que l’essor du journal d’écrivain, « stimulé par le modèle du Journal des Goncourt, dont un premier volume a paru en 1887 », s’accompagne d’un geste critique qui lui est propre, et propose de le définir. Il statue sur les journaux d’Edmond (et Jules) de Goncourt, de Jules Renard, de Léon Bloy et de Paul Léautaud.
Pour le chercheur, les journaux de la vie littéraire ont une séduisante particularité : ils libèrent la parole ! Aussi va-t-il, dans un premier temps, lire un journal intime destiné à le rester, et dans un second temps, lire un journal qui n’a d’intime que l’appellation, puisque le diariste destine ce dernier à la publication :
Le diariste jouit en effet d’une situation privilégiée d’observateur du monde littéraire mais ne bénéficie pas d’une reconnaissance particulièrement saillante auprès de ses contemporains pour ses propres œuvres ; il n’est en aucun cas en position de domination symbolique du champ littéraire […].
Fabien Dubosson spécule sur les remaniements opérés dans ces journaux, à la fois « chronique de la vie littéraire, [et] journal qui suit l’élaboration d’une œuvre », avant qu’ils ne soient publiés. Le chercheur remarque que l’on y parle souvent de Barrès « devenu entre 1890 et l’année de sa mort, l’un des points de repère de la vie littéraire ».
Il ne semble pas y avoir de source totalement exempte de « délicatesse » envers autrui, mais évolution du diariste qui juge et se juge ! Il y a dans ces journaux des propos rapportés – donc peu fiables, mais assortis d’une vie littéraire foisonnante où les événements du jour se disputent la première place et qui, répétés, œuvrent à l’intérêt du journal intime. Du ressort de l’intime, le journal de Léon Bloy est un exemple de rancœurs à son propre égard, et envers Barrès. Ressentiments écrits avec hargne, avant que d’être offerts au public :
Tout le monde me conseille de tomber, maintenant, sur Maurice Barrès. Pourquoi pas ? La fille Renan !!! / Lisons ce chameau, puisque notre profession l’exige. Impossible de dénicher autre chose que la petite mécanique du Moi…
Fabien Dubosson expose le désamour de Léautaud envers Barrès :
Quel temps j’ai perdu dans ma jeunesse à lire ce phraseur sans esprit, ce romantique artificiel, cet arlequin littéraire et quelques autres du même genre, qui ne cadraient en rien avec ma vraie nature. Que diable avais-je à me complaire dans de pareilles lectures, qui m’ont retardé de vingt ans ?
Fabien Dubosson rend compte de la stratégie de Léautaud, qui examine finement la nature de cette influence « diverse, dispersée, émiettée, jamais totale ni solide, combien elle est, si on peut dire, ratée ». Et cependant, il tait – publiquement – son désamour par goût pour les beautés qu’il a autrefois trouvées dans ses livres. Alors, qu’en est-il de l’idiosyncrasie de Barrès, écrivain trop érudit ? trop intelligent ? trop didactique ? pas assez sensible ?
Les grands moments de sa vie soumis à l’immédiateté sont ici cités, explicités, ainsi que les questionnements qu’ont provoqués chez ses lecteurs son ambition politique et son engagement idéologique. Barrès, auteur influent, anti-dreyfusard, entrant à l’Académie française, serait-il le récipiendaire d’un honneur tiède, insincère ? C’est une des réponses que propose Fabien Dubosson.
Le style comme stratégie dans l’exercice de la critique, de Barrès à Gide
Stéphanie BERTRAND
Le style dans l’exercice de la critique – à l’articulation des XIXe et XXe siècles – participe-t-il d’un escalier à gravir, qui mettrait en danger la finesse, la sensibilité d’une écriture pour qui songe à devenir écrivain ? Les tourments que créent l’exercice critique chez André Gide et Maurice Barrès, jeunes critiques et écrivains en devenir, sont observés par Stéphanie Bertrand :
Style ! Encore une question qui me tracasse. Je n’ai pas de style ; c’est un effort que le mien, il me faut cinq, six copies pour coucher ma métaphore4.
Stéphanie Bertrand questionne le positionnement du style dans l’exercice de la critique littéraire, retient le désarroi de Gustave Flaubert qui participe de ceux qui réclament « une attention soutenue à la forme ». Il a interrogé George Sand sur ce point :
Où connaissez-vous une critique qui s’inquiète de l’œuvre en soi, d’une façon intense ? On analyse très finement le milieu où elle s’est produite et les causes qui l’ont amenée. Mais la poétique insciente, d’où elle résulte ? Sa composition, son style ? le point de vue de l’auteur ? Jamais !
La chercheuse souligne que Jules Lemaître a été raillé par Albert Thibaudet pour n’avoir pas tenu compte du style dans ses conférences sur l’œuvre de Chateaubriand. Ce style qui fait la singularité d’une œuvre, et que Stanislas de Guaita remarqua chez Barrès, et que Drouin remarqua chez Gide :
Parmi les prestiges du style, aucun ne m’a plus ravi, dans tes premières œuvres, que la nouveauté, la souplesse et la variété des inflexions. J’ai souffert chaque fois que des critiques sourds n’y savaient pas reconnaître et saluer le musicien, l’inventeur d’une musique jamais entendue ; le plus récent, t’étudiant comme artiste, a-t-il du moins senti cela ?
Le style concerne la critique, par sa « forme conventionnelle, [il] contribue à effacer les frontières qui séparent la prose journalistique du texte littéraire ». Il apparaît également « comme un enjeu de premier ordre pour l’écrivain » ; faire une excellente critique, c’est accéder à la belle Littérature, c’est franchir l’obstacle de l’invisibilité, mais c’est aussi se contraindre et faire fi de son originalité. Pour Barrès, « obsédé par le style », c’est se priver « [d]’une flamboyante antithèse, [ou] d’une tirade superbe d’emphase ». Gide quant à lui, redoute que son « style littéraire [ne soit] gâché », déformé, et son talent d’écrivain envolé – volé par les articles écrits pour La Revue blanche. Stéphanie Bertrand ajoute que « les modalités de publication de l’article de critique littéraire (en l’occurrence l’identité de la revue) font peser sur l’écriture de ce dernier des contraintes plurielles, auxquelles le style n’échappe pas ».
La chercheuse rappelle également les apories de la métaphore barrésienne, et signale un discours marqué par des phrases emphatiques et l’auto-dévaluation : « une stratégie pour toucher un double public ».
[La] revendication d’une attention au style dans l’exercice de la critique permet aux écrivains de se singulariser comme critiques, mais aussi de suggérer, subséquemment, leur supériorité dans l’exercice.
Barrès souffre pour « faire brillant et juste ». Stéphanie Bertrand signale « le paradoxe d’une écriture qui n’entend pas disparaître derrière son objet, mais volontiers rivaliser avec lui » ; glissement parfois assorti d’une subtile imitation de l’écrivain critiqué.
Stéphanie Bertrand a finement précisé les attentes des écrivains, et souligné que l’exercice de la critique n’a pas d’effets identiques sur Barrès et sur Gide. Pour l’un, il y a exercice de préparation à l’œuvre, pour l’autre, une crainte de l’appauvrissement du style, sinon effacement de la sensibilité. L’exercice de la critique littéraire, aussi brillant soit-il, serait-il à la fois vitrine et enfermement ?
À forme d’une « vie » ; le « Dostoïevski » fantôme de Gide
Hélène BATY-DELALANDE
Pour appréhender l’écriture du « Dostoïevski » d’André Gide, Hélène Baty-Delalande questionne les « idées » – et le « portrait en éclats » – que Gide consigna dans un texte composite, en 1923.
Elle explicite que des nombreuses notes de 1908, ne reste que de menues traces. La Vie de Dostoïevski de Gide demeurera « un texte fantôme5 », recomposé, et « probablement infusé d’autres textes ». Ne pouvant s’appuyer sur les archives, la chercheuse puise au sein des Vies admirables de Romain Rolland, ainsi que dans les textes réunis dans le Dostoïevski, et dans ses références, un modèle pour penser la relation biographique – imaginée, rêvée – de Gide. Il est intéressant de reprendre sa réflexion pour appréhender la notion de « texte fantôme » :
Au sens propre, il renvoie d’abord à un texte identifié mais non disponible : perdu, tronqué, resté à l’état de rêve ou de projet, voire totalement imaginaire, mais néanmoins présent sous l’aspect d’un titre, d’une évocation plus ou moins détaillée, d’un souvenir ou d’un fantasme.
À l’origine de la tentative d’une biographie de Gide sur Dostoïevski : une demande de Péguy, puis de Copeau. Si Gide reprend l’étude délaissée de l’œuvre du grand écrivain russe, il ne lui donne pas suite pour autant. Le projet premier d’écrire « une Vie de Dostoïevski, et quelques portraits en pied », s’estompe d’années en années. Aussi, ses pensées formulées au sein de notes et textes épars, durant quatorze années, ne sont-elles lisibles que par le biais de textes hybrides publiés en 1923. C’est sur ce constat d’écriture inachevée que s’appuie Hélène Baty-Delalande, s’emparant des Vies de Romain Rolland, pour parler du Dostoïevski inabouti de Gide.
La chercheuse souligne qu’en ce début de siècle, le portrait est introduit dans la critique, et le genre des Vies rencontre un franc succès – écrit sous l’angle de la critique pour Gide, sous l’angle de l’hagiographie pour Rolland. Gide est fasciné par la vie, l’œuvre et l’âme des personnages de Dostoïevski, car sans la présence de personnages remarquables, nulle Vie à raconter. Il consigne dans son Journal :
J’ai pour Dostoïevski la plus vive reconnaissance, et ne peux pourtant pas la proclamer plus haut que je n’ai fait, n’ayant pas, comme vous [Pierrefeu] l’avez dit, la voix forte.
Cependant, Gide garde pour l’œuvre inquiétante de Dostoïevski – qui atteint des régions profondes de l’homme –, grand intérêt. La lecture de ses romans lui a permis d’aller à la rencontre de l’âme de l’écrivain, et lui a insufflé le désir d’écrire une « Vie » « réelle », « véritable », « intime ». La nature des créatures troublantes et tourmentées de l’écrivain russe a saisi Gide, qui a pressenti que leur âme, semblable à celle de Dostoïevski, est livrée dans les pages de ses œuvres, des Possédés aux Frères Karamazov. Et, si l’on trouve parfois des accointances dans l’œuvre gidienne avec l’œuvre de Dostoïevski, il est important de préciser que Gide ne fera pas une œuvre semblable. Tout en observant et admirant l’œuvre du grand homme, et tout en s’abreuvant à sa source, il créera ardemment une œuvre autre. Et, pour exposer ses idées sur l’œuvre de Dostoïevski, il méditera sur « la puissance spirituelle de la littérature ».
D’autres Vies furent publiées dans les Cahiers de la Quinzaine, « des galeries de vies, celles des Musiciens d’autrefois et des Musiciens d’aujourd’hui ». Hélène Baty-Delalande signale le rapprochement possible entre la vie du Dostoïevski de Gide et la Vie de Beethoven de Rolland. « Gide reconnaît lui-même la porosité des portraits, les ressemblances qui circulent entre le peintre et son modèle […]. » La chercheuse discerne le motif du combat, « central pour saisir ces “héros” ». Gide releva : « On s’attend à trouver un dieu ; on touche un homme – malade, pauvre, peinant sans cesse […]. »
In fine, cette prise de distance aura été pour Gide « une façon de reconduire le dialogue avec Dostoïevski sans jamais le conclure », expose de façon remarquable Hélène Baty-Delalande dans sa stimulante traversée.
Une campagne critique d’André Gide :
La NRF 1909-1910
Pierre MASSON
L’intérêt de Gide pour la critique et les chroniqueurs est patent dès sa vingtième année, « il personnalise volontiers cette discipline, en instituant le critique en prestigieux, dominant presque le monde de la création en raison de son pouvoir d’en juger la valeur ». Il veut en être ! Pierre Masson livre d’emblée le désir ardent de Gide « d’être des leurs, de pouvoir [s]e frotter à eux et de leur parler de pair à pair ». Celui-ci imagine un petit salon, où il se tiendrait avec Madeleine, où l’on « serait au courant de tout et l’on pourrait donner une très forte impression à la littérature ».
Gide prendra toutefois le temps de revenir à sa propre œuvre, avant que de venir à la critique. Et, tout comme Barrès, ou Melchior de Vogüé – quelques vingt ans plus tôt –, il se posera « en découvreur de la jeunesse novatrice ». Il veut « liquider la vieille garde » : fini « les pièces d’anthologie » ! Un jeu d’équilibriste s’installe, observe Pierre Masson. Cependant, en ce début de siècle, la critique est peu à peu remplacée par le reportage, la réclame, les interviews, le compte-rendu. Gide ne se décourage pas, à l’instar de France, il recherche en tout, l’esprit, l’intelligence sensible que l’on trouve chez « Le bon critique […] qui raconte les aventures de son âme au milieu des chefs-d’œuvre » :
Il ne suffit pas à Gide de revendiquer ce rôle de lecteur attentif de la production littéraire, il lui faut aussi affirmer l’originalité de sa position, en se démarquant des critiques qui, eux, ne savent pas lire, par conformisme, veulerie ou intérêt.
Gide revendique la plénitude de la fonction et... :
[...] fait passer la critique de l’extérieur à l’intérieur de l’œuvre. [Pour lui,] le secret qui caractérise la valeur profonde d’une œuvre, qualité secrète qui ne se dévoile pas aussitôt, et qui suppose que le critique se mette à l’écoute plutôt que d’imposer ses critères logiques et rhétoriques.
Gide s’est éloigné peu à peu de Barrès, France, Lemaître, Faguet. Ambitieux, « il prend ombrage du succès des meilleurs, les attaque [plus ou moins virulemment] à plusieurs reprises ». Pierre Masson rappelle que « les luttes politiques et religieuses avaient contaminé la littérature et divisé son public ». Gide est à son tour critiqué. Et, Monfort « vole au secours de Gourmont en accusant Gide d’opportunisme littéraire et de protestantisme foncier ». Effectivement, il se veut dominant dans le monde de la critique, qu’il plébiscite, et au sein duquel, rappelons-le : on pourrait donner une très forte impression à la littérature. Gide a érigé La NRF « contre la fausse critique [du] journalisme, l’américanisme, le mercantilisme et la complaisance de l’époque envers soi- même, [afin de] faire grande place à la critique ».
Pierre Masson signale le « rôle de purificateur des lettres » que Gide voulu être au sein d’un carrefour, « où les luttes idéologiques et politiques avaient contaminé le camp des intellectuels les plus renommés ». Il a tenté par le biais de sa propre œuvre de résoudre un problème à la fois sociétal et intime. Son talent pour en parler séduisit la jeunesse. Fortifié, il tint sa place, mais en s’engageant dans « une campagne critique » :
Gide se livre à un véritable jeu de massacre des principaux représentants de la critique littéraire ceux-là qui pourtant se distinguaient de la médiocrité de la critique journalistique, mais que, justement pour cette raison, il lui fallait prendre pour cibles …
Ce fut le moment pour Gide de développer un « principe d’écriture critique » dans sa propre œuvre, relève Pierre Masson, qui traverse son œuvre entière, n’omettant rien dans cet article passionnant, des tribulations et des bifurcations d’un écrivain à l’œuvre indépassable, qui a habilement utilisé « son activité critique comme moyen d’interroger sa propre création ».
Gide, un critique sans autorité ?
Jean-Michel WITTMANN
La question posée par Jean-Michel Wittmann — « Gide, un critique sans autorité ? » — a pour enjeu d’observer la stratégie littéraire de cet écrivain charismatique, qui « construit » sa notoriété de critique sur la « déconstruction » de l’autorité.
Jean-Michel Wittmann éclaire cette stratégie, ainsi que le sens du mot autorité, dont les valeurs sont multiples,d’« objet de résistance », à « force qui impose le respect ». Le chercheur remarque que l’image de Gide « affiche généralement un déficit d’autorité, voire une absence d’autorité », que ce dernier entretient, insinuant que sa critique ne peut avoir de portée significative. Soit parce qu’elle peut laisser supposer que l’éloge formulée est marque de reconnaissance envers autrui, soit que lui-même, en qualité de critique, pense qu’il n’est pas à la hauteur d’un discours autre – qu’il juge plus talentueux que le sien. Il est en constante dévalorisation. Il parle à voix basse, avec moult précautions ; selon lui, « L’œuvre d’art répugne [aux] cris ». Jean-Michel Wittmann remarque que Gide emploie volontiers le mot causerie plutôt que le mot conférence pour parler de ses discours. Il revendique la position d’intellectuel désintéressé, indépendant, aux valeurs universelles. Il se réfère au « goût » et à la « langue », pour juger les écrits de ses contemporains, traque les faussaires, les partisans, les contrôleurs. Sans complaisance, il estime porter une responsabilité morale. Il est « l’idéaltype de l’écrivain prophète », aux traits que « Gide ne cesse de […] mettre en avant dans ses articles ».
Jean-Michel Wittmann développe plusieurs de ces traits, et expose adroitement « la logique à laquelle répond [le] discours [de Gide], apparemment dévalorisant, et l’effet que ce discours produit ». Il éclaire la nécessité qu’éprouve celui-ci « de s’élever au-dessus de la mêlée, littéraire et politique », d’affaiblir l’image d’autres critiques, en dépit d’un talent et d’une autorité reconnus. In fine, Gide a préparé sa réputation « sur la déconstruction – de l’autorité dans son discours critique », nonobstant une autorité déjà légitimée – qui de facto s’imposait d’elle-même.
Dans l’atelier de Gide critique
Peter SCHNYDER
C’est sur un constat que Peter Schnyder introduit son article : « Il y a peu d’échos et d’études des textes critiques et des essais de Gide ! » Un peu plus loin, le chercheur suggère « de clarifier le statut critique du Journal en rapport avec les pages critiques publiées ». L’œuvre gidienne est réflexive, n’est-ce pas à cet endroit que l’on pourrait le mieux rencontrer l’homme, l’écrivain, et le critique ? :
Il adapte la forme de sa critique à son propos ; elle peut rester brève ou s’étendre, se présenter sous forme de note, billet, lettre, essai, chronique, journal sans date, interview (souvent « imaginaire »). Dans certains cas, elle aboutit à un livre […].
Les nombreuses œuvres lues par Gide l’ont préparé à l’acte critique, « prélude », ou « pré-texte » de son œuvre fictionnelle. « Il a à vingt ans une surprenante indépendance face aux grands critiques littéraires », souligne Peter Schnyder, dans une large présentation de Gide. Il voit dans cette personnalité un critique lucide, qui « s’en tient à l’essentiel » et « ne craint pas de s’arrêter sur les parties jugées moins abouties dans une œuvre qui l’a conquis » :
Ses pages d’essayiste se lisent avec profit, car elles font partie de la littérature : elles sont de la littérature. Une telle pratique est précieuse, car elle peut servir d’intermédiaire entre les grands textes et nous, car Gide entretient avec eux une familiarité et une proximité dont il nous fait profiter.
Peter Schnyder explicite le parcours à la fois riche et rigoureux de Gide poète, romancier et essayiste, qui après avoir tenté de deviner les « secrets de fabrication » des auteurs élus, choisit de « tester l’impact de ses commentaires et de ses notes » dans des revues d’avant-garde, avant que de se tourner vers des périodiques plus prestigieux. Attentif à la hiérarchie éditoriale, à l’image de « celle du mot dans la phrase, de la phrase dans la page, de la page dans l’œuvre », il exerce également dans son Journal une critique sur ses propres écrits dans un style réjouissant, bien que son autorité soit mise à mal par son auto-dénigrement. Posture déconcertante, devant d’indéniables qualités scripturaires. Quant au regard porté sur l’œuvre d’autres écrivains : romans, poésies, critiques, essais, il est profond, honnête, adouci parfois par une comparaison qui repose sur des assertions savoureuses, singulières ; apparaissent alors, peintres et musiciens sous sa plume ainsi distinguée :
Tout peut devenir « objet critique » chez Gide, à commencer naturellement par l’écriture – la sienne, comme le dévoile le Journal, et celle des autres. Et il ne se prive pas de s’exprimer sur autre chose que la littérature : musique, peinture, politique culturelle.
Peter Schnyder parle avec chaleur des pages critiques et essais « si vivants » de Gide, et démontre que si ce dernier peut se laisser aller à une « écriture lisse », il peut aussi faire preuve d’une grande originalité, usant d’un vocabulaire unique et inattendu, fait d’hapax, néologismes et mots extravagants – mais toujours appropriés. C’est ce que met joliment en évidence cet article sur des bonheurs d’écriture, « difficile à décrire et encore plus complexe à théoriser », mais qui nous invitent entrer dans « l’atelier » de Gide, pour lire, relire ou travailler – au plus vite –, ses textes critiques et essais, « œuvres d’art à part entière ».
Henri de Régnier – quand le poète devient critique
Franck JAVOUREZ
C’est sous un angle méconnu de la personnalité d’Henri de Régnier que Franck Javourez choisit de présenter le poète symboliste, qui par nécessité, dès 1887, devint critique littéraire au sein de divers journaux et revues, puis directeur de revues avec Paul Adam (Entretiens politiques et littéraires), de 1890 à 1893, et enfin, directeur de deux grands journaux : Le Journal, de 1914 à 1917, et Le Figaro, à partir de 1920.
Régnier expérimente ! C’est un « mémorialiste », qui pratique surtout une critique thématique et historique. Il aime préfacer ses propres livres, choisir les auteurs dont il va décortiquer et dépeindre les œuvres. À partir de 1901, il publie Figures et Caractères dans Le Gaulois (journal mondain). Franck Javourez souligne que « l’analyse littéraire se mêle pleinement, et de plus en plus, au récit de souvenirs autour de la personne de l’écrivain ». Lorsqu’il décrit ses « figures », Régnier-poète portraiture symboliquement ses personnages, et Régnier-critique introduit des personnages dits « réels », dans ses « caractères ».
En 1885, Régnier, marqué, par le texte À Rebours de Huysmans, écrit un commentaire en forme de conte, « expérience d’appropriation, voire d’absorption » dans ce cas précis. Le chercheur souligne la présence récurrente de Huysmans, dans les premiers Écrits pour l’Art de Régnier, consacrés en 1887 à L’Après-midi d’un Faune, et à la publication d’En Rade. En1894, son recueil Figures et Caractères est achevé :
[L]a rêverie et le songe y tiennent une place centrale, tant dans la recomposition du monde par le poète que dans l’événement esthétique à l’origine de tout poème. Il en découle cet art du portrait si particulier, lui-même une forme de poème, appliqué à l’écrivain et à son œuvre, qui fait toute la singularité de la critique de Régnier.
À partir de l’année 1920, Figures et Caractères, joue un rôle déterminant dans sa conception romanesque. En 1928, lorsqu’il conçoit Faces et profils, son mode d’expression change, et lui qui aimait choisir auteurs et œuvres, n’opère plus de sélection. Expérimenté, Régnier reconnaît le talent de ses contemporains – de Mallarmé à Baudelaire, de Vigny à Hugo, de Michelet à Gide :
[Il] met l’accent sur l’indépendance et la sincérité de ses impressions et de ses réflexions, ce qui est bien le moins ; une critique qui s’avoue explicitement impressionniste. [Il oscille] entre la critique « artiste » et la critique « spontanée ».
Frank Javourez a misé sur un aspect captivant de l’écriture portraitiste et ciselée d’Henri de Régnier, établissant sa facilité à approfondir la singularité des êtres, à s’attacher à la « beauté suprême ». Il a traversé finement une période féconde du poète-critique, qui sut rester créateur subtil en toute chose.
Dialogue ironique et dialogue irénique à la Belle Époque :
quelques interviews feintes entre Renan et Thibaudet
François BOMPAIRE
François Bompaire constitue un petit rayonnage virtuel de la bibliothèque de Thibaudet, piochant parmi articles et essais critiques de et sur Renan et Barrès, textes prévus et non écrits de Barrès sur Renan, dialogues littéraires de mémoire, et autres récits sérieux ou pas, mettant au jour de jubilatoires bastonnades :
Thibaudet propose ici l’existence d’un genre, les bastonnades, dont l’inventeur (Barrès aux dépens de Renan) devient la victime ; ce genre ironique, loin d’être seulement destructeur ou de vouloir tuer par l’hommage, aurait la faculté de conserver cela même qu’il mord.
François Bompaire entame cette fabuleuse étude en questionnant la posture littéraire de Thibaudet, qui observe le dialogue à la forme singulière qui s’est imposée au lendemain de la Première Guerre mondiale6 et structure tous les aspects de l’activité critique. Pour Thibaudet, il n’est plus de « dialogue universel des disciplines, de même qu’aucune critique après le Phèdre n’est plus vraiment créatrice ». Seul Platon « fait dialoguer, et dans un vrai dialogue, l’ensemble des champs du savoir ». Une renaissance semblable du dialogue platonicien serait donc, pour lui, impossible à renouveler. Le chercheur propose une image inversée : « M. Teste qui réalise le “pur critique” parce qu’il “n’écrivait pas”, toute écriture, même critique, conduisant à devenir auteur et donc à cesser d’être critique. »
Le dialogue sans dialogue, « devenu la pratique du critique », sert le « Moi barrésien », et une « philologie du Moi » dans une approche positiviste chez Renan ; il relève pour Gide d’un « dialogisme [qui] n’est ni celui du philosophe ni celui du critique, mais du créateur » :
Gide s’amuse à une triple substitution, indexant contre le Culte du Moi sur la confrontation avec l’Autre la valeur de la littérature mais aussi la valeur, limitée, de la critique : la création apparaît comme l’autre du dialogue, qui ne vaut que par cet avenir.
Pour Thibaudet, Le dialogue sans dialogue relève de « l’essai suggestif ». Quant à Blum, il tente tout simplement de « garder le terrain politique de la littérature – contre L’Avenir de la science et contre le dialogue » de Renan, qui « se donne un droit au récit faux ou à prendre, boulevard génial ouvert pour canulars à venir cum grano salis ».
François Bompaire réunit Barrès, Blum, Renan, et Gide, dans un grand chassé-croisé, pour « contester un type d’homme-dialogue », afin de mieux exposer une définition conflictuelle de la critique, et des dialogues, abordant la « bastonnade barrésienne » qui fustige la mollesse de Renan, tandis que Blum brutalise et Barrès et Renan, « pour garder le terrain politique de la littérature ». Cela, quand Gide, d’évidence, est « contre tous ».
Saisir le mordant des dialogues – système structurant plébiscité par Gide, Renan et Thibaudet – par le biais des Interviews, tel a été le séduisant projet du chercheur, qui a aussi relevé dans les bastonnades, « la mémoire encore vivante d[’]autres modèles non dialogiques mais systématiques de la critique ». C’est au sein d’un duel littéraire teinté d’ironie, et non dans un dialogue serein, que François Bompaire présente les dialoguistes par le biais d’une analyse étoffée, qui révèle comment la notion critique de dialogue s’est largement délestée du dialogue !
Devenir Paul Souday (1912-1914) :
Un critique à l’époque de la « crise du français »
Gilles PHILIPPE
Gilles Philippe choisit d’évoquer la figure du critique littéraire Paul Souday, qui a publié dans le quotidien Le Temps7, sous l’intitulé « Les livres », le nouveau roman d’Henri de Régnier, Romaine Mirmault, alors que la Belle Époque arrive à son terme au cœur de l’été 1914.
Il montre que Souday, érudit, indépendant, était « craint des écrivains » : « Le mercredi était jour d’anxiété pour plusieurs. Cinq colonnes terribles parfois s’abattaient sur un livre. » Particulièrement sévère à l’égard de Régnier, il stigmatisa « les défaillances de langue et de style », ainsi que les « plans compliqués et enchevêtrés ». Le milieu littéraire contemporain de Souday vit en lui un puriste, un rosse, et un critique intègre, qui « ne manquait nullement de goût, et à une époque de transformations littéraires foudroyantes ». Philippe souligne que :
La postérité n’est pas tendre envers Paul Souday. […] recenseur le plus influent, le plus respecté et le plus craint de son temps. Mieux valait l’ire de Paul Souday que son silence, dirait encore Paul Valéry.
Le chercheur cite moult adjectifs utilisés par l’exigeant Souday qui jugent les tournures stylistiques de Wilde, Yell, Bloy, Péguy, Huysmans, Proust, Clermont, Fouquier, Lavadan, Barrès, Martin du Gard, Rosny, France, Colette, Flaubert, Stendhal, Renan, Rimbaud, Vigny, Brunetière et Claudel, désapprouvant l’un et complimentant l’autre. Il s’insurge contre ceux qui pensent qu’il n’y a pas de « crise du français », et déplore « dans ce relâchement un véritable péril pour l’avenir de la langue ». Il insiste sur cette crise qui perdure :
Combien sont mal écrits la plupart des ouvrages nouveaux. […] La langue se décompose, se mue en un patois informe et glisse à la barbarie.
La Belle Époque ne peut échapper à une reconfiguration subtile des critères d’évaluation du jugement grammatical et esthétique, et Gilles Philippe remarque « chez Souday une claire volonté de préemption du geste évaluatif ». Le critique refuse toute pertinence au grand public, comme aux esprits éclairés : « Les lecteurs qui se désintéressent du point de vue critique et intellectuel se privent de joies intenses, et la plupart d’entre eux finissent par se contenter de distractions subalternes. » Paul Souday a une ferme idée de la fonction de critique :
C’est un préjugé de séparer en deux groupes distincts les créateurs et les critiques. […] La haute critique est une création, puisqu’elle crée des idées et des sentiments, invente des points de vue, imprime de nouvelles orientations et de nouveaux essors au mouvement intellectuel.
Gilles Philippe a développé une étude originale et montré que Paul Souday, qui d’instinct, « savait comment on séduit ou révolte », a été le créateur d’une critique élaborée, foisonnante. Pour aller plus loin, il propose une table du feuilleton « Les livres » que le chroniqueur fit paraître dans Le Temps, de janvier 1912 à juillet 1914.
Un parcours critique : Jacques Rivière, ou la « passion de comprendre »
Paola CODAZZI
Jacques Rivière, « un homme qui a marqué, de manière aussi discrète que ferme, l’histoire littéraire du XXe siècle ». C’est ainsi que Paola Codazzi présente cet intellectuel, « qui a choisi de lier son destin à celui de La NRF ».
Jacques Rivière, collaborateur occasionnel de La NRF à 22 ans, secrétaire à 25 ans, directeur, à 33 ans, de l’honorable maison, « occupe une place à part dans le panorama du premier XXe siècle et cela grâce à une écriture qui allie spontanéité et professionnalisme ». C’est un lettré qui, à l’instar de Paul Souday, échoue au concours d’entrée à l’École normale, en dépit de sa précocité intellectuelle. « Sans abandonner ses aspirations d’écrivain, il se tourne de plus en plus résolument vers la critique. » Paola Codazzi relate que, comme Gide, il a l’oreille musicale, « l’un de ses articles les plus réussis à cette époque [étant] bien celui qu’il consacre à la représentation de Pelléas et Mélisande de Maeterlinck ». La musique éclaire et féconde son propos sur la littérature, aussi ouvre-t-il dans un même esprit La NRF à des débats qui peuvent porter sur la peinture. La chercheuse souligne que Rivière est en accord avec La NRF naissante :
[Il] tient à établir un partage nécessaire entre politique et actualité, d’une part, et art et littérature de l’autre : La NRF s’occupera des deux, mais séparément, et avec une prédilection nette pour la seconde.
Paola Codazzi évoque les débuts de Rivière attaché à Fournier, mais également à Barrès, qui éveilla en lui une « ferveur clairvoyante », au cœur d’une période tourmentée. Elle relate les sentiments qui l’animèrent en lisant l’œuvre de Claudel avant qu’il ne cherche à « échapper progressivement au trouble [afin de] percevoir l’œuvre en sa spécificité, [et que vint] la prise de conscience critique ». Empathique, Rivière « établi[ssait] un lien avec l’âme de l’œuvre et celle de son auteur ». Bien des fois, son enthousiasme juvénile retint le souffle sévère du jugement qu’il aurait pu poser. Cependant, ses qualités manifestes de critique ressortirent dans ses conférences sur la littérature française : elles bénéficièrent d’un franc succès, et à partir des années 20, « les dernières de sa vie, on assiste en effet à une évolution significative dans sa production ».
Paola Codazzi a dressé un portrait exemplaire de Jacques Rivière, dégageant l’esprit d’un critique qui, par le biais de l’analyse littéraire, est allé à « la découverte de soi » et, par le truchement de la musique, vers une émotion écrite, analysée, partagée. Elle a finement déroulé plusieurs pans de l’activité littéraire de ce critique-poète et essayiste attachant, dont elle fait ressortir les lumières – ainsi que sa propre sensibilité.
Paul Valéry, critique de la Belle Époque
William MARX
William Marx nous invite à considérer les traces laissées par Paul Valéry, « un critique de la Belle Époque, […] au sens fort de la fonction de critique, à savoir en tant que penseur critique de son époque […] » — mais un penseur rigoriste qui se mit en retrait de la vie littéraire au cœur de cette période transitoire.
Le professeur au Collège de France observe que Paul Valéry ne publia que « de rares articles dans les revues d’obédience symboliste » :
On avait coutume de définir le symbolisme par la place qu’il accordait au sentiment et au vague des choses ; Valéry le décrit au contraire comme une approche originale et concertée du langage.
L’écrivain poète a d’autres centres d’intérêt, mais offrira durant cet intervalle deux œuvres de poids qui trouveront grand écho dès leur parution : Introduction à la méthode de Léonard de Vinci et La Soirée avec monsieur Teste. Valéry est un critique qui a un idéal et va s’absorber dans la création d’« une œuvre exigeante de réflexion psychologique », ne revenant à la publication d’œuvres poétiques et critiques qu’à partir de 1917. William Marx livre ici un fragment de ses Pages inédites, qui rend compte d’un esprit critique donnant, à contre-courant, en 1891, ses pensées les plus sombres, ainsi qu’un avant-propos retentissant du recueil poétique Connaissance de la déesse, à la fois élogieux et foudroyant pour le symbolisme. En 1896, Rivière fut associé à la direction de la revue symboliste, confidentielle et éphémère, Le Centaure, alors que le symbolisme était à son apogée.
William Marx propose – pour saisir plus profondément cette époque, et la personnalité de Paul Valéry, écrivain discret – une écoute de la leçon de clôture qu’il donna au Collège France, le 15 mars 1941, où il explicite : « […] nous étions en train de fonder autre chose dans l’ordre littéraire […]. » Il a approché d’une façon sensible la personnalité et la saine ambition de Paul Valéry de devenir le chantre d’une histoire littéraire honorable.
Il ressort des contributions de ce colloque – distingué par la profondeur de ses sujets – un monde littéraire ouvert aux idées, et défendant les valeurs d’une société abimée, fracturée.
La critique a agrandi son pouvoir au cœur de la Belle époque, et son esprit a pénétré tous les arts, les a parés de noblesse, nonobstant les polémiques. De la critique littéraire est né le plus vivant témoignage des écrits d’intellectuels à l’influence indéniable, tels que le furent Barrès, France, Péguy, Suarès, et Gide.
- 1 Revue des Deux Mondes, 3e période, tome 85, 1888, p. 433-452.
- 2 Ibid.
- 3 Voir : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k80889d/f21.item (préface de Maurice Barrès, p. XVIII.)
- 4 Maurice Barrès à Léon Sorg, 31 août 1882, DV, p. 110.
- 5 « La notion de « texte fantôme » a connu une certaine fortune critique après la publication de l’essai de Michel Charles de 1995, Introduction à l’étude des textes, où le terme désigne une structure invisibilisée du texte lu, qui détermine en profondeur son interprétation.
- 6 François Bompaire précise que ce projet irénique, effaçant les lignes de batailles, n’est sans doute pas un hasard après la Première Guerre mondiale.
- 7 La République des Lettres voit naître, en moyenne, un roman par jour. […] C’est pourquoi Le Temps a promis à ses lecteurs de faire « une plus large place à la littérature ». Voir l’Histoire de France d’Ernest Lavisse.