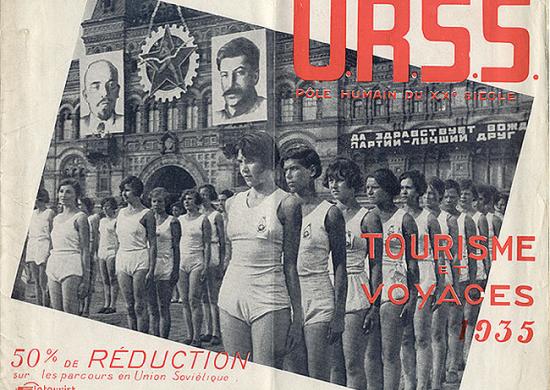Nous sommes le 7 février. C’est un jour un peu spécial ; le temps s’est figé, avec l’arrivée de la neige, sur la capitale. Les sons sont étouffés, il n’y a plus de klaxons, seulement des éclats de rire résonnant dans les gorges de groupes d’enfants bataillant dans la neige après avoir laissé les traces de leurs doigts le long des capots. On peut marcher sur les ronds-points ; la lenteur a gagné les trottoirs verglacés ; les flocons se posent sur les armes des militaires postés aux angles comme sur des branches, comme pour les faire plier ; tout Paris s’agrippe à son appareil photo — et aux rambardes de métro. L’eau a envahi les berges. Les canards ont l’air heureux. Les Parisiens aussi. Je regarde, à travers la fenêtre, les hommes sombres de Rodin sur qui la neige a déposé des écharpes, fourrures et bonnets lumineux. A. dit : « Cela fait 30 ans qu’il n’a pas neigé comme ça ! » La journée commence paisiblement, poétiquement. Elle se termine derrière les rideaux épais de l’hôtel Montalembert, où je retrouve Cameron Tolton à 19 heures, à la fois amusée par la présence de Daniel Cohn-Bendit dans le petit salon pastel, envoutée par l’odeur de vanille diffusée dans les toilettes, scotchée par le prix des thés à 10 euros, et captivée par la voix humble et enthousiaste de Cameron Tolton, qui me livre spontanément les souvenirs condensés de ses 60 dernières années, passées entre la France et le Canada. C’est avec générosité qu’il me propose de répondre par écrit aux questions que je lui ai adressées par mail. Finalement, le cadre des questions est encore trop restrictif pour un itinéraire gidien de plus d’un demi-siècle. Il m’envoie donc ce texte, qui retrace un itinéraire complet, celui de son passage par les bancs de l’université à ses pupitres, de ses « années sabbatiques » (à travailler les textes) à la retraite d’une profession… qui ne quitte jamais vraiment celui qui l’a adoptée.
*
Un parcours gidien : souvenirs d’un chercheur à la retraite
On me demande d’évoquer mes impressions de l’évolution du rôle de Gide dans mon univers scolaire et même dans ma vie personnelle, depuis ma première rencontre avec ses œuvres en 1958 jusqu’à ma relecture actuelle des œuvres de Gide en 2018. Il s’agit donc d’une période de soixante ans d’études littéraires qui commence en pleine période de méthodologie biographique pour traverser la nouvelle critique américaine avant de faire face au structuralisme et à la sémiotique français, mouvements qui, après un intervalle, seront suivis d’une période d’études culturelles et sexuelles avant d’arriver à la tendance actuelle de l’autofiction.
Étant né canadien-anglais dans la province de l’Ontario en 1936, je me suis trouvé dans la période de « deux solitudes[1] » du Canada. Le Québec, la province francophone à l’est de l’Ontario, qui restait dominé par un gouvernement rigide et par l’Église catholique, semblait une culture mystérieuse et isolée pour les anglophones de l’époque, et vice-versa. Dans ma province, on reconnaissait que l’étude de la langue française était importante dans un pays bilingue, mais on ne l’offrait comme sujet d’étude qu’à l’école secondaire où chaque étudiant était enfin obligé de commencer l’étude du français. Puisque la plupart des professeurs étaient anglophones et les étudiants déjà adolescents, il était très difficile d’acquérir un bon accent. Mais on apprenait sérieusement le vocabulaire et la grammaire pour lire et écrire la langue comme il fallait.
L’Homme et l’œuvre
En arrivant à l’Université de Toronto en 1954, je me suis inscrit dans un programme intensif de latin, de grec et de français. Le programme de littérature française suivait un ordre chronologique. Les professeurs se montraient attachés universellement à la notion sainte-beuvienne du rapport entre la vie de l’auteur et ses œuvres. L’histoire de la littérature semblait parfois plus importante que les œuvres littéraires elles-mêmes. Nos manuels étaient les histoires littéraires écrites par Lanson et Truffaut, Castex et Surer, Lagarde et Michard, ou, pour les plus prospères, les beaux volumes de Bédier et Hazard. Arrivés en quatrième année universitaire, nous abordions enfin les auteurs des XIXe et XXe siècles. Dans mon « Collège », toujours formellement attaché à une église protestante, la poésie était enseignée par une femme suisse, sans doute engagée par le collège en vue de son protestantisme assumé. Cette femme sévère, d’un certain âge, appelée par ses étudiants « La Grande Mademoiselle », sentait évidemment une obligation de protéger ses jeunes étudiants d’une influence éventuelle des péchés commis par les auteurs français du programme. Elle commençait donc chaque conférence avec une phrase prononcée avec emphase, telle que : « Charles Baudelaire a mené une vie affreuse, atroce, abominable. » Encouragé par une telle promesse, j’ai suivi avec plus d’attention que la normale les 50 minutes qui suivaient. Quelques semaines plus tard, nous apprenions que « Verlaine a[vait] mené une vie affreuse, atroce, abominable ». Puis Rimbaud. Et ainsi de suite. La Grande Mademoiselle ne nous décevait jamais. Parfois, elle nous expliquait même des poèmes.
Mais c’était dans un cours parallèle sur le roman que nous avons croisé pour la première fois Gide, au cours du mois de janvier 1958. C’était un tout autre professeur, un monsieur britannique, maussade et amer, qui, tout en inculquant une bonne portion de biographie de l’auteur dans ses cours, ne négligeait pas pour autant les textes. Le respect que l’université ressentait pour les œuvres de Gide se voyait dans la présence de trois de ses titres comme textes obligatoires. Le professeur, qui s’intéressait surtout à l’histoire des idées, a souligné dans ses cours les thèmes de la volonté et du libre arbitre qui lui étaient très chers. Ce qui obsédait donc dans L’Immoraliste notre professeur était le défi que rencontre Michel quand il s’interroge sur l’usage de sa liberté. C’était l’acte gratuit dans Les Caves du Vatican et la mauvaise gestion de son libre arbitre par le pasteur de La Symphonie pastorale qui le passionnaient également. Il faut ajouter que dans ses cours le professeur ne faisait aucune mention des techniques narratives, du style ou de la structure de ces textes. Mais nous, les étudiants, étions bien conscients de la différence entre les livres personnels de Gide et les romans longs et lourds qui l’avaient précédé dans notre programme, ceux de Stendhal, Balzac, Flaubert, et Zola. Les récits de Gide étaient courts, et Les Caves du Vatican était le plus humoristique des textes français étudiés depuis Molière, deux ans auparavant. Une bouffée d’air frais. Les trois autres romanciers du vingtième siècle choisis pour le programme, Proust, Mauriac et Duhamel, n’étaient pas connus pour leur humour non plus. Surtout tels que présentés par notre professeur.
Dans un programme où l’on ne faisait pas attention aux aspects stylistiques des textes, c’était surtout la thématique des ouvrages qui était examinée à l’examen de fin d’année. Et Gide a créé un problème particulier pour cet examen. Car il y avait quatre collèges dans l’Université dont chacun possédait son propre Département de français. Par conséquent, les étudiants de chaque collège suivaient le cours tel qu’il était proposé dans leur propre collège, dans le but de préparer un examen final commun. Mon professeur maussade n’était qu’un des quatre qui donnaient ce cours à la même heure dans leur propre collège. Hélas pour Gide, un de ces collèges était catholique et les Œuvres complètes de Gide étaient sur le fameux « Index ». Le collège catholique, site du prestigieux Institut pontifical d’études médiévales, avait pourtant un bon rapport avec des catholiques français comme Étienne Gilson et Jacques Maritain aussi bien qu’avec le Vatican. Le collège a donc obtenu une dispense qui lui permettait d’inclure exceptionnellement Gide dans son curriculum. Mais dans ce collège les étudiants préparaient pour leur examen trois romans de Mauriac et seulement un livre de Gide. Le livre choisi était La Symphonie pastorale, dont la présence semblait justifiée par sa critique d’un pasteur protestant.
Si l’Index pouvait créer un problème dans une université comme celle de Toronto, on peut bien imaginer quelle était la situation dans des universités québécoises. Mais il était clair que Gide ne pouvait pas être logiquement omis du programme. Depuis les années 20, ses textes étaient prescrits dans beaucoup de programmes du Canada. La quantité de pages consacrées à Gide dans les manuels de Lanson et Truffaut et d’autres histoires de la littérature française exigeait sa présence dans le programme, davantage même que Mauriac ou Claudel.
La Nouvelle Critique américaine
En arrivant à Harvard, j’ai trouvé que les professeurs respectaient le même corpus de textes qu’au Canada. Encore une fois, les cours du premier cycle étaient structurés par siècles. Mais dans les programmes des deuxième et troisième cycles, où j’ai été inscrit, les séminaires avaient souvent comme sujet les œuvres d’un seul auteur. Gide n’était pas un de ces auteurs, et une camarade de classe a vite quitté l’université, indignée que l’on n’offrît pas de séminaire sur Proust non plus. Peut-être est-elle partie pour Yale ou Columbia qui se vantaient d’une réputation prestigieuse pour leur Département de langues romaines. J’allais bientôt savoir que se trouvaient à Columbia deux spécialistes gidiens, Jean Hytier, dont le livre sur Gide[2] a été admiré par Gide lui-même, et Justin O’Brien, le traducteur américain du Journal de Gide[3], qui avait obtenu pour sa voiture une plaque d’immatriculation qui se lisait « GIDE ». La traduction du Journal avait une influence inattendue sur l’élite culturelle des États-Unis. On apprenait que pour être reconnues comme des personnes cultivées, il était recommandé de lire les auteurs que Gide mentionnait dans son Journal. On lisait la traduction de Justin O’Brien pour savoir quels autres livres il était nécessaire de lire (en traduction, sans doute) pour avoir l’air cultivé.
Gide ne m’intéressait pas suffisamment en 1958 pour m’inquiéter de l’absence d’un séminaire gidien à Harvard. Je me suis contenté de suivre un séminaire sur Montaigne, et un autre sur Rousseau. Évidemment, les textes autobiographiques me tentaient déjà.
L’enseignement biographique n’avait pas disparu à Harvard. Au contraire. Par exemple, deux professeurs français, Marcel Françon et René Jasinski, étaient particulièrement connus pour leur fidélité aux théories de Sainte-Beuve. Jasinski, auteur d’une histoire orientée « l’homme et l’œuvre » de la littérature française[4]venait d’exagérer sa méthodologie dans un volume mal reçu sous le titre Vers le vrai Racine[5]. Néanmoins, son séminaire sur Rousseau m’a bien plu. Ces deux professeurs français étaient opposés à des collègues considérés comme plus modernes, qui avaient découvert des vertus dans une méthodologie que l’on appelait « New Criticism ». René Wellek et Robert Penn Warren de l’Université Yale avaient publié peu avant leur nouvelle notion dans un livre qui s’appelait Theory of Literature[6], dans lequel ils prêchaient la nécessité de pratiquer l’ANALYSE thématique ET stylistique de textes. On trouvait le même message chez d’autres théoriciens de la littérature comme Wayne C. Booth dans The Rhetoric of Fiction[7]. Puisque cette méthodologie pouvait s’appliquer à la littérature de n’importe quel pays, ses disciples se groupaient naturellement dans des Départements de Littérature comparée desquels des collègues comme Messieurs Françon et Jasinski semblaient exclus. Le professeur Harry Levin offrait sous la rubrique de littérature comparée un cours sur le Réalisme dans plusieurs pays[8]. Le professeur Frohock, adepte de cette méthodologie, enseignait la littérature américaine dans quelques cours. Mais il a surtout illustré l’utilité de la nouvelle critique américaine en écrivant un manuel pour l’analyse de la littérature française sous le titre French Literature : An Approach Through Close Reading [9].
Sans grand spécialiste en Gide, l’Université Harvard possédait quand même un professeur que tout le monde associait au nom d’André Gide. Car Herbert Dieckmann, un dix-huitiémiste, avait rencontré Gide. Avec son grand ami le théoricien Ernst Robert Curtius, Dieckmann lui avait rendu visite, une visite que l’écrivain immortalisa dans son Journal. D’ailleurs, Dieckmann avait assisté au moins une fois aux Décades de Pontigny fréquentées par Gide. Une de ses photos, prise à l’un de ces fameux colloques, se trouve dans le volume de photos de Pontigny préparé par Pierre Masson et Jean-Pierre Prévost[10]. Dieckmann était un enseignant inoubliable, capable d’animer brillamment un séminaire de deux heures sans consulter une seule feuille de notes. Mais il n’enseignait jamais Gide.
Quand le moment arriva où j’ai été obligé de choisir un sujet de thèse et un directeur, ce n’était pas Dieckmann que j’ai choisi. C’était le professeur Frohock, parce que sa méthodologie me plaisait aussi bien que les auteurs qu’il enseignait. On décida ensemble qu’une thèse sur les implications stylistiques d’un narrateur inventé dans une œuvre de fiction pourrait être intéressante. J’allais donc étudier des ouvrages de Gide, de Mauriac et de Camus pour voir à quel degré la formation du personnage qui racontait l’histoire avait influencé la narration. J’ai commencé avec L’Immoraliste de Gide, essayant de voir si Michel, un historien, parlait, dans son récit, comme un historien. J’ai appris rapidement en ne relevant que le vocabulaire qu’avait choisi Gide pour Michel que la réponse était affirmative. Et j’avais tout de suite un nouveau sujet. J’allais étudier le vocabulaire abstrait de Gide dans une trentaine de ses textes.
J’ai été très content d’être tout d’un coup destiné à étudier exclusivement Gide pendant quelques années. Frohock, qui avait été professeur à Columbia avant d’être engagé à Harvard, m’a mis en contact avec son ancien collègue, Justin O’Brien. Celui-ci m’avait déjà ébloui par une conférence publique sur Gide qu’il avait présentée à Harvard devant plusieurs centaines de spectateurs. O’Brien m’a encouragé. Mais chose plus importante, Frohock a recommandé que j’aille en France pour écrire ma thèse.
La Méthodologie linguistique
On arrive maintenant à l’année 1962-1963 que j’ai passée à Paris. Même avant de payer mon loyer pour ma chambre peu chauffée dans le seizième arrondissement, j’ai cherché l’édition des Œuvres complètes de Gide préparée par Louis Martin-Chauffier pendant les années 1930. J’ai visité une multitude de boutiques de livres d’occasion dans le Quartier latin avant de trouver les 15 volumes dans la Librairie Gallimard du Boulevard Raspail. Pendant mes recherches, un vendeur a voulu me vendre un gros paquet de lettres identifié comme la correspondance entre Gide et son grand ami Eugène Rouart[11]. Sans doute, si j’avais eu l’argent et l’imagination, aurais-je acheté sur place cette correspondance dont une édition aurait pu sans doute remplacer mon sujet de thèse. Au lieu de cela, j’ai acheté une carte postale peu chère de la main de Gide et oublié bien vite l’adresse de la librairie. Je n’avais jamais pensé à la possibilité de demander à la Bibliothèque Houghton, la bibliothèque de manuscrits et de livres rares à Harvard, de considérer l’achat éventuel de ces lettres.
Pendant quelques semaines à la Bibliothèque nationale de France, rue de Richelieu, j’ai cherché tous les livres et les articles déjà publiés sur le style de Gide. Il n’y en avait pas trop. Assez tôt, j’ai établi une liste de mots qui semblaient très gidiens, comme « les quatre évangiles » du professeur O’Brien, « ferveur, inquiétude, déracinement, disponibilité[12] ». J’en ai trouvé d’autres chez Ernst Bendz[13], et j’en ai choisi quelques-uns moi-même. Donc avec une liste considérable de mots abstraits et de mots de la même famille linguistique, j’ai noté leur fréquence et leur contexte dans mes trente textes gidiens choisis. Mais je n’étais pas un linguiste. Qu’est-ce que j’allais faire avec ma documentation ? Il était évident que j’avais besoin d’une méthodologie. Mais le Professeur Frohock, qui n’était pas un linguiste non plus, et qui était, après tout, aux États-Unis, ne pouvait pas m’aider. Heureusement, un jour, en cherchant parmi des manuels de linguistique, j’ai trouvé une étude de Pierre Guiraud qui a expliqué sa théorie des mots-thèmes et des mots-clefs[14]. Grâce à Guiraud, j’ai pu établir quels étaient les mots-thèmes (les mots les plus fréquents d’un écrivain) et les mots-clefs (les mots utilisés plus souvent chez un certain auteur que chez ses contemporains). J’étais devenu un « linguiste » malgré moi. Un linguiste léger, bien sûr. Mais un linguiste.
Mais j’avais découvert en même temps que les linguistes ne s’intéressaient pas beaucoup à Gide. Pendant les années 1960, les livres de Léon Pierre-Quint et de Pierre Lafille restaient les études gidiennes de référence[15], aussi bien que La Jeunesse d’André Gide, une étude en deux volumes de Jean Delay – étude psychanalytique saluée dans les années 50, et aujourd’hui plutôt considérée simpliste[16]. Les ouvrages des Britanniques, Enid Starkie et George Painter[17], écrits en anglais, fournissaient de bonnes introductions à Gide, mais les Français préféraient le remarquable ouvrage de Germaine Brée : André Gide, l’insaisissable Protée[18]. Germaine Brée était alors une Française très respectée en Amérique, où elle enseignait et écrivait beaucoup sur Gide, Proust, Camus et d’autres auteurs du vingtième siècle. Beaucoup plus tard, j’ai fait sa connaissance, aussi bien que celle de Jean Hytier, le collègue de Justin O’Brien à Columbia. Il ne faut pas oublier que le livre d’Hytier aussi bien que le Portrait of André Gide d’O’Brien restaient d’une grande importance.
Le Structuralisme et la sémiologie
Je terminai ma thèse en 1964. Sa préparation avait pris beaucoup de temps, puisqu’à l’époque pré-ordinateur, il n’y avait aucune concordance pour m’aider à tabuler la fréquence de mots. J’ai dû les compter moi-même. D’ailleurs, l’Université Harvard n’acceptait pas d’exemplaires Xerox de la thèse. Donc on les tapait, trois exemplaires à la fois, avec une généreuse quantité de papier carbone[19]. Lors de ma dernière année à Harvard, j’ai cherché un poste d’enseignement. Heureusement, dans mon collège à l’Université de Toronto, à cause de l’augmentation des inscriptions, on cherchait encore un spécialiste en littérature française du vingtième siècle. Je me suis donc trouvé en septembre 1964 avec une centaine de professeurs de français à plein temps (et une cinquantaine d’autres) dans le Département d’Études françaises le plus développé au monde. On m’a demandé d’enseigner Gide dans le cours que j’avais suivi six ans auparavant. Ce que j’ai fait en y ajoutant un soupçon de narratologie, auparavant inconnue. Les autres auteurs du cours restaient les mêmes, à l’exception de Duhamel, remplacé par Camus. Gide restait aussi important avec la lecture obligatoire de trois textes. Bientôt, on me demandait d’offrir un séminaire de deuxième et troisième cycle (maîtrise et doctorat), pour lequel les étudiants se sont montrés très nombreux. Gide les intéressait. J’ai encouragé quelques-uns des meilleurs étudiants à soumettre au Bulletin des Amis d’André Gide leur essai écrit pour le séminaire. Bientôt, quelques étudiants ont entrepris sous ma direction des thèses de doctorat[20].
Mais chez pas mal de nouveaux jeunes enseignants, on sentait un changement. Ils avaient découvert les théoriciens littéraires français des années 1960. Donc au lieu de Balzac et de Proust, mes collègues lisaient Barthes et Greimas, Genette et Derrida. Les œuvres de fiction semblaient devenir plutôt des outils pour illustrer les théories qui intéressaient les chercheurs. La vie des auteurs n’offrait plus aucun intérêt et était par conséquent supprimée dans leurs cours avec d’autres détails sans importance comme la date de composition de l’ouvrage, ou la politique et l’histoire qui avaient inspiré sa naissance. André Gide a souffert peut-être un peu plus que d’autres auteurs, parce que, lui, il n’a pas été choisi comme Balzac (par Barthes) ou Proust (par Genette) pour illustrer des théories. Gide a eu pourtant son petit moment de gloire « structuraliste » grâce à Lucien Dällenbach[21], qui parlait généreusement de la fameuse « mise-en-abyme », un phénomène narratif que Gide avait défini, nommé, et utilisé même avant le début du vingtième siècle. En reconnaissant son importance dans cette discussion, Dällenbach rendait moderne notre cher auteur. Mais en général, on commençait à avoir honte de mentionner même les dates de naissance ou de mort des auteurs. L’Âge des structuralistes l’avait emporté.
À la fin de ma première année d’enseignement à plein temps, fatigué, j’ai voyagé avec des copains en Europe. Nous avons emporté avec nous le Journal de Gide pour suivre son itinéraire en Sicile. Un soir, dans un petit restaurant à Syracuse, j’ai reconnu un collègue de New York University, David Noakes, spécialiste de Radiguet[22], assis avec un monsieur plus âgé. Le jeune professeur Noakes nous a tout de suite présenté son compagnon de voyage, Jean Lambert, professeur à Smith College, ancien gendre d’André Gide, et auteur de Gide familier[23]. Les deux suivaient le même itinéraire gidien que nous ! Nous nous sommes donné rendez-vous pour nous retrouver à Palerme huit jours plus tard. Une coïncidence des plus inoubliables.
L’Étude de genres littéraires
Dans mes études, c’était toujours la narratologie qui m’intéressait. J’allais découvrir le plaisir et l’utilité de Figures III[24] de Genette. Mais pas tout de suite. Chez Gide, je voulais maintenant savoir si le style et la structure d’une autobiographie étaient forcément différents de ceux d’un récit fictif. Je me suis concentré sur Si le grain ne meurt. Pendant ma première année de recherches libres, toujours appelée une année sabbatique en 1971-1972, j’ai voulu en consulter le manuscrit à la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet. Que c’était compliqué ! Il était nécessaire d’obtenir la permission des quatre membres du « Comité Gide » avant de pouvoir le consulter. J’ai alors écrit à Jean Schlumberger, Jacques Naville, Auguste Anglès et Catherine Gide pour leur demander de communiquer leur permission à Monsieur François Chapon, le directeur assez extravagant de la bibliothèque. Quand j’y suis arrivé, j’ai découvert que l’un des membres du comité — je ne me souviens plus duquel — n’avait pas encore répondu, et j’ai dû attendre quelques jours la soumission de cette permission avant de pouvoir consulter le manuscrit.
Mais en attendant, j’ai eu le plaisir de faire la connaissance de Mademoiselle Cécile Jasinski, assistante de Monsieur Chapon et sœur de mon ancien professeur René Jasinski de Harvard. Elle ressemblait beaucoup à son frère. Ravie de rencontrer un admirateur de son frère chéri, elle m’offrait des bonbons chaque fois que j’arrivais dans la salle de travail de la bibliothèque. Un jour où je voulais collationner leur exemplaire de l’édition limitée (12 exemplaires) de 1920 avec d’autres éditions de Si le grain ne meurt, Monsieur Chapon a hésité un moment. Les pages n’étaient pas coupées ! Puis, en déclarant qu’après tout, c’était une bibliothèque plutôt qu’un musée, il m’a passé le livre avec un coupe-papier. Qu’il était raisonnable en reconnaissant que les livres étaient là pour être lus. Mais j’ai été horrifié d’être confronté à la responsabilité de couper les pages de ce livre précieux. J’ai exprimé ma consternation, et Monsieur Chapon a passé le livre et le coupe-papier à Mlle Jasinski qui a accompli cette tâche avec son sourire habituel. J’aurais dû lui offrir plusieurs kilos de bonbons.
Mon étude de Si le grain ne meurt, strictement une œuvre de jeunesse de ma part, s’est élargie jusqu’à la longueur d’un petit livre. J’y ai consacré la plupart des pages à la question de genres littéraires, à la spécificité du genre autobiographique qui diffère des mémoires, de l’histoire, et de la fiction tout en gardant quelques qualités de chacun. J’ai eu la bonne chance de trouver presque par hasard une maison de publication à Toronto et de recevoir l’approbation de Claude Martin, le président de la jeune Association des Amis d’André Gide fondée en 1968. Mais le livre[25] a eu aussi la mauvaise chance de sortir vers le même moment que l’étude séminale de Si le grain ne meurt par Pierre Lejeune[26]. J’aurais dû attendre et perfectionner mon ouvrage.
C’est au cours de cette période que j’ai commencé à alterner mon séminaire sur Gide avec un nouveau séminaire sur l’autobiographie en France. Après la lecture de théories sur le genre de l’autobiographie, on étudiait Les Confessions de Rousseau et d’autres textes jusqu’au Journal du voleur de Genet. Gide y jouait un rôle central.
À Toronto, je me trouvais entouré de tout une foule de collègues qui s’intéressaient à André Gide. Celui que je connaissais le mieux et que je respectais beaucoup était le professeur Jacques Cotnam, qui enseignait à York, un peu à l’extérieur de Toronto. Impressionnés par la présence avoisinante de tant de chercheurs gidiens, nous avons eu la bonne idée d’organiser avec notre collègue Andrew Oliver un colloque Gide pour 1975. Nous avons privilégié les nouvelles méthodologies. Une quinzaine de collègues canadiens ont consenti à y participer. Nous avons invité Claude Martin et Alain Goulet, les jeunes chercheurs français les plus vigoureux du moment. Un soir, nous avons préparé un banquet où le conférencier spécial était Jean Lambert, invité de Northampton, Massachusetts. Sa méthodologie n’était pas nouvelle, mais son sujet était passionnant : l’amitié entre Gide et Dorothy Bussy, dont il préparait une publication de la correspondance[27].
À plusieurs reprises j’ai dû demander à Catherine Gide la permission de consulter des manuscrits. Je me rappelle, par exemple, ceux de La Porte étroite et Thésée aussi bien que celui de Si le grain ne meurt. Elle répondait toujours positivement — parfois après certains délais. Donc quelle était ma surprise quand pendant l’automne 1975 j’ai commencé à recevoir des lettres fréquentes initiées par elle-même ! Elle voulait que la race de bergers picards qu’elle élevait soit homologuée comme une race de chien canadienne. Claude Martin lui avait alors suggéré de se tourner vers moi, un gidien canadien possiblement en mesure de l’aider. Donc, ravi de pouvoir rendre quelque service à cette femme si généreuse, j’ai commencé toutes les démarches nécessaires et lui ai rapporté régulièrement l’accomplissement de chaque étape. Finalement, elle a réussi à entreprendre plus facilement les mêmes démarches en Angleterre.
Mais pendant l’été 1976, pour nous remercier, madame Gide nous a invités, ma femme et moi, à prendre un déjeuner de dimanche à La Mivoie, sa maison dans la Vallée de Chevreuse. Nous sommes descendus du train où Catherine Gide elle-même nous attendait avec deux énormes chiens qui ont rempli presque toute sa petite voiture. Heureusement nous aimions bien les chiens. À un déjeuner très familial nous avons rencontré son fils Nicolas et sa fille Sophie. Après le repas, Catherine Gide nous a parlé d’une longue tradition familiale : on faisait une sieste après le déjeuner de dimanche. Est-ce que nous préférerions faire la même chose à l’étage, ou nous reposer dans le jardin ? Nous avons choisi le beau jardin que nous avons ensuite exploré avec plaisir jusqu’au réveil de la famille. Nous avons tous pris du thé ensemble avant d’être déposés à la gare. Une excellente journée. Très spéciale.
Une Période mal-définie : Les années 1980
Pendant les années 1980, nous avons remarqué une diminution de la présence de Gide dans le programme de littérature française à l’université. Et cela pour plusieurs raisons. D’abord, il y avait moins d’étudiants dans le programme. Ils choisissaient plutôt des programmes « plus pratiques » en relations internationales ou en affaires ou (plus tard) en informatique. Le programme de français devenait plus varié. Beaucoup d’étudiants s’orientaient alors vers des cours de langue et de linguistique plutôt que des cours de littérature. En général cette génération de jeunes, formés par le cinéma et la télévision et les récents magnétoscopes, étaient moins accoutumés à lire. Un cours de littérature pouvait devenir un défi indésirable. Bien sûr, le syllabus avait changé. Après tout, le vingtième siècle s’allongeait. Il y avait des « nouveaux romans » à étudier, et des romanciers comme Romain Gary/Émile Ajar à ajouter au curriculum. Ou au lieu de la littérature de l’Hexagone, on pouvait étudier la littérature de la francophonie. Et toute une panoplie de cours sur la littérature québécoise avait remplacé le seul demi-cours sur « la littérature canadienne-française » qui avait existé pendant les années 1950.
Le cours sur le roman de la première moitié du vingtième siècle restait, mais réduit à un cours facultatif. Maintenant, puisque chaque professeur était libre de choisir ses propres textes, le cours représentait les intérêts particuliers du prof de l’année. Nous avons pu constater que le syllabus d’une année de cette période était Malraux, Céline, Sartre, et Camus, un programme que les étudiants auraient pu trouver assez ténébreux et déprimant. Encore une raison expliquant la baisse des inscriptions ? Où se trouvaient Les Caves du Vatican quand on avait besoin de rire ?
Au niveau des deuxième et troisième cycles, l’intérêt porté à Gide avait presque entièrement disparu. La théorie, la francophonie, la linguistique et la littérature québécoise l’avaient remplacé.
Pendant une année sabbatique en 1978-1979, je pensais faire une étude profonde de Thésée, qui m’attirait depuis longtemps grâce à mes études de la littérature grecque. Mais j’ai fini par n’écrire qu’un seul article, sur la mythologie minoenne chez Gide et trois de ses contemporains[28]. Mon temps était pris ailleurs, car je m’étais inscrit comme étudiant dans un programme de sémiologie du cinéma, enseigné par Christian Metz, Raymond Bellour, Jacques Aumont, Noel Burch, et Michel Marie, entre autres. J’enseignais depuis quelques années dans le programme d’études cinématographiques à l’université et je voulais améliorer mon expertise en analyse. À Paris III et Reid Hall, je me suis trouvé converti à la méthodologie sémiotique pour l’analyse du cinéma[29]. Quant à la littérature, c’est à ce moment que j’ai trouvé la méthodologie de Gérard Genette, si proche de celle des sémioticiens du cinéma.
Gide et le cinéma
Durant la prochaine année de recherches en France (1985-86) j’ai consacré tout mon temps à l’étude de Gide et le cinéma, où j’ai trouvé qu’il serait logique de séparer trois aspects du sujet : Gide le spectateur, Gide le théoricien, et Gide le réalisateur. Au cours de mes recherches, j’ai contacté la comédienne Michèle Morgan pour lui poser des questions concernant le tournage de La Symphonie pastorale. J’ai été étonné quand elle m’a répondu en me téléphonant.
Au printemps 1986, j’ai remarqué dans un numéro du Bulletin des Amis d’André Gide une notice signalant que le manuscrit du scénario d’Isabelle avait été récemment vendu chez Drouot. Miraculeusement, de gentilles assistantes chez Drouot m’ont révélé que l’acheteur était la Bibliothèque Nationale. Finalement, en consultant à la Bibliothèque de l’Arsenal le manuscrit autographe alors « perdu », j’ai reconnu qu’il était sans doute incomplet et, hélas, que je serai obligé de le copier à la main. Ce que j’ai fait[30]. Deux ans plus tard, quand j’ai demandé à Catherine Gide la permission de publier ma découverte, elle a révélé l’existence dans ses archives d’une version complète et dactylographiée du scénario qu’elle m’a gentiment permis de consulter. Le manuscrit se trouvait dans son appartement à Paris. Étant absente de Paris au mois d’août quand je pouvais chercher le manuscrit, Madame Gide a demandé à sa femme de ménage de me le passer un lundi après-midi pourvu que je le rende le vendredi après-midi à la même heure. Quelques années plus tard, Catherine Gide m’a accordé la permission de publier le scénario dont Pierre Herbart avait été un collaborateur utile[31].
Lors de l’année sabbatique suivante, 1993-1994, je me consacrai aux textes et études sur Gide et le cinéma dans un seul volume sous le titre global de « Gide et le cinéma ». À part mes trois articles sur Gide spectateur[32], théoricien[33], et réalisateur[34] de cinéma, il existait des petits textes-clefs de Gide qui méritaient une nouvelle publication dans ce contexte, aussi bien qu’une étude que je préparais sur ses scénarios[35]. Donc, ayant préparé un ms. dans un format qui me semblait de proportions raisonnables, je suis parti à la recherche d’une maison d’édition. Après quelques mois, j’ai trouvé la maison Méridien-Klincksieck, vivement recommandée par un de leurs auteurs publiés, un collègue canadien. On y a gardé le manuscrit quelques mois avant de m’appeler à une réunion où on m’a parlé avec enthousiasme du projet. L’éditeur m’a demandé de revenir dans six semaines avec les photos que je voulais utiliser comme illustrations dans ce livre qui ne parlait que de films et d’images. En cherchant les huit photos que je considérais essentielles, j’ai dû contacter le petit-neveu de Gide, Michel Drouin, que j’avais déjà rencontré dans un cercle d’étudiants en 1962 à Paris. Une des photos était identifiée comme la propriété d’une certaine Anne-Marie Drouin que je voulais contacter. Michel m’a assuré que c’était son père, Jacques Drouin, que je devais voir. Michel a ensuite arrangé une visite chez son père, un neveu de Gide, qui a partagé avec moi ses souvenirs en me servant gentiment du thé. Mais quand je suis retourné chez Méridien-Klincksieck, les photos sous le bras, on m’a dit que l’on avait changé d’avis. Il n’y aurait aucune publication chez eux de « Gide et le cinéma ». Peu après, la maison a souffert une banqueroute.
En rentrant de cette année sabbatique, le Département m’a demandé de faire le seul cours de littérature pour les étudiants de la première année, un panorama de la littérature française de La Chanson de Roland à Eugène Ionesco. Naturellement, pour le cycle de textes du vingtième siècle, j’ai choisi un texte de Gide.
Mais le texte devait être court. Donc, pour ces étudiants de 18 ans, c’était Le Retour de l’enfant prodigue qui a servi comme introduction à ce récipiendaire du Prix Nobel de littérature plutôt qu’un texte plus typique.
Curieusement, pendant les années 1990, quand j’ai offert après un intervalle de plusieurs années un séminaire avancé sur Gide, plus narratologique que jamais, une nouvelle génération était prête à savourer cet auteur qu’ils connaissaient si peu. Son enseignement était pour moi un plaisir, mais bientôt le programme d’études cinématographiques a eu besoin d’un séminaire sur le cinéma de Jean Cocteau, qui a attiré des étudiants plus nombreux[36].
Les études culturelles et les études des sexualités
En rentrant en 1994, j’ai été aussi surpris par une nouvelle étape dans l’évolution des études françaises. On avait dressé un nouveau programme d’études culturelles françaises. Tous les cours seraient présentés en anglais avec des textes traduits en anglais. On cherchait dans le programme une variété de sujets. On allait donc offrir un cours sur « Loi et littérature », sur « De Napoléon à Astérix », etc. D’ailleurs, l’université avait aussi lancé un programme d’études sur les sexualités. Pourquoi ne pas offrir un cours qui pourrait servir dans ces deux programmes en même temps sous le titre « La Littérature gay et lesbienne de Gide à Genet » ? Le cours, qui prescrivait des textes (en anglais) de Gide, Proust, Cocteau, Colette, Renée Vivien, Julien Green, Violette Leduc et Genet, attira de nombreux étudiants et était considéré important pour sa contribution à la notion de « diversité » dans le curriculum.
C’est là où se trouve sans doute Gide dans les universités d’Amérique du Nord en 2018 : un auteur qui continue de mériter une place dans la littérature française, mais qui est surtout reconnu comme un personnage de grande importance dans l’histoire des sexualités. L’auteur de L’École des femmes pourrait aussi jouer un rôle dans les cours sur le féminisme. Nous nous demandons également si l’on reconnaît de nos jours l’importance de Gide dans les nombreux cours sur l’autofiction dont il est l’un des précurseurs. Et qu’est-ce que Gide aurait pensé de ses héritières, Madeleine Chapsal, Annie Ernaux, et Camille Laurent ?
Quant à moi, depuis ma retraite en 2001, on m’invite à faire à Paris des conférences assez légères sur la vie mouvementée de quelques-uns de mes auteurs préférés[37]. J’accueille chaleureusement cette évasion du structuralisme, de la sémiotique, de la linguistique, de la francophonie, du féminisme, de l’autofiction, de l’étude de genres (littéraire et autre), etc. C’est un joyeux retour à mes racines.
[1] Une expression courante au Canada, qui trouve ses origines dans le titre d’un roman de l’écrivain canadien Hugh MacLennan, Two Solitudes, Toronto, Macmillan of Canada, 1945.
[2] Jean Hytier, André Gide, Alger, Charlot, 1945.
[3] André Gide, The Journals of André Gide, 4 vols. translated from the French by Justin O’Brien, New York, Knopf, 1947-1951.
[4] René Jasinski, Histoire de la littérature française, 2 tomes, Paris, Boivin, 1947.
[5] 2 tomes, Paris, Armand Colin, 1958.
[6] New York, Harcourt, Brace and Company, 1948.
[7] Chicago, The University of Chicago Press, 1961.
[8] Voir Harry Levin, The Gates of Horn, London, Oxford University Press, 1963, pour une étude des auteurs français de ce cours.
[9] Cambridge, Mass., Schoenhof’s Foreign Books, 1962.
[10] L’Esprit de Pontigny, Paris, Orizons, 2014.
[11] Cette correspondance a été finalement publiée dans André Gide-Eugène Rouart, Correspondance 1893-1936, éditée par David H. Walker, 2 tomes, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2006.
[12] Dans Portrait of André Gide, New York, Knopf, 1953.
[13] Voir son André Gide et l’art d’écrire, Paris, Messageries du Livre, 1939.
[14] Les Caractères statistiques du vocabulaire, Paris, Presses universitaires de France, 1954.
[15] Voir Léon Pierre-Quint, André Gide, sa vie, son œuvre, Paris, Stock, 1932 et Pierre Lafille, André Gide romancier, Paris, Hachette, 1954.
[16] Jean Delay, La Jeunesse d’André Gide, 2 tomes, Paris, Gallimard, 1956-1957.
[17] Voir Enid Starkie, André Gide, London, Bowes et Bowes, 1953 et George Painter André Gide, A Critical and Biographical Study, London, Arthur Barker, 1951.
[18] Paris, Les Belles-Lettres, 1953.
[19] Deux chapitres de la thèse, modifiés, ont été publiés : « Image-conveying Abstractions in the Works of André Gide », in Image and Theme: Studies in Modern French Fiction sous la direction de W.M. Frohock, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1969, p. 99-123 ; et « Le Mot-thème “attente” et l’ironie gidienne, » Bulletin des Amis d’André Gide 10, 53 (janv. 1982), p. 39-49.
[20] Par exemple, Samiha Yassa Abdel Sayed, « L’Art d’André Gide-écrivain d’après sa traduction d’Hamlet de Shakespeare », 1975, et Diane Carolyn Fleming, « A Critical Edition of André Gide’s Œdipe », 1983.
[21] Voir son Le Récit spéculaire :essai sur la mise en abyme, Paris, Seuil, 1977.
[22] David Noakes, Raymond Radiguet, Paris, Seghers, 1968.
[23] Paris, Julliard, 1958.
[24] Paris, Seuil, 1970.
[25] Publié comme C.D.E.Tolton, André Gide and the Art of Autobiography, Toronto, Macmillan of Canada, 1975.
[26] Voir Philippe Lejeune, Exercices d’ambiguïté. Lectures de Si le grain ne meurt, Paris, Minard, 1974.
[27] Correspondance André Gide-Dorothy Bussy (1918-1951), 3 tomes, Cahiers André Gide 9, 10, 11, Paris, Gallimard, 1979, 1981, 1982. Les Actes du Colloque ont été publiés sous le titre André Gide : Perspectives contemporaines, Paris, Minard, 1979.
[28] Voir C.D.E.Tolton, « Doxa and Paradox: Modern French Writers and Minoan Mythology, » Kentucky Romance Quarterly, vol. 31, no 4 (Dec. 1984), 379-89. Une autre excursion dans le monde de la mythologie s’appelle « Symbolism and Irony: A New Reading of Gide’s Traité du Narcisse » Studi Francesi, anno XL, fasc. II (maggio-agosto 1996), p. 271-284.
[29] Pour voir ma tentative d’analyse sémiotique d’un film gidien, regarder « D’André Gide à Jean Delannoy. L’Optique de La Symphonie pastorale », MANA (Mannheim), vol. 7 (1987), p. 279-301.
[30] Jai décrit ce parcours dans un article « A Lost Screenplay Unearthed , André Gide’s Isabelle », The Modern Language Review, vol. 88, no 1 (Jan. 1993), p. 84-90.
[31] Voir André Gide et Pierre Herbart, Le Scénario d’’Isabelle », édité par C.D.E.Tolton, Paris, Minard, 1996.
[32] « Gide au cinéma », BAAG, 107 (juillet 1995), p. 377-409.
[33] « Réflexions d’André Gide sur le cinéma » BAAG, 93 (janv. 1992), p. 61-71.
[34] « André Gide et le cinéma », in Emmanuelle Toulet et Christian Belaygue (éd), CinéMemoire, Paris, CinéMemoire, 1993, p. 198-202.
[35] « L’Écriture cinématographique d’André Gide, » in L’Ecriture d’André Gide 1 : Genèse et spécificités, Paris, Minard, 1998, p. 191-210.
[36] Voir C.D.E.Tolton (editor), The Cinema of Jean Cocteau, Ottawa, Legas, 1999, une collection des essais écrits par des étudiants de ce séminaire.
[37] Cameron Tolton, Secrets et scandales littéraires de Chateaubriand à Genet, Aix-en-Provence, Éditions Persée, 2016, est un recueil de six de ces conférences.