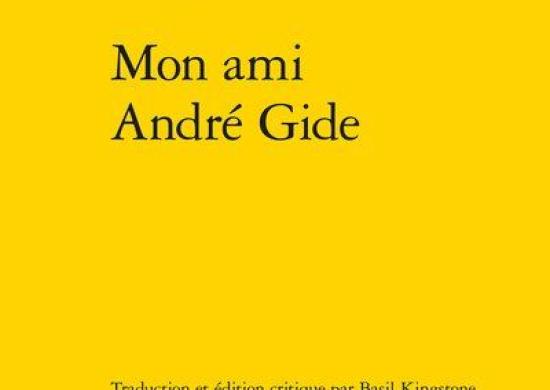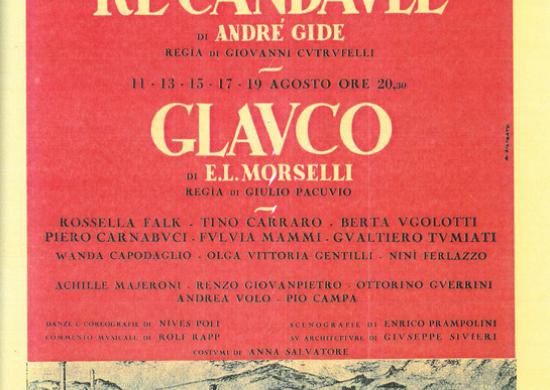« Tâcher d’avoir le temps d’aller au Jardin des Plantes ; y étudier les variétés du petit Potamogéton pour Paludes. »
Gide, Paludes, 1895
Agnès Varda disait : « Je ne veux pas montrer, mais donner l’envie de voir. » Il y a bien quelque chose de cet ordre-là dans l’écriture gidienne : une invitation à regarder, une incitation à la curiosité comme un désir de connaissance, un lieu pointé du doigt. Pourquoi, sinon, donner une place importante, dans un récit aussi court, épuré et vain que Paludes, au « petit potamogéton » ? Le mot est posé. Au lecteur (du XXIe siècle) de se demander : mais c’est quoi, le petit potamogéton ? (et de taper dans son navigateur un nom — c’est rare — qui n’a pas encore sa proposition automatique…). On a envie de voir, oui, parce que rien ne nous est montré — seulement pointé.
La rencontre avec la botaniste Véronique Scius-Turlot le 30 avril dernier à la pépinière municipale de Mulhouse voulait savoir quoi. Les chercheurs du groupe Gide Remix ont eu la bonne idée de convier une spécialiste des plantes à lire Gide à travers son expérience, pour comprendre ces végétaux qui animent et parsèment l’œuvre de Gide, sous forme de métaphores comme d’observations. Comprendre, à la lumière de la botanique, les enjeux de la « Querelle du Peuplier » — et ainsi se rendre compte que jardiner avec les mots n’engage pas le même savoir-faire que de prendre soin des plantes, que le déracinement dont parlent Gide et Barrès ne s’applique qu’assez mal à celui qui concerne les arbres, les vrais : « On ne déracine que les arbres morts ou sacrifiés ; sinon, on parle de transplantation. La transplantation garde l’arbre vivant. » Lorsque la métaphore s’applique au rapport que Gide a à l’écriture de son livre — « Considérer la touffe avant d’attaquer » —, la botaniste approuve et enrichit : « Je vois en Gide l’arboriculteur qui travaille la taille de l’arbre. Si l’arboriculteur taille l’arbre, c’est pour permettre à la lumière d’entrer. »
La rencontre entre l’écriture et la botanique est à la fois évidente et étonnante. Tout simplement évidente, d’abord, parce que l’encre se pose sur des feuilles, parce qu’on écrit comme on respire, avec des arbres, évidente parce que le principe qui anime le vivant est celui même qui anime l’écriture, parce que les métaphores sont souvent bienvenues et éclairantes quand il s’agit de parler littérature ou philosophie à coups de rhizome (Deleuze et Guattari), d’arborescences, de sèves pour remonter à la surface du corps dans des feuilles d’herbe (Whitman évidemment), de nos origines comme de racines et de nos corps comme des branches… Littérature et botanique : un inépuisable sujet, qui pourrait être déroulé, tout à fait au hasard — roulette des citations —, à partir de cette phrase, d’un naturaliste justement : « La science des plantes est la plus haute poésie du règne végétal » (Kuetzing, 1851).
Étonnante, parce que les mots manquent aujourd’hui pour définir ce que l’on trouve encore dans les pages de Gide (qui lisait notamment l’entomologue, éthologue, poète… Fabre), et si rarement chez les auteurs contemporains : un vocabulaire du vivant. Pour contrecarrer cette tendance à l’éloignement, comme si revenir à la nature était d’abord revenir aux mots, nombreux sont ceux qui reviennent, comme Baptiste Morizot pistant le loup, avec un texte qui fait place à la trace, comme Romain Bertrand avec son Détail du monde, à l’« art perdu de la description de la nature » dont « au moins la quête dessinait-elle une compassion et, indiquant le lieu d’une attention au monde, invitait à la retenue dans la manière d’en user avec lui ». Prendre le temps de regarder et de nommer, c’est évidemment donner une chance au vivant de garder ou plutôt prendre la place qui devrait être la sienne. (Et l'on a plus de mal à tuer une vache nommée Marguerite qu'à décapiter un veau numéroté.)
Véronique Scius-Turlot vient le confirmer : « Gide sait de quoi il parle, quand il écrit : “Je chante la figue.../ Dont les belles amours sont cachées./ Sa floraison est repliée. Chambre close où se célèbrent des noces...” Il connaît bien la figue, puisque la fleur est à l’intérieur du sycone [la figue n'est pas un fruit mais le réceptacle d'une pulpe comestible], elle compte des milliers de petites fleurs fécondées par un petit insecte qui vont se transformer en graines. » Peu de gens en effet savent cela aujourd’hui.
Il faut donc passer par les mots pour entrer dans la relation (une relation éthique du moins) au monde. Et dépasser cet art de la description qui était aussi celui d’une époque collectionneuse (agraffeuse de papillons, disons).
Si l’on relit Gide en 2019 avec une botaniste qui travaille à la fois à peupler les ronds-points mulhousiens de fleurs multicolores à butiner (des yeux pour nous, du nez, du museau, pardon de la trompe, pour les bestioles), à tenir un laboratoire de biodiversité et à organiser des ateliers en pleine nature pour apprendre à reconnaître les plantes sauvages comestibles, c’est bien la preuve que l’on est prêt à faire un grand bond en avant tout en ayant enclenché la marche arrière. Nous vivons dans un monde que nous connaissons encore mieux — les noms se sont perdus, mais certains prennent le temps de nous le rappeler, et les études éthologiques vont bon train.
Plus nous comprenons les plantes, les animaux, et plus nous comprenons l’homme, plus nous nous approchons de ce qu’il est appelé à devenir dans le lien à ce qui n’est pas hors de lui, mais qui l’habite, et qu’il habite. Une sorte, peut-être, de potamogéton, dont, nous dit Veronique Scius-Turlot, "il existe des centaines de formes !" Une plante, à l’image de l’écriture, comme le lieu d’une vie dense, à la fois en surface et en profondeur, aux articulations souterraines, aux ressorts plongés dans l’ombre et aux secrets maintenus dans la vase, avec des révélations comme de petites bouées noires naviguant à la surface de la page blanche, en pleine lumière : “Potamogéton : Plante aquatique vivace, hermaphrodite, monocotylédone, herbacée, aux fleurs groupées en épi et dont les feuilles sont en partie flottantes et en partie submergées.”
Maintenant, vous vous demandez : monocotylé… quoi ?
Faire entrer dans la langue, c’est sauver. Tant de vivant à sauver aujourd’hui qu’on ne peut plus se passer des mots pour le décrire. Il faut dérouler le tapis rouge au vivant. Mais pas pour le tenir à distance, non. Le vivant n’a pas besoin de nous pour parler (notre corps, même, n’a pas besoin de notre tête bien pensante pour parler — Gide voulait d’ailleurs, dans son écriture, sentir au lieu de penser), mais nous avons besoin de parler pour entrer en communication avec lui, avec nous, pour entrer enfin dans notre relation au monde, et que l’on en finisse avec le déracinement. Nommer la variété des potamogétons comme celle des tomates, c’est se donner l’occasion, dans le savoir, de la sauvegarde, et de la survie.
Nommer, comme l’a très justement suggéré Véronique Scius-Turlot, n'est que le lieu du commencement : « La plante à un nom, comme nous. Il faut le connaître, mais ce n’est qu’un point de départ. Ensuite, il faut l’observer… Regardez ce Monstera : pourquoi ses racines sont elles aériennes ? »
Le Monstera est une liane. Elle développe ses racines à l’extérieur (vers le ciel, comme dans le très beau titre — et livre — de Romain Gary Les Racines du ciel) pour s’accrocher aux arbres et capter l’humidité présente dans l’air. La Monstera est une liane. Un lien.