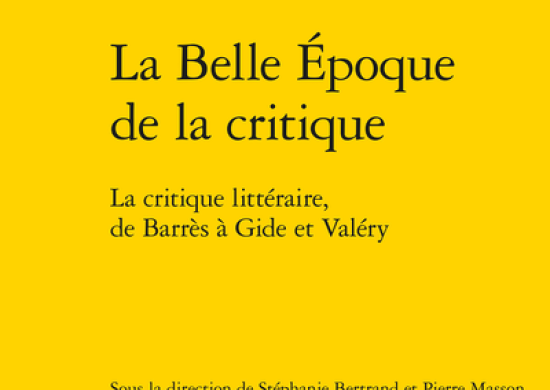Amal et la lettre du Roi, d’après The Post Office de Rabindranath Tagore (1861-1941), est la première traduction dans le répertoire d’André Gide. Il y en aura d’autres. Le conte oriental philosophique du grand écrivain indien – poète, romancier, dramaturge, dessinateur, peintre et véritable monument national de son pays – marque une plaisante parenthèse dans son théâtre, parmi les sujets bibliques ou homériques.
Écrit en quatre jours en bangla, la langue du Bengale où Tagore est né, The Post Office était paru en 1912. Aussitôt, le poète irlandais William Butler Yeats (1865-1939), futur Prix Nobel de littérature 1923, traduit la pièce en anglais, et la fait jouer en 1913, d’abord à Dublin, puis à Londres. Elle sera traduite et représentée par la suite dans d’autres pays européens (Allemagne, Espagne…).
C’est grâce à Yeats également, via leur ami commun le poète-diplomate Alexis Leger dit Saint-John Perse (1887-1975, Prix Nobel de littérature en 1960), alors en poste à Londres, que Gide avait découvert l’œuvre de Tagore, et traduit son chef d’œuvre, le Gitanjali, sous le titre L’Offrande lyrique. Le recueil était paru aux Éditions de la N.R.F. en 1913, l’année même où Tagore recevait le Prix Nobel de littérature. Joli coup.
Dans la foulée, ainsi que son Journal l’atteste, Gide, désireux de conserver Tagore parmi les auteurs de la NRF, lit les épreuves de The Post Office que lui a envoyées son éditeur anglais, Macmillan, à qui il écrit « (son) intention de le traduire ». Et il ajoute que Jacques Copeau « qui vient de le lire également, est très disposé à le monter au Vieux-Colombier » (27 juin 1914). Il se mettra à la tâche le 6 juillet, et une dernière notation, le 8, indique qu’il y travaille quotidiennement. Il est évident qu’il a achevé son travail, sans doute assez rapidement. Mais, on ignore pourquoi, la pièce, devenue Amal et la lettre du Roi, ne sera publiée que huit ans plus tard. En 1922, chez l’éditeur d’art Lucien Vogel, dans une édition bibliophilique tirée à 142 exemplaires, avec sept gravures sur bois de Léonard Foujita (1886-1968), le plus parisien des artistes japonais. Le texte sera repris en 1924 dans la petite collection Répertoire du Vieux-Colombier, aux Éditions de la N.R.F., ce qui confirme qu’Amal aurait dû être joué dans le théâtre de Copeau.
Il n’en fut rien. La pièce a finalement été créée en 1934-1935 au Studio des Champs-Elysées, puis jouée à nouveau, à l’hiver 1936-1937, au théâtre des Mathurins. La mise en scène était signée de l’homme de théâtre, acteur, metteur en scène d’origine russe Georges Pitoëff (1884-1939), avec qui Gide retravaillera plus tard, et « augmentée » d’une musique de Darius Milhaud (1892-1974). À son sujet, Gide rapporte, dans son Journal, à la date du 28 septembre 1915 : « Darius Milhaud est venu hier, vers la fin du jour, jouer le poème symphonique qu’il vient de composer sur un des poèmes de Tagore que j’ai traduits. Où je n’ai entendu que du bruit. » Il collaborera pourtant, par la suite, à nouveau, avec le compositeur.
Gide, qui avait noué une relation amicale avec Rabindranath Tagore et correspondait avec lui, n’en restera pas là. En 1916, alors qu’il traversait une grave crise, à la fois personnelle, spirituelle et créative, il s’était lancé dans la traduction des Songs de Kabîr, un poète mystique indien des XVe-XVIe siècles, passées du vieil-hindi au bengali, puis mises en anglais par Tagore.
Il n’achèvera pas sa tâche, mais vingt-deux poèmes traduits demeurent, restés totalement inédits jusqu’en 2011[1].
Amal, le héros de Post Office, est fort éloigné des précédents personnages gidiens. C’est un jeune Bengali qui, orphelin, a été adopté par Madhav, un riche marchand. Il habite une belle maison, sur la place principale de son village, là où le roi a fait construire un bureau de poste. Il le voit de la fenêtre de la pièce où il se tient tout le jour, conversant avec ceux qui passent à sa portée. Car l’enfant, atteint d’une maladie incurable, s’est vu interdire par le médecin, impuissant et superstitieux, de sortir jamais de chez lui. Rien ne doit le fatiguer, alors que lui ne rêve que de voyages lointains et de métiers amusants, comme facteur. Il rêve, d’ailleurs, que le roi, « qui envoie des petites lettres aux petits garçons », lui en envoie une à lui, même s’il ne sait pas lire. Et qui sait ? le souverain en personne viendra peut-être lui rendre visite…
Dans un style très oral, parfois familier, bien moins apprêté que celui de ses pièces en costume, Gide s’est glissé dans l’univers décrit par Tagore, inspiré, ainsi qu’il l’a confié, de sa propre enfance. Le jeune héros est forcément touchant, souffrant dans son corps mais si fort dans son imagination. Et, même si la pièce se situe en Inde, elle est assez peu « exotique » ; l’histoire qu’elle conte, celle d’un enfant malade qui va mourir, est universelle. C’est ce qui a requis Gide, sans conteste. Mais il ne traduira plus d’autre œuvre de Tagore. Le 17 janvier 1918, il note dans son Journal, après avoir lu ses Réminiscences : « Mais cet Orient des Indes n’est pas fait pour me convenir. »
[1] Les manuscrits ont été montrés dans notre album André Gide ou la tentation nomade (Flammarion, 2011), puis publiés en recueil sous le titre La Flûte de l’Infini (Poésie / Gallimard, 2012).