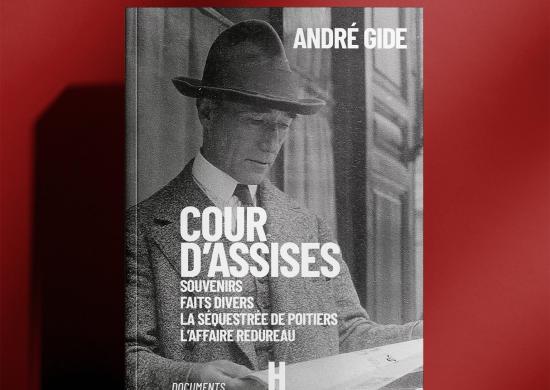Réalisé sous la direction de Pierre Masson et Jean-Michel Wittmann, et par une équipe de chercheurs et d’universitaires spécialistes de l’œuvre de Gide — Jean Claude, Alain Goulet, Pierre Lachasse, Patrick Pollard, Martine Sagaert, Peter Schnyder, David Steel et David H. Walker1 —, le Dictionnaire Gide représente pour le spécialiste gidien comme pour le novice, un outil de travail essentiel.
En privilégiant une approche pluriforme de la question gidienne, cette collaboration aboutit à un ouvrage reflétant bien l’abondance et la diversité de l’œuvre. En effet, ce dictionnaire — qui respecte le système de classification par ordre alphabétique — mise sur une présentation englobant la question des patronymes, des toponymes, tout en faisant la part belle aux thèmes cruciaux de l’œuvre : la femme, l’homosexualité, les voyages, le théâtre, etc.
Ainsi aux choix thématiques, voire idéologiques abordées dans l’étendue de leurs tenants et aboutissants (citons par exemple l’article consacré à l’homosexualité dans lequel Alain Goulet expose les tourments du petit garçon, puis la position sociale et culturelle de l’adulte revendiquant son droit à la normale homosexuelle), viennent se joindre des références sur les proches (Jean Schlumberger, Roger Martin du Gard, Paul Valéry), et sur les influences gidiennes ayant marqué son œuvre et lui ayant parfois servi de modèles : Virgile, Victor Hugo, mais aussi Edgar Poe.
L’impossible exhaustivité mentionnée dans la préface a su être transformée en élément positif puisqu’elle a conduit la critique « à privilégier l’environnement proprement littéraire et l’œuvre elle-même », ce qui explique notamment le choix de proposer une présentation des ouvrages gidiens, et avec eux une définition du contexte socioculturel de l’époque. Ajoutons l’importance des références d’articles et d’ouvrages annexes permettant au lecteur d’approfondir, s’il le désire, certains sujets.
L’extrême richesse de la vie et de l’œuvre gidiennes rend ce dictionnaire indispensable pour aborder l’univers d’André Gide dans toute sa substance et sa complication. La tâche n’était pas aisée, et on peut donc apprécier la qualité de cette exploration offerte par ce dictionnaire monographique à propos duquel nous pouvons gager que la multitude des informations réunies dans cet opus incitera le lecteur d’aujourd’hui à adopter une posture identique à celle du lecteur gidien, dont la qualité première recherchée par Gide lui-même était le refus de la paresse.
[1] D’autres chercheurs ont contribué à ce dictionnaire : Clara Debard, Céline Dhérin, Claude Foucart, Luc Fraisse, Frank Lestringant, Eric Marty, Pascal Mercier, Valérie Michelet-Jacquod, Jocelyn Van Tuyl.