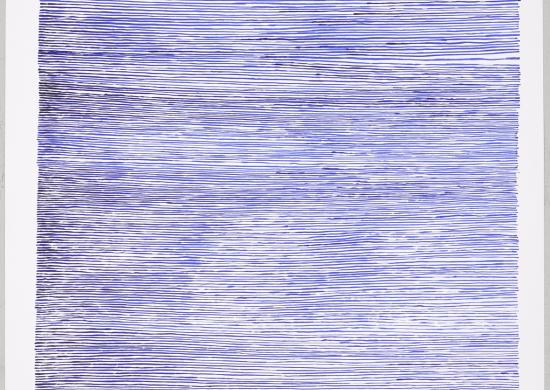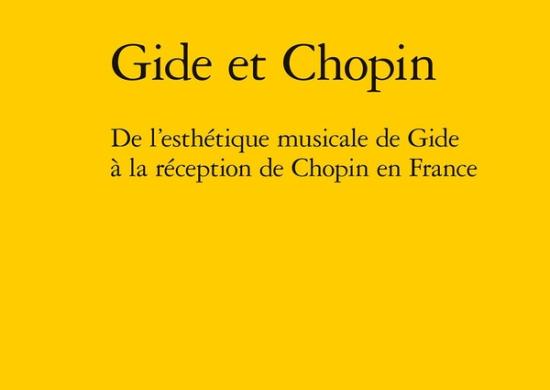On connaît, chez André Gide, cette constante longueur dans la maturation de ses projets. Dans son formidable jaillissement créatif, telle idée, conçue à un moment donné, peut devenir un livre et se voir publiée des années, voire des décennies plus tard. C’est le cas pour sa pièce Proserpine, « symphonie dramatique en quatre tableaux » laissée inachevée (en fait un synopsis détaillé, avec seulement quelques fragments rédigés), qui a servi de matrice à son double, Perséphone, achevée, elle, en 1933, jouée et publiée en 1934.
D’après Richard Heyd, Proserpine aurait été écrite par Gide « aux environs de 1904 ». On n’en trouve nulle mention à cette date dans le Journal. En revanche, en février 1912, l’écrivain note une « veillée » avec son ami Jacques Copeau, au cours de laquelle ils lisent des « fragments d’Ajax et de Proserpine » qu’il envisageait de publier dans la revue Vers et Prose. Le texte, tel qu’il est, sera publié pour la première fois en 1928, dans le tome IV de ses Œuvres complètes. L’histoire aurait pu s’arrêter là.
Mais, dans ses indispensables Cahiers (tome II, 1929-1937, Les Cahiers de la NRF, Gallimard, 1974) Maria Van Rysselberghe, la Petite Dame, rapporte, à la date du 19 janvier 1933, ces propos de Gide : « Vous ai-je déjà dit que j’avais ces jours-ci revu Ida Rubinstein ? Je ne sais plus comment j’ai été amené à lui dire que j’avais un petit ballet qui dormait depuis trente ans, Proserpine ; elle a demandé à le voir, et la voilà qui s’emballe ! Elle voudrait décider Stravinski à faire la musique, Sert les décors et donner ça pour son chant du cygne. » L’histoire est intéressante à plus d’un titre. D’abord, ainsi que la Petite Dame le précise, les deux se connaissaient, avaient déjà travaillé ensemble, en 1920, pour monter Antoine et Cléopâtre dans la version de Gide. Et cela ne s’était pas passé sans frictions. Ensuite, on notera que Gide n’a pas dû résister longtemps à l’enthousiasme de la danseuse, actrice, metteur en scène et riche mécène juive russe (ukrainienne, en fait). « La tentative m’amuserait commente-t-il, ça me donnerait un mois de travail pour mettre la chose au point ; peu de texte, du reste, des prétextes à gestes et à danses. » Ce qui aboutira au texte de Perséphone et à un désaccord fondamental avec le compositeur, Igor Stravinski, russe également – ainsi qu’on le verra plus tard. On relèvera enfin la muflerie sur le « chant du cygne » de la danseuse, laquelle avait fait ses débuts dans les années 1900 au sein des Ballets russes de Diaghilev, et avait donc, en 1933, 48 ans.
Il y a aussi, dans cette page, une phrase de Gide qui ne laisse pas de nous étonner. « Moi, ça m’est égal, glisse-t-il, je crois de moins en moins au théâtre, je n’y attache aucune importance… » Parle-t-il du théâtre en général, ou de son propre théâtre ? Sincérité ou fausse modestie ? Avec ce Bipède, on n’en est pas à un paradoxe, à une contradiction près. Mais la déclaration demeure bizarre, sachant, comme on l’a vu, que l’activité dramatique (écriture, traductions, adaptations, représentations) l’a quand même accompagné durant presque toute sa vie littéraire. D’ailleurs, deux jours après, le 21 janvier 1933, Maria note que Gide songe déjà à rejoindre Stravinski, en tournée, « pour parler de ce projet ». Lequel aboutira, et qu’il aura l’élégance de dédier « À Madame Ida Rubinstein dont la ferveur a su ranimer un projet endormi depuis plus de vingt ans ».
Dans son Journal, en revanche, une seule mention de Perséphone, à la date du 1er juin 1933. Ce jour-là, Gide s’est rendu à Saint-Louis-des-Invalides, en compagnie de Strawinsky (sic) et d'Ida Rubinstein, afin d’entendre « une chorale d’enfants » qu’ils songent à « emprunter » à son directeur, le père Gillet, un dominicain, pour le Troisième tableau de la pièce, où le Chœur des Enfants joue un rôle important. L’anecdote est plaisante, et atteste bien que le travail est en cours entre les trois principaux protagonistes : auteur impliqué dans tout le processus, compositeur, et actrice-metteur en scène. Trois stars, que rejoindront un jeune chorégraphe, et un décorateur-costumier. Les problèmes viendront bientôt.
Le texte de la pièce, lui, est paru chez Gallimard en 1934. Avec Proserpine et Perséphone, qui sont les deux noms – l’un latin, l’autre grec – d’une même divinité, Gide continue de revisiter les grandes figures de la mythologie antique. Chez les Grecs (et le sujet des pièces est présenté comme inspiré du chant XI de l’Odyssée d’Homère), Perséphone (aussi appelée Corè) est la fille de Zeus et de Déméter, la déesse de la terre cultivée (la Cérès des Romains). Enlevée par Hadès (Pluton), le dieu des Enfers qui l’entraîne avec lui dans son royaume souterrain et en fait sa reine, sa mère inconsolable finit par obtenir de Zeus un compromis imposé à Hadès : Perséphone passera trois mois avec lui sous terre, et le reste de l’année sur terre. En reconnaissance, la mère et la fille confient l’épi de blé à Néoptolème, prince d’Eleusis, chargé de répandre la plante nourricière dans le monde entier, qu’il sillonne sur son char. Comme pour la plupart des mythes grecs, les Romains l’ont repris, adapté, et Proserpine, déesse des Enfers, a été identifiée à Perséphone. Bien sûr, il est aisé d’y lire une interprétation symbolique et poétique du cycle des saisons, avec les semailles et les moissons, la mort de la nature et sa renaissance. Ce qui explique les rapports avec les Enfers, et le lien avec les Mystères d’Éleusis, centrés autour de la mort et de la résurrection. Le christianisme primitif a , de son côté, voulu y voir une préfiguration de son propre credo.
Proserpine se présente comme une « symphonie dramatique en quatre tableaux », où les protagonistes portent leurs noms romains. Quatre sont « parlants » : Proserpine, Cérès, Pluton et Calypso. L’un « chantant », Eurydice, les autres sont des ombres (comme Triptolème) ou des personnages mimés. S’y ajoutent trois chœurs. Détail amusant, Gide précise que ses « parlants » pourraient être « simplement mimés », et son « chantant » « supprimé », le tout « au besoin ». Comme s’il ne croyait guère lui-même à la viabilité de son projet. La majeure partie du texte est constituée du récit fait par l’auteur de son intrigue, avec des notations de mise en scène, ou d’interprétation des acteurs, parfois assez précises.
Dans le Prologue / Premier tableau, la jeune Proserpine, en train de cueillir des fleurs printanières, est attirée par l’étrange narcisse, chargé d’une grande puissance émotionnelle puisque lié à un autre mythe – celui du beau garçon trop amoureux de sa propre image –, et qui, en guise de punition, a été changé en fleur par les dieux.
Se penchant sur le calice fatal, elle y découvre l’Hadès, un gouffre qui l’attire irrésistiblement et où l’attend Pluton. Le Deuxième tableau se déroule aux champs Élysées, séjour des âmes « insatisfaites » (et non damnées), qui errent sur le bord du fleuve Léthé (Oubli). Dans la scène I, la jeune femme visite les lieux en compagnie de son époux, accompagnée par le Chœur des Nymphes. Elle croise Orphée, cherchant à rejoindre Eurydice, et Mercure qui lui fait manger le fruit de Tantale, la grenade. À peine quelques lignes de texte sont rédigées, en prose. La scène suivante, non écrite, devait voir Eurydice raconter ses tourments à Proserpine. Dans la scène III, la jeune fille, qui a conservé à la main sa fleur de narcisse, voit apparaître dans son calice le monde d’en haut, printanier, joyeux, vivant. Un dialogue s’engage alors avec le Chœur des Nymphes, déploration de tout ce que Proserpine a perdu, douleur de sa mère qu’elle ne reverra plus… Le texte rédigé se présente en alexandrins, mais Gide indique que « tout ne doit pas (en) être », et même que ceux-ci pourraient ne pas être « conservés ». Il insiste sur le travail de mise en scène, sur quoi il semble avoir des idées bien arrêtées, et sur le rôle important de la musique. Il introduit aussi l’histoire annexe de Triptolème, confié, bébé, à Cérès par le roi Séleucus, chez qui elle était allée porter sa douleur. Proserpine, qui voit la scène, célèbre ainsi le futur héros : « Qu’il est beau ! Tout brillant de hâle et de santé / Je le sens qui se rue à l’immortalité. » Dans le Troisième tableau, non rédigé, on voit Cérès enseigner l’agriculture à Triptolème, grâce à qui Proserpine pourrait être rendue à la vie, à la terre. Ce qui est le cas. Cérès unit alors les deux jeunes gens, mais la jeune femme, inquiète, raconte à sa mère sa vie souterraine, et, reprise par Mercure (le messager des dieux), s’en va rejoindre docilement son premier époux, l’infernal Pluton. Dans le Quatrième tableau, on voit Proserpine métamorphosée en puissante reine des Enfers, apaisée, qui accepte son sort et invite les Ombres à faire de même. L’embryon de pièce s’achève sur des fragments, quelques alexandrins qui devaient être interprétés par le Chœur des Nymphes, célébrant la moisson et les moissonneurs.
Gide explique que sa pièce ne devait pas avoir « de conclusion à proprement parler », et cite trois vers du Purgatoire de Dante (XXVIII, 17), qu’il traduit lui-même : « Tu me fais repenser où et quelle était Proserpine, dans le temps que la perdit sa mère et qu’elle perdit le printemps. » Les cinq derniers vers « géorgiques » (Gide fut toujours un fervent lecteur de Virgile) de Proserpine rappellent également le célèbre sonnet de Joachim du Bellay, Comme le champ semé…, extrait des Regrets. Le poète de La Pléiade est d’ailleurs bien présent dans son Anthologie de la poésie française (Gallimard, 1949), même si ce poème précis n’y figure pas, hélas.
Près de trente ans après le début de la rédaction, très partielle, de l’ébauche Proserpine – si l’on en croit la chronologie de Richard Heyd dans son édition du Théâtre complet d’André Gide, laquelle, rappelons-le, parue du vivant de l’auteur, a été approuvée par lui –, et plus de vingt ans, en effet, après sa mise en sommeil, la « ferveur » d’Ida Rubinstein ayant tiré Gide de son oubli (tout relatif), voici que s’annonce Perséphone, comme sortie des Enfers des projets littéraires abandonnés, opéra en trois tableaux.
L’intrigue, inspirée d’Homère, reprend celle de Proserpine. Au Premier tableau, l’insouciante jeune fille respire le fatal narcisse, le cueille, provoquant ainsi la malédiction divine. Elle est entraînée aux Enfers, mariée à Hadès. Au Deuxième, on la retrouve dans son nouveau séjour, reine des Ombres. Grâce à la grenade magique que lui tend Mercure, elle revoit son monde d’avant, cherche à communiquer avec sa mère, laquelle va récupérer le jeune Triptolème (ou Démophoon), le laboureur grâce à qui Perséphone va pouvoir revenir sur terre à la belle saison. Au Dernier tableau, Déméter célèbre les noces de sa fille avec le bel agriculteur, mais Perséphone, acceptant son destin et fidèle à la parole donnée, s’en ira rejoindre son premier époux, jusqu’au prochain printemps.
Par rapport à Proserpine : tous les personnages ont retrouvé leurs noms grecs d’origine, à l’exception d’un seul, Mercure, qui aurait dû s’appeler Hermès ; l’alexandrin a laissé sa place au vers libre, mais la versification a conservé un côté pompeux, un peu convenu. Ainsi, dans le Premier tableau, « C’est le premier matin du monde » répété trois fois, ou « La brise a caressé les fleurs » ; les Chœurs, des Nymphes et des Enfants, occupent toujours une fonction importante dans la pièce ; mais la grande innovation est l’introduction d’Eumolpe, le légendaire rhapsode de Thrace, lequel joue un rôle majeur dans le livret. Il est à la fois le récitant, le commentateur, le principal interlocuteur de l’héroïne, voire parfois la voix de Gide lui-même, par exemple quant il cite sa source homérique. C’est lui qui tire la sagesse finale de l’épisode : « Il faut, pour qu’un printemps renaisse / Que le grain consente à mourir / Sous terre… »
Et, si le grain ne meurt, tout est possible. La mythologie antique et la Bible, les deux inspirations majeures du théâtre de Gide – et, même, de toute son œuvre – se voient ici rassemblées.
Dans Perséphone comme dans Proserpine, même si un peu moins nombreuses, Gide donne de précises indications de mise en scène, de décor, de dramaturgie, qui montrent que, contrairement à la modestie de ses explications à la Petite Dame (« peu de texte, (…), des prétextes à gestes et à danses »), il savait exactement où il allait, ce qu’il voulait, et tenait beaucoup à ce que la place de son texte soit respectée, au service de l’idée qu’il se faisait de ce que devait être sa pièce. Et c’est là que le bât a vite blessé. Car toute création théâtrale, et a fortiori musicale, même si lui préexiste le texte sans quoi rien ne serait possible, est une œuvre collective, fruit d’un certain nombre de collaborations, d’apports plus ou moins déterminants. Et cela, il semble que le Gide dramaturge, qui reconnaissait pourtant – « Un livre est toujours une collaboration » – ait eu du mal à l’accepter, à le vivre. Les mises à la scène de ses pièces ont souvent été compliquées, voire houleuses.
Ce fut le cas pour Perséphone. Rappelons-en le casting. Outre Gide, donc : Igor Stravinski pour la musique, Ida Rubinstein assistée de Jacques Copeau, le patron du Vieux-Colombier, à la mise en scène ; à quoi s’ajoutent le jeune chorégraphe allemand Kurt Jooss, et, pour les décors et les costumes, le talentueux André Barsacq. Ida Rubinstein, d’autre part, jouera le rôle-titre. Initiatrice et mécène de l’entreprise, sa voix devait peser lourd sur les choix artistiques et les décisions. Sans parler de son tempérament, de son caractère, tout comme celui de Stravinski. Tous ces egos sont entrés en conflit. Et Gide, quoiqu’il eût parfois des idées bien arrêtées, un grand soin de son travail, et ait su, tout au long de sa vie, faire preuve de courage, n’aimait pas particulièrement les conflits. Après nombre de divergences, en particulier sur la mise en scène, la place de la musique par rapport à celle du texte, etc. il a préféré se retirer, jeter l’éponge et prendre la tangente. Contrairement à d’autres de ses pièces, il n’a pas suivi la mise au point, les répétitions, et n’était même pas présent lors de la création, à l’Opéra de Paris le 30 avril 1934, ni aux autres représentations (trois en tout). Ce qui explique qu’il n’en parle pas dans son Journal.
De retour à Paris en provenance de Suisse (où il est allé, entre autres, voir sa fille Catherine en pension à « La Pelouse », à Bex) le 2 mai, il s’empresse d’interroger la Petite Dame sur la première de Perséphone, laquelle n’a apparemment pas été bien accueillie. « Ennuyeux, n’est-ce pas ? dit-il. Mais avouez que c’est la faute à Copeau. » Et Maria, qui avait assisté, elle, à la représentation, de commenter, raconter et juger, en n’épargnant personne, de façon argumentée, imagée et drôle : « Je suis bien de son avis ! C’est la faute de Copeau, et d’Ida Rubinstein aussi, du reste ; je ne défends pas ses vers, qui sont sans importance pour le spectacle, mais la présentation du mythe est charmante et pouvait donner des choses exquises de grâce sauvage et une telle variété de lumière et d’atmosphère pour souligner la musique qui m’a semblé fort belle, encore que j’aie mal saisi son rapport avec les paroles ; au lieu de cela, il n’y a qu’un seul décor, beau du reste, grand, mais qui à mon avis n’a rien à voir avec l’adorable légende. Tout se passe dans une crypte d’une manière d’église romane, le récitant semble une statue d’évêque collée contre une colonne, Déméter une vierge florentine et le jeu d’Ida est sans variété, ni dans les gestes ni dans la voix ; c’est hiératique et plein de tenue, et affreusement monotone ; les costumes sont délicieux, trop distingués, ça manque terriblement de vent dans les cheveux. »
Page superbe, avec sa chute admirable. Quant à la réaction de Gide, elle n’est pas moins savoureuse. Il dit : « Je m’en doutais, j’ai vu cela du premier coup ; inutile de lutter, j’étais seul contre trois ; mais vous comprenez que je sois parti ; je leur ai dit, en riant du reste : Je suis refait ; je n’ai décidément pas de chance avec le théâtre, ceci va me sacrer une fois de plus auteur ennuyeux, et voilà ». Rideau !
Mais cela ne va pas le dissuader de persévérer – jusqu’à la fin de ses jours.
Jean-Claude Perrier