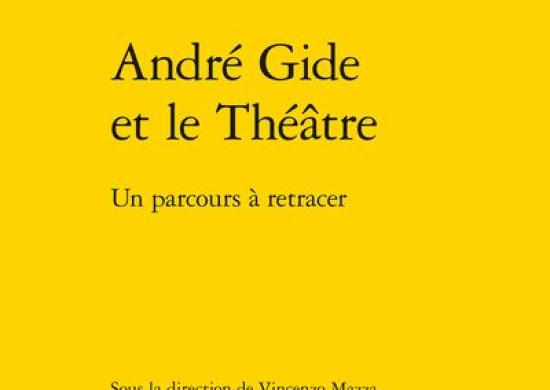C’est avec la conférence de Juliette Solvès que s’ouvrent ces Journées Catherine Gide, dans la villa du peintre Théo Van Rysselberghe. André Gide et la peinture… on ne pourrait imaginer meilleure façon de plonger dans le sujet qu’en écoutant Juliette Solvès, devant l’immense fenêtre de l’atelier du peintre, à partir d’une liste d’achats datée de 1910 (conservée dans les Archives de la Fondation Catherine Gide), tenter de repérer les goûts, les préférences et les intérêts de l’auteur en matière de peinture. Attentif aux tendances de son époque, Gide fait preuve d’une certaine cohérence dans ses choix, privilégiant les paysages, les sujets féminins et les natures mortes.
La référence incontournable à Cézanne fait donc surface, bien qu’elle n’apparaisse, dans la collection de l’auteur, qu’en abyme...En effet, au début du siècle, Gide achète un tableau à son ami Maurice Denis, où plusieurs personnalités du monde de l’art se trouvent réunies autour du chevalet sur lequel est « posé » le fameux Compotier, verre et pommes de Paul Cézanne.
Parmi ces personnalités, on reconnaît à droite, fumant une pipe, Pierre Bonnard. Celui-ci fait la connaissance de Gide au début du siècle — comme le rappelle David Walker dans sa communication — et se voit impliqué dans le projet d’une édition illustrée du Prométhée mal enchaîné. La traduction allemande du livre de Gide est publiée en 1909, avec six dessins de Bonnard, dont le nom n’apparaît même pas sur la couverture... Une nouvelle occasion de collaboration se présentera quelques années plus tard. Elle sera — et pour Gide, et pour Bonnard — beaucoup plus satisfaisante. En 1920, paraît aux Éditions de la NRF une nouvelle édition du Prométhée, enrichie de pas moins de trente illustrations. Le livre se présente comme un tout harmonieux, où le texte et l’image, l’écriture et la peinture se complètent.
Dans le tableau de Maurice Denis déjà cité, on reconnaît une autre figure-clé de cette époque : Édouard Vuillard, sur lequel se penche l’exposé de Nicole Tamburini. L’objectif poursuivi est double : d’une part, il s’agit de reconstruire fidèlement l’historique de cette époque, reliant la production de Vuillard à son contexte. D’autre part, il est question de décrire les caractéristiques de son trait, qui lui ont valu l’admiration de Gide. « C’est surtout qu’il parle à voix presque basse, affirme l’écrivain, comme il sied pour la confidence. » Le pinceau de Vuillard tend vers le chuchotement : son art est (paradoxalement) un art de la parole.
Le discours porte à la fois sur le lien entre l’écriture et la peinture et sur le dialogue intellectuel et intime entre un écrivain, Gide, et un peintre : Vuillard d’abord, Maurice Denis par la suite. La communication de Nicole Tamburini est suivie par celle de Pierre Masson, dont le propos porte sur celui qui a été l’un des chefs de file du groupe des Nabis. Si la première décennie du XXe siècle se caractérise par un commerce intellectuel particulièrement fécond, le conservatisme intransigeant du peintre est à l’origine de l’éloignement progressif de Gide. Leur correspondance garde la trace d’une amitié faite de lumières et d’ombres, qui couvre l’espace d’un demi-siècle : de l’édition illustrée du Voyage d’Urien (1893) — œuvre exceptionnelle par son originalité — à la mort accidentelle du peintre, en 1943.
Parmi les noms évoqués au cours de l’après-midi, celui de Maurice Denis est peut-être le plus connu, hier comme aujourd’hui. Et Braque ? Et Picasso ? Si Gide n’ignore certes pas la révolution picturale alors en cours, par ses amitiés et ses goûts, il porte son regard ailleurs. Comme le souligne Brigitte Chimiez, l’écrivain préfère les peintres qui se placent aux marges de la scène artistique : il en apprécie non seulement le talent, mais aussi leurs mérites personnels. Le « cas Matisse » est emblématique dans ce sens. Gide n’éprouvait aucune sympathie pour l’homme et ne fit aucun effort pour essayer de comprendre l’artiste. L’histoire que l’on raconte aujourd’hui est donc celle d’un rendez-vous manqué entre deux grands esprits du XXe siècle.
En conclusion de sa communication, Brigitte Chimiez souligne un point essentiel. Au sujet du rapport de Gide avec la peinture, il ne faut pas parler de méconnaissance, mais de méfiance. Méfiance qui vient principalement du fait qu’il croit — ou qu’il sait — être plus doué pour goûter aux plaisirs de l’ouïe qu’à ceux de la vue. Et en effet, c’est à cet univers que Gide a recours quand, en 1937, il écrit pour le premier numéro de la revue Verve le court texte Quelques réflexions sur l’abandon du sujet dans les arts plastiques. Pierre Masson en donne lecture, soulignant, page après page, les hésitations de l’écrivain, dont la pensée zigzagante demeure plus que jamais difficile à saisir :
« Que de contradictions, que d’incertitudes, dans tout ce que je viens d’énoncer ! C’est aussi qu’il est vain de parler d’art en faisant abstraction des artistes ; chacun de ceux-ci travaille selon son tempérament particulier et selon une esthétique plus ou moins précise (dictée moins par son intelligence que par son instinct, je l’espère) qui n’appartient qu’à lui. Mais chacun d’eux appartient, en dépit de ce qu’il peut penser, à son époque et répond, souvent sans trop s’en douter, à l’exigence d’un public, pour ne pas dire : à des commandes. Aussi je ne crois pas sans intérêt de remarquer que, dans un temps si soucieux du peuple, de ses besoins, de ses réclamations, de sa culture, la peinture ne satisfasse qu’un très petit nombre de privilégiés et que tout effort pour vulgariser l’art n’ait obtenu jusqu’à présent que des résultats désastreux. »
La fin de cet article apparaît davantage comme un point de départ que comme un point d’arrivée, quand il s’agit de penser le rapport de Gide à l’œuvre d’art, et quand on sait à quel point les interactions sont riches entre le mot et le trait. C’est d’ailleurs un public enchanté par la richesse de ces 6es Journées Catherine Gide, orchestrées par Raphaël Dupouy (Réseau Lalan), qui a quitté Saint-Clair avec la ferme intention d’y revenir.