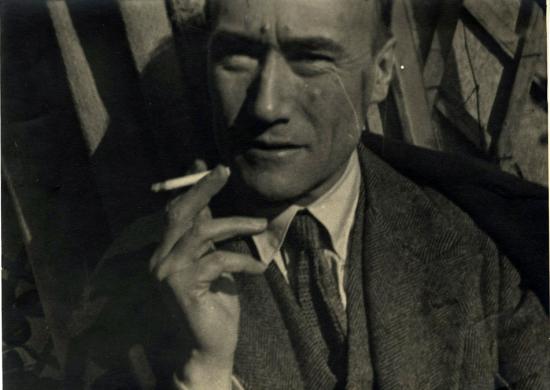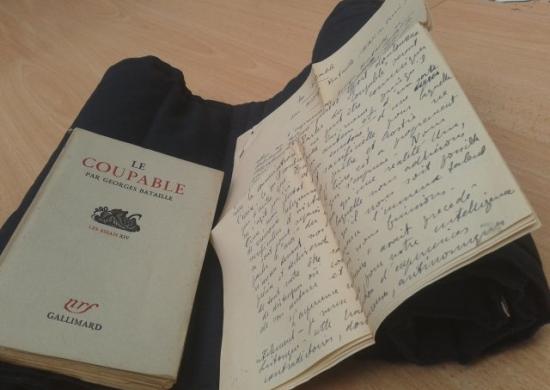Sur : André Gide et l'autre sexe (collectif), Paris, Classiques Garnier, “Bibliothèque gidienne”, 2024.
Sous la houlette de Patrick Bergeron, de Stéphanie Bertrand, et de François Ouellet, un colloque intitulé “André Gide et les femmes”, s’est tenu au Québec au mois de novembre 2022. Cette rencontre internationale a rassemblé douze chercheurs intéressés par la question de l’identité sexuelle, et la représentation complexe de la femme – de sa résignation à son émancipation – dans l’œuvre de Gide. Les actes de ce colloque viennent d'être publiés chez les Classiques Garnier sous le titre André Gide et l'autre sexe.
Ce sujet alimenté par l’ensemble des propos qui furent échangés – exhumation des livres, articles, lettres, entretiens radiophoniques, et recherches universitaires – a offert aux participants une constellation de réflexions enrichissantes sur la fonction de l’écriture gidienne, permettant d’en affiner la perception.
Le lecteur, à l’aune de cette grande œuvre, connaît le bouillonnement, le foisonnement d’idées, de questions qui habitent en permanence un Gide préoccupé depuis son enfance par la question sexuelle. Renvoyé pour onanisme de l’École alsacienne, le comportement d’une société castratrice le fit réfléchir sur une société qui condamnait aussi l’homosexualité. De ce combat interne naquit Corydon, un texte considéré comme justificatif, après que Gide a mis dans différents récits les situations singulières de sa vie. L’originalité de l’écrivain fut d’inscrire dans son œuvre – en miroir – une représentation de la figure féminine, tour à tour, exagérée, figée, généreuse, noble, idéalisée, résignée, délaissée, face à celle d’un homme immoraliste, pétri d’égoïsme, quelque peu déchu, au parcours parfois incertain, mais détenant presque tous les pouvoirs. Cela, jusqu’au tournant d’un demi-siècle qui vit une femme authentique s’émanciper, s’enhardir, au point de prendre [sa] pleine place au cœur de la société, donnant naissance dans l’œuvre gidienne à L’École des femmes. – Idéalisation, distanciation, mais aussi relations singulières, affectueuses avec les femmes de son entourage, telle fut l’attitude de Gide pour apprécier une personnalité féminine, que le lecteur voit à son tour évoluer au sein de ses écrits. – Le temps laisse des traces, les rencontres et échanges épistolaires aussi. Le tableau offert par l’écrivain dévoile tous les recoins d’une âme tourmentée par son imaginaire, la réalité, et sa sexualité autre, face à celle d’une femme considérée, soit comme une madone, soit comme une perverse.
Maja Vukušić Zorica, (responsable de la Chaire de littérature française à l’Université de Zagreb), dans un article intitulé : « À la galope et à la diable : la mère et la lettre », observe les lettres échangées entre Gide et sa mère, et entre Proust et sa propre mère, à la même époque. Ces correspondances font ressortir les similitudes, et les différences, de l’attitude de ces mères face à leur fils, et des fils face à leur mère. Proust et sa mère ont des échanges teintés de tendresse, et d’enjouement. Ceux de Gide et sa mère sont circonspects, mesurés. Zorica souligne le côté psychanalytique que revêt l’échange avec la mère, les fils recherchent leur assentiment, mais refusent leur influence. Ils se croient incompris – cela n’empêche pas les demandes d’argent, et les échanges constants sur l’écriture de leurs œuvres respectives. Chez Gide, ces dialogues sont suivis de silences lorsqu’il y a insistance de la part de la mère ; quand, Proust, belliqueux, joue un rôle de victime. Néanmoins, la mère reste pour tous deux, la femme aimée ; elle est celle qui génère le discours sur la littérature, et permet à Gide – en particulier – d’affirmer son identité.
Patrick Bergeron (professeur titulaire au département d’études françaises de l’Université du Nouveau-Brunswick), dans un article intitulé « André Gide et la “chère amie des livres”, transmet son attachement pour la personnalité d’Adrienne Monnier, lectrice avant-gardiste, qui offrit par le truchement de sa librairie fondée en 1915, un abri littéraire, rue de l’Odéon à Paris. Elle reçut et plébiscita ceux qui deviendront les plus grands écrivains français et étrangers de Gide à Joyce, au cœur de ce « centre névralgique ». – Grâce à Sylvia Beach, le chaleureux cabinet de lecture prend de l’envergure, avec la création en 1919, d’une nouvelle bibliothèque intitulée Shakespeare and Company. De cette union amoureuse et littéraire, naquit L’Odéonie, puis une revue littéraire, puis, une Gazette. Bergeron éclaire les années de relations littéraire et épistolaire entre Gide et Monnier, éditrice, critique exigeante en laquelle Gide reconnaissait un véritable talent. Cette amitié, née en 1917, ne prit fin qu’à la mort d’André Gide, en 1951.
Frank Lestringant (professeur émérite à la Sorbonne), dans un article intitulé « André Gide et Edith Wharton : de la Grande Guerre aux décades de Pontigny » narre la rencontre entre Gide et Wharton, romancière américaine, qui collecta des fonds en faveur des réfugiés, afin d’alimenter les œuvres du Foyer franco-belge, et des American Hostels for Refugees. Entre 1914 et 1916, Gide n’écrit pas, il se consacre au sort des réfugiés. En 1915, il accepte d’accompagner Edith Wharton à Hyères. Ils sont accueillis chez Paul Bourget, membre de l’Académie française. Bourget s’intéresse à l’œuvre et à l’homme Gide ; quant à Gide, il éprouve un intérêt réciproque pour l’auteur des Essais de psychologie contemporaine. Une discussion s’engage entre un Bourget qui incarne aux yeux de Gide, « la famille et la religion comme garants de l’ordre social », et un Gide, auquel Bourget soumet la question de la pédérastie dans L’Immoraliste, ainsi que celle du sadisme et du masochisme chez l’homosexuel. Ce voyage en terre hyéroise prend l’aspect d’un voyage littéraire. Invité l’année suivante, Gide ne retournera pas à Hyères avec Edith Wharton. L’amitié qui avait pris forme durant la guerre s’estompera à la fin de celle-ci.
Éveline Méron, (professeure émérite de l’Université Bar-Ilan en Israël), partage son étonnement devant l’attirance d’un entourage féminin prêt à tout pour plaire à un écrivain « homosexuel et misogyne », dans un article intitulé : « Gide et les femmes. Mais que lui trouvaient-elles donc ? » Elle s’appuie sur une correspondance qui témoigne de cette admiration, ainsi que sur Les Cahiers de la Petite Dame. L’admiration de Maria Van Rysselberghe est issue d’une amitié « sans malentendu, sans chimère » ; celle de Dorothy Bussy, est ambiguë. Dépitée et frustrée, elle livre son cœur à un écrivain distant. Quant à Gide, il se sert du réel pour introduire dans ses fictions des personnages masculins dominants, et des personnages féminins dévalorisés. Toutefois, devenu père, il publie quelques années après la naissance de sa fille Catherine, L’École des femmes, Robert, puis Geneviève. Dans cette trilogie, les rôles sont inversés ; le personnage féminin est dominant, intelligent, à l’image de Maria et de Dorothy, admiratrices inconditionnelles, parce qu’elles font fi de sa misogynie. Avec lui, « esprit supérieur », elles peuvent s’exprimer librement.
La deuxième partie du colloque est consacrée à « la représentation du corps féminin qui évolue au gré de la vie de Gide, et des mentalités ». Pierre Masson, (professeur émérite de l’Université de Nantes, et président de l’Association des Amis d’André Gide), intitule son article « Gide et le corps des femmes, un observateur sans désirs ». Il relate que de cette indifférence pour le corps féminin, naît chez Gide, « un regard photographique » révélateur de ce qui retient son attention : les yeux, les sourcils, l’éclat de la peau brune, ambrée. Gide scrute l’œil du regardé, et l’œil du regardeur. Masson note que « La Porte étroite illustre remarquablement ce principe ». Il mentionne que l’allure, le charme, les courbes d’un corps féminin, et la couleur des yeux, participent moins de la description que les vêtements. Il souligne que dans L’Immoraliste, l’époux s’attendrit devant la fragilité du corps de l’épouse, une fois que sa force l’a quittée. Ce renversement des forces vitales, conforte l’homme dans sa propre robustesse, et engendre des sentiments mêlés de « pitié et piété ». Cette « mauvaise foi » devant le corps démythifié, devient le « ressort de l’action ». L’attitude – quasi indifférente ou suffisante – envers la femme affaiblie ou offerte, serait un moyen détourné pour dire que « l’homme pourrait préférer un autre genre de relation ». Le personnage féminin sensuel est rejeté, au profit d’un personnage féminin mystique. Toutefois, ce regard dual évolue, et lorsque le narrateur s’approche d’un corps féminin émancipé, il peint une « sexualité heureuse ». Cette nouvelle vision est « révélatrice du regard masculin posé sur ce corps » ; une fois, les préjugés disparus, le corps féminin – qui n’existe dans l’œuvre gidienne que par rapport à l’homme – peut-être sublimé dans la fiction.
Jean-Michel Wittmann (professeur de littérature française à l’Université de Lorraine) dirige le Centre d’études gidiennes, il enchaîne avec un article intitulé « Trouble dans le genre : le féminisme obscur d’André Gide ». Il dissémine une vision de l’homme et de la femme qui change dans les mentalités, et concomitamment dans l’œuvre. Il remarque l’arrivée de personnages « féministes », et une « féminisation » inexprimée des personnages masculins. L’écriture s’épanche sur l’homosexualité, afin de la rendre « socialement acceptable », avant que de livrer aux lecteurs Corydon. L’image affirmée de l’homosexuel efféminé est repoussée – l’efféminement aussi discret soit-il, conduirait à la disgrâce, sinon à une image décadente, réductrice. À partir des Caves du Vatican, la question de l’identité est approchée d’un point de vue social et sociétal, stéréotypé, exagéré – la femme virilisée, est décrite autoritaire, « hommasse », portant moustache. La sotie fait pénétrer le lecteur dans le monde de l’inversion, et de l’hésitation. Wittmann met au jour une perspective narrative, qui met en lumière une identité sexuelle instable, et un « féminisme obscur ».
Jean-Christophe Corrado (docteur en littérature française), donne pour titre à son article : « Efféminement, aucun de part ni d’autre. Gide et les garçons sensibles ». Il rappelle que dans Corydon, Gide écrit que la pédérastie ne comporte « efféminement aucun, de part ni d’autre », quand Freud « présentait l’amateur de jeunes garçons comme vaguement bisexuel ». Corrado présente une virilité traditionnelle, et un efféminement – théoriquement – repoussé par Gide. Pour exemple, dans Les Caves du Vatican, Lafcadio, robuste et effronté, lutte contre sa sensibilité. Dans L’Immoraliste, l’enfant malingre est peu apprécié. Dans Si le grain ne meurt, l’auteur n’est pas sensible à l’apparence efféminée d’Ali. Dans Les Faux-monnayeurs, Boris est moqué pour sa grâce et son air de fille. Mais, il y a toujours un renversement chez Gide, et dans Voyage au Congo, il loue les traits d’un adolescent, qui le font songer à ceux d’une femme. À l’envi, les personnages sont féminisés ou virilisés. Corrado remarque le rougissement, une des marques de la féminisation, ainsi que le « grêle » et le « frêle » ; bien que ces termes ne soient pas une spécificité féminine – la notion de fragilité renvoie immanquablement à la féminité. Dans Les Cahiers d’André Walter, Gide est attiré par un corps frêle, dans les Carnets d’Égypte, un corps grêle le retient, dans Si le grain ne meurt, les bras grêlent d’Ali le séduisent. Le manque de virilité n’est pas un obstacle à son désir pour des éphèbes. Cependant, demeure oscillation « entre virilité et délicatesse », Gide devant prouver que « le pédéraste n’est pas efféminé et [que] le pédéraste n’est pas complaisant pour l’efféminement de ses amants », ainsi « le mâle » ne déchoit-il pas.
La troisième partie de cette rencontre relate comment « Gide renonce à la représentation de la femme comme icône, au profit d’un personnage féminin plus incarné et symbolique de son époque ». Halia Koo, (docteur en littérature moderne à l’Université de Toronto, Canada), dans son article intitulé : « La femme gidienne, ange de vertu ou mangeuse d’hommes : d’André Walter à Corydon et Isabelle », fait apparaître un personnage féminin d’abord contemplé comme « abstraction spirituelle ». Puis, stigmatisé, il devient médiocre, fourbe, dévergondé, niais. Parfois cruelle, la femme ne dévore-t-elle pas son époux, à l’instar de la mante religieuse ? Le lecteur voit se déployer, un « plaidoyer », dans lequel l’écrivain expose la complexité de vivre l’amour platonique, avec une femme, et l’amour dans la sexualité, avec les hommes. La femme gidienne se transforme au gré des débats intérieurs de l’auteur. La moraliste, devient une victime de l’immoraliste. Il y a enjeu pour raconter la dimension sensuelle, dans une perspective phénoménologique de toutes les expériences. Parade à l’épanouissement du héros gidien, « l’élimination du personnage féminin dans L’Immoraliste et La Porte étroite équivaut à un meurtre narratif ». Koo insiste sur la dévalorisation infligée à la femme qui n’est plus qu’une « reproductrice », comme la femelle est « la gardienne des qualités héréditaires ». Paradoxe pour un misogyne, qui doit justifier de son dédain des coquettes. Aussi, Isabelle arrive-t-elle à point nommé, pour légitimer cette position, puisque de sa duplicité et de son égoïsme, s’accomplit la destinée tragique de son amant et de son enfant. Elle est « la mangeuse d’hommes » annoncée.
Jocelyn Van Tuyl, (professeure émérite de langue et littérature françaises au New College of Florida, USA), dans son article : « Libérée, effacée : Bronia Perlmutter et le manuscrit de Londres des Faux-monnayeurs », porte son attention sur le personnage disparu de Bronia Perlmutter, qui figurait dans une version antérieure. L’effacement de Bronia, « portrait à peine voilé d’Élisabeth Van Rysselberghe », renvoie à la préoccupation de Gide, futur père adultère. Une partie du réel entre dans la fiction. Certains éléments – jamais édités – reproduisent le vécu de Gide et d’Élisabeth. Aussi, Bronia disparaît-elle. Une seconde piste conduit à une jeune russe, Bronia Perlmutter, qui a fait partie à la même époque de l’entourage de Gide. Van Tuyl décide d’adopter l’idée d’une « version composite », devant la difficulté de trouver l’origine du personnage de Bronia. À la manière d’un Modiano, elle offre une double version, en suivant la piste de la ’’véritable’’ Bronia, sans omettre de décrire comment Gide introduit sa vie familiale et amoureuse dans son œuvre, négligeant toutefois d’écrire un vécu délicat à exprimer, dans son intégralité.
Marco Longo (professeur de langue et culture françaises, auteur de deux thèses, membre associé de l’Université de Lorraine), dans l’article intitulé : « Sœurs, mères, saintes, et adultères », présente certains points de convergence sur « l’ambivalence féminine chez Gide et Pirandello : de figure muette à personnage autonome en quête d’auteur ». Il compare les œuvres gidienne et pirandellienne, explicite la progression de leur représentation du personnage féminin, qui va de l’effacement à l’émancipation, précisant que le personnage féminin est essentiel pour assouvir un désir homoérotique triangulaire. Longo rappelle que l’homosexualité de Gide s’affirme dans un contexte historique où les femmes s’enhardissent. Il narre la complexité des rapports amoureux triangulaires qui évoluent au sein de ces œuvres : un homme pour deux femmes, ou une femme partagée entre deux hommes. Il observe que la femme est, dans la triangularité, un médiateur érotique de la relation, et que celle-ci, peut aussi être un « Pygmalion inversé », destiné, sinon à l’effacement, à l’éloignement. Longo note l’ambivalence de Gide qui, la nuit, appelait Emmanuèle, Marthe, et le jour, Marie. Il relève que chez Pirandello, L’Exclue s’appelle Marta et sa sœur Maria, l’une adultère, l’autre dévouée à la religion. Les personnages féminins sont ancrés de façon suave ou amère, dans ces œuvres où la femme gidienne, en dépit de sa métamorphose, ne met pas en péril l’équilibre des relations créées par l’homme. En revanche, la femme pirandellienne est celle qui fait chanceler une union – qui masque souvent un rapport homme-homme – les hommes deviennent soit deux rivaux, soit forment un couple renforcé. Longo relève des points nodaux sur les rapports femmes-sœurs et femmes-mères, femmes adultères, femmes suicidées ou rebelles. Il met au jour un parcours d’émancipation contre les préjugés des figures féminines qui, après avoir été bafouées, écartées, sont in fine réhabilitées. L’auteur ne laisse plus la suprématie des rôles aux personnages masculins.
Stéphanie Bertrand (docteur en langue et littérature françaises, maître de conférences à l’Université de Lorraine), intitule son article, « André Gide et le regard des femmes : La résignation, formes et enjeux d’un modèle d’expression féminin ». Elle distingue dans les fictions gidiennes, un langage – chez la femme – qui autorise l’écrivain à caractériser « linguistiquement et psychiquement » certains personnages, et de poser la question : « Comment parlent les femmes dans les œuvres de Gide ? Parlent-elles comme les hommes – comme des hommes ? » Elle aborde la question du langage, en proposant une lecture genrée, qui permet non seulement de « réfléchir aux interactions entre langage et tempérament », mais aussi de « questionner les limites d’une attitude sur un plan tout à la fois philosophique, spirituel et esthétique ». Elle donne pour exemple des phrases stéréotypées et dévalorisantes que prononce la femme – marque d’une résignation toute féminine. Elle distingue la présence d’une négation restrictive – forme d’impuissance ajoutée à la résignation et à l’abnégation –, puisant des exemples « d’incapacité à faire », dans L’École des femmes, Les Faux-monnayeurs, La Symphonie pastorale, La Porte étroite. Elle relève les expressions d’une langue qui s’appuie résolument sur le renoncement et éclaire la servitude de la femme gidienne, qui cède, tolère, et rend invisibles ses opinions et sentiments, par le biais d’un « retrait énonciatif », usant de formes impersonnelles, comme substitut de sa propre personne. Par ailleurs, l’omniprésence de Dieu, comme dogme de foi du langage choisi – « seconde réalité d’ordre spirituel » – est lapulsation qui permet à la femme de rester dans un « idéal chrétien de sacrifice ». Cette résignation délibérée transpire dans la langue, et fait écho à « ce que l’on appelle “honnêteté”, chez les femmes […] ». Dans Paludes, écrit bien en amont, le narrateur ne réserve plus le langage de la résignation à la femme. Il joue avec le genre, attribuant à Tityre un comportement résigné, afin de le rendre « misérable ». Il utilise des termes désobligeants à l’encontre d’un homme efféminé : « Il est poltron comme une femme. » Cela permet d’observer les limites d’un discours stéréotypé de l’expression – quasi permanente – de la résignation féminine, mais également d’écouter les mots que prononcent l’homme sur la femme : « Si intelligente que soit une femme, vous savez… ». Manifestation d’une pensée masculine, à laquelle répond, placide, la comtesse de Baraglioul : « – On se fait de grandes illusions sur le peu de capacité de l’intelligence des femmes […] sous un air absent, résigné et vaguement extatique […]. »
François Ouellet (professeur titulaire de littérature à l’Université du Québec à Chicoutimi), enchaîne avec un article intitulé « Une esthétique de la vie possible. Aux yeux de Dieu ». Il questionne dans Si le grain ne meurt, « livre de libération », après la réalité et les rêves, une « seconde réalité » préalablement ancrée dans Paludes. L’écrivain souhaite « épaissir » son œuvre en transformant le réel. Il aborde le thème de la séparation de l’esprit et des sens. – Arranger les faits, « styliser », conter une seconde réalité, qui n’est pas « destinée à être vue », et qui provient d’une croyance mystique, invisible. Gide, éprouve le besoin de valoriser le regard, après s’être extasié devant un monde qu’il a découvert avec enthousiasme, et qui va développer en lui « un goût du clandestin ». – Sur sa rétine se cristallise la lumière d’un univers tourné vers une réalité intérieure, différente, imaginée sous les « yeux de Dieu ». Cette « seconde réalité spirituelle », précède une « seconde réalité sensuelle », funeste. La Porte étroite, est un exemple de l’attente de cette autreréalité. Le personnage « incertain », privilégie aussi une seconde réalité sensuelle, qui prolonge le mystère et l’illusion, ce « grand mirage ». L’instabilité des personnages transforme l’avancée du récit en spectacle inattendu, qui devient, dans un premier temps, vivifiante pour Gérard, pour Gertrude, pour Alissa, avant de dévoiler une faille, qui emporte les personnages qui s’y frottent vers une destinée fatale.
L’identité sexuelle instable des personnages a montré un Gide voyant, s’affirmant dans sa sexualité, ainsi que dans ses amitiés féminines, épistolaires et intellectuelles. Les femmes belles, sensibles, réfléchies, fades, ignares ou belliqueuses, n’intéressent qu’épisodiquement l’écrivain, qui garde la part du lion pour l’éphèbe. De ce clivage, tel un sculpteur qui observe la maturation de sa créature, L’homme Gide s’en détourne, une fois l’expérience terminée, et la curiosité retombées !