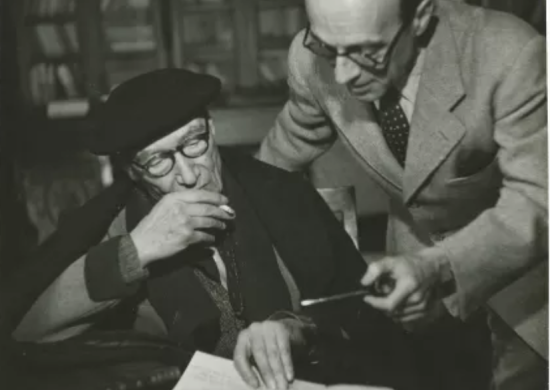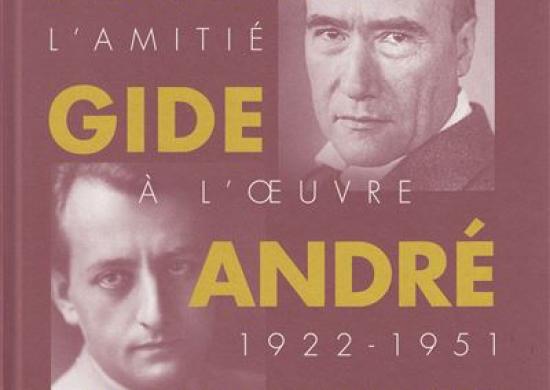Une écharde. J’ai douze ans et mes parents décident que, mes sœurs et moi, nous n’irons plus jamais en vacances ici. Ici, il y a un homme qui s’exhibe devant les enfants et, parfois, les touche. Cet homme est de la famille. On le médicamente. C’est insuffisant. L’écharde, avec les années et les révélations, se retire lentement.
J’ai douze ans, et je ne comprends ni la radicalité ni la souplesse excessives des adultes, ni la fermeté des décisions, ni la mollesse des secrets. Je ne comprends ni les silences qui tranchent, ni les silences qui permettent. J’aime parler. Je suis d’ailleurs la seule, parmi les enfants, à parler à cet homme avec qui on me dit à tour de rôle, selon les interlocuteurs, d’être « gentille » ou « méchante », et je ne reconnais sous les traits de ce visage étrangement naïf ni le monstre des faits divers, ni le fou des soirs d’été, ni les corpulents aux yeux lubriques de la piscine municipale. Je ne sais alors rien de ce qui se joue en lui. Je vois simplement un homme qui a l’air de penser que nous avons le même âge. Il y a ceux qui le protègent, ceux qui le pointent du doigt, ceux qui l’ignorent, et il y a moi. Tous regardent différemment cet être tabou, de trop, ce criminel doublé d’un innocent qui porte peut-être, informulée, cette phrase qui m’agrippera plus tard dans un livre d’Abdellah Taïa : « Chacun avait son image de moi-même. »
J’ai douze ans. L’âge de Lolita. L’âge du regard manquant, de l’angle muet dans lequel tout se prépare – se préparent la vie, l’avenir, la vision du monde. Et le « pédophile » que j’ai face à moi, comme cet autre homme mûr, ami de la famille, marié et papa, qui se dira amoureux de la préadolescente que je suis quelque temps plus tard, ne se révèle être ni le héros de Lolita, ni André Gide, ni Gabriel Matzneff, mais la première pièce d’un immense puzzle de la sexualité humaine que seule la littérature semble en mesure d’éclairer dans toute sa complexité.
*
La littérature est un poste d’observation privilégié sur ce qui demeure, pour nos sociétés structurées, un obstacle majeur. Socialement destructurante – pour l’enfant qui la subit, pour les familles qui se trouvent plongées dans les interrogations qu’elle soulève, les trous noirs qu’elle induit, les secrets qu’elle favorise –, la pédophilie est, au contraire, pour le récit, source de structure et de sublimation. Nombreux sont les chefs-d’œuvre dans lesquels elle constitue la corde qui permet de hisser le roman. Lolita, L’Immoraliste, Le Roi des Aulnes… Ce passage à l’œuvre n’offre pas seulement une perspective littéraire ; il est peut-être notre unique chance de comprendre quelque chose de « celui qui aime les enfants1 ». Pourtant, comme la question de l’inceste, la seule évocation du mot « pédophile » provoque des réactions, plutôt que des réflexions (le « coupez-leur les couilles ! » dont parle Boris Cyrulnik2), empêchant toute véritable prise en charge de la question. Dans le milieu littéraire, l’inverse a longtemps été vrai : pédophile, et alors ? Nombreux sont les articles, depuis la publication du Consentement de Vanessa Springora en 20203, qui se sont penchés sur les évolutions sociales ayant permis à un écrivain pédophile – Gabriel Matzneff – de recevoir, dans les années 1970, un accueil favorable et, jusqu’en 2013, des prix littéraires. En revanche, je n’en ai trouvé qu’un qui l’ait vraiment lu4, et aucun qui n’ait donné autre chose qu’une vague image de celui qui l’accompagne désormais dans les débats : André Gide. Depuis le déclenchement de l’« affaire Matzneff », l’auteur sur lequel je me suis penchée ces dernières années, dont j’avais pourtant entendu partout qu’on ne le lisait plus5, se retrouve au cœur des médias. On se demande : pourquoi ne pas retirer les journaux de Gide, si l’on cesse la commercialisation de ceux de Matzneff ?
Si la question est posée, c’est parce que l’un comme l’autre sont indifféremment considérés comme des écrivains pédophiles, et que le ras-le-bol actuel vis-à-vis de l’impunité artistique, encouragé par la prise de parole de filles devenues femmes, d’enfants devenus adultes, donne lieu à une volonté généralisée de sanctionner tout ce qui touche ou provient d’un « prédateur » : les pédophiles ne méritent rien, sauf une mise au ban.
La tentation de gommer de la littérature les pédophiles est-elle une posture tenable ? Et qu’en est-il vraiment de l’expression du désir pédophile dans les écrits gidiens ? La comparaison entre Gide et Matzneff, aussi hâtive soit-elle, n’est pas inutile pour s’interroger sur la définition et le destin des écrits abordant la pédophilie, à l’instant t où, après une période d’indifférence et d’aveuglement (« l’enfant » n’ayant pas toujours été considéré comme une entité à part entière6) suivie d’un encensement du subversif (auquel a contribué la libération des mœurs), on considère plus que jamais la nécessité de protéger l’enfant.
1. La pédophilie par la racine
Il est difficile de commencer une incursion dans l’œuvre gidienne sans s’essayer d’abord à une remise à plat des mots que nous utilisons pour dire la pédophilie. Si l’on rend le terme à son premier sens, admettant, suivant sa racine grecque, que le « pédophile » est celui qui aime les enfants (philía/paîs), tandis que le « pédocriminel » les abuse sexuellement, comment qualifier celui qui les désire ? Aucun des termes proposés jusqu’à présent (pédérose, pédosexuel…) n’a percé dans la langue7. Au moment où Gide écrit, les mots « pédophile » et « pédophilie » ne circulent pas encore. Ils arrivent dans la langue française entre 1925 et 19298, portant le sens que nous leur attribuons aujourd’hui de la façon la plus courante, à savoir les violences sexuelles faites aux enfants, condensant alors les deux termes donnés par l’autrichien Richard von Krafft Ebing en 1886 : pedophilia erotica. « Paidophilie », en revanche, fait son apparition dès 1896 chez Georges Saint-Paul pour décrire « l’amour pour l’éphèbe » entendu comme « perversité9 ». De façon moins commune (car plus spécialisée), telle que décrite dans le manuel des troubles mentaux, la pédophilie est actuellement comprise comme « la présence de fantasmes et/ou de pulsions et/ou de comportements envers un enfant ou plusieurs enfants prépubères10 ». Le psychiatre Romain Pages précisant : « Si la pédophilie n’est ni une infraction, ni une qualification juridique, le terme est largement utilisé pour décrire des actes répréhensibles, entraînant une confusion manifeste11 ». La confusion, Gide l’évite tout en la vivant, puisqu’il choisit de se définir comme un « pédéraste », le mot décrivant précisément l’amour charnel (erastês) pour les « jeunes garçons », mais aussi, plus généralement, l’homosexuel. C’est « l’amour qui n’ose pas dire son nom » cristallisé par Oscar Wilde, entre un « aîné » et un « jeune homme », le premier représentant « l’intelligence », le second, « la joie12 ».
Il y a donc enchevêtrement des significations. D’abord parce que notre époque définit de plus en plus des âges (la petite enfance, l’enfance, la préadolescence, l’adolescence, la jeunesse…) qui demeuraient flous. Ensuite, parce que la pédophilie peut désigner séparément l’amour, le désir ou l’agression. En réalité, elle semble relever d’une forme de prédation qui peut se transformer en agression, que les récits littéraires mettent parfaitement en lumière : la ritualisation, la traque et l’obtention, l’attention, l’épuisement ou le jeu… Avant d’être une qualification, la pédophilie est un processus, une gradation.
Se basant sur l’étymologie, Gide est donc plus que pédophile (il ne fait pas qu’aimer les enfants comme un enseignant aime sa classe) ; sur le sens communément attribué au mot, moins que pédophile (il ne viole pas d’enfants, bien que se pose la question du consentement réel) ; sur la définition la plus large ou la plus floue, disons la plus mouvante (celle qui porte ensemble l’éphébophilie, l’ébéphilie, la pédérastie et la pédophilie), pédophile malgré tout. Je considérerai dans cet article Gide comme ce pédophile malgré tout, figure désirante capable de franchir les limites imposées par la société, partant du fait que la question qui m’importe ici est moins de savoir quel pédophile était Gide que de déterminer dans quelle mesure ses écrits le sont.
Si la pédophilie n’est pas une orientation sexuelle, comme certains acteurs de l’époque matznevienne ont tenté de le soutenir, mais un problème, elle est aussi un problème littéraire, autrement dit un problème de représentation qui, loin de quitter la question sociale (« ce grand trébuchoir », disait Gide), la rejoint. Comment ? Qu’il s’agisse de Matzneff, Duvert, Nabokov ou Gide, le plus souvent, le récit pédophile, bien qu’y rêvant parfois, ne dit pas la relation possible entre le pédophile et l’enfant, mais bel et bien son impasse.
2. La pédophilie dans le texte
Cet enfant qui, devant les étrangers, se fait sauvage, est avec moi tendre et fidèle comme un chien. – Sa sœur est une Ouled-Naïl qui, chaque hiver, regagne Constantine où elle vend son corps aux passants. Elle est très belle et je souffrais, les premières semaines, que parfois elle passât la nuit près de moi. Mais, un matin, son frère, le petit Ali, nous a surpris couchés ensemble. Il s’est montré fort irrité et n’a pas voulu revenir de cinq jours. Pourtant il n’ignore pas comment ni de quoi vit sa sœur ; il en parlait auparavant d’un ton qui n’indiquait aucune gêne… Est-ce donc qu’il était jaloux ? – Du reste, ce farceur en est arrivé à ses fins ; car, moitié par ennui, moitié par peur de perdre Ali, depuis cette aventure je n’ai plus retenu cette fille. Elle ne s’en est pas fâchée ; mais chaque fois que je la rencontre, elle rit et plaisante de ce que je lui préfère l’enfant. Elle prétend que c’est lui qui surtout me retient ici. Peut-être a-t-elle un peu raison13…
Vous venez de lire les dernières lignes de L’Immoraliste (1902). Au terme d’un long récit sur la maladie, le soutien, l’abandon et finalement la mort de sa femme, qui perd elle-même l’enfant qu’elle porte, c’est une définition de la pédophilie qui tombe comme un couperet : je lui préfère l’enfant. Le récit prend fin dans une suspension, il passe par la parole de l’autre pour saisir quelque chose de soi (elle plaisante de ce que je lui préfère l’enfant), qu’il s’agisse de la sœur, des amis auquel Michel (« l’immoraliste ») adresse son récit, ou indirectement, du lecteur. Narration, mise en abyme, réception : nous avons ici un exemple de la façon dont se façonne un regard sur la pédophilie, tel que Nabokov le mettra en place dans Lolita (1955). On peut s’interroger sur la perception de l’enfant (« chien » « farceur »), ce qui m’intéresse ici est la façon dont un ensemble subit un avalement, celle dont 200 pages glissent vers une seule, consacrant l’édification pourtant fragile d’une identité pédophile. Mais il n’est à mon avis pas innocent que le récit, plutôt que de s’ouvrir sur la relation érotisée avec un enfant, se ferme sur cette naissance à soi-même qui est une chute. Car que peut-on raconter de plus après ça ? Ce que grave L’Immoraliste, dans l’effectivité même de ce qui s’y trouve – la mise en œuvre d’une relation pédophile –, au-delà même de l’essentielle ambiguïté de la littérature comme de toute forme d’art, c’est la réelle impasse de la pédophilie : là où naît, par le désir, quelque chose avec un enfant, l’impossible se réalise. Cet impossible, c’est ce qu’explorera d’ailleurs, osant le récit de l’après ça, Lolita.
Gide lui-même donne toutes les clés pour désamorcer ses propres fantasmes. Ce que le roman permet, le Journal le rend boiteux. En 1912, il note : « Constante vagabondance du désir – une des principales causes du détériorement de la personnalité. Nécessité urgente de se ressaisir. » 12 décembre 1908 : « De nouveau l’esprit disloqué ; la chair faible, inquiète, distraite éperdument. Mon organisme tout entier est comme ces maisons trop sonores où, du grenier, l’on entend tout ce qui se fabrique dans la cuisine et dans la cave. » Do the Senses make sense ?, s’interroge un titre glissé dans la préface de John Ray, le fictif « docteur en littérature » de Lolita. Il semble que ce soit une question à laquelle ces écrivains tentent de répondre par le roman, puisque, comme Gide le notait discrètement en marge du manuscrit des Nourritures terrestres, « le salut de la littérature est dans la sensualité ». C’est en faisant remonter à la surface du texte (« tout mon être affluait vers ma peau », écrit Gide/Michel) les désirs interdits que s’architecture la phrase et s’esquisse le sens. Gide sublime par le bas.
Mais là où Nabokov explore la pédophilie comme une planète (« il y a dans Lolita quelque chose de plein, de plein comme un œuf, d’harmonieux14 »), ceignant le récit d’un discours, la mise en abyme de Gide, elle, ne clôt rien. Elle fuit vers les textes suivants, alignant toute son œuvre à l’obsession de ses propres désirs. « Aucune œuvre n’est plus intimement motivée que la mienne », écrit-il dans le « Journal intime » qu’il consacre à sa relation avec sa femme, insistant sur le fait que tout ce qu’il a pu écrire était là pour la convaincre. Mais de quoi ? De rien sans doute qui ne puisse être ramassé en une ligne, un paragraphe ou un livre, puisqu’il en écrira tant.
À l’origine de chaque grande réforme morale, nous trouverons toujours un petit mystère physiologique, une insatisfaction de la chair, une inquiétude, une anomalie. […] Mahomet était épileptique, épileptiques les prophètes d’Israël et Luther, et Dostoïevski. Socrate avait son démon, saint Paul la mystérieuse « écharde dans la chair », Pascal son gouffre, Nietzsche et Rousseau leur folie15.
Lorsqu’André Gide écrit cette phrase dans son Dostoïevski, ne cherche-t-il pas à trouver ce qui, en lui-même et comme indépendamment, fraie son chemin vers l’œuvre en clochant ? Il est probable que le volume immense de son œuvre, en apparence consacrée à bien d’autres choses que sa sexualité, tienne au détail à la fois boitant et fondateur de ses désirs pédophiliques, puisque c’est eux qui le conduiront à une révélation16.
Dans sa préface à l’édition américaine de Corydon, il utilise une formule à la fois pertinente et évitante pour désigner sans la nommer la pédérastie, qui pourrait s’appliquer à toute la complexité des liens entre les corps : le plus harcelant problème humain17. Qu’est-il permis de désirer, pourquoi, comment, jusqu’où aller ? Souvent, les textes de Gide se font gravure de la ligne à ne pas franchir, tout en ne cherchant pas à en être les gardiens. Montrant pourtant le chemin vers l’autre, l’écrivain semble plongé dans la confusion qui alimente le problème pédophile18. Confondre le désir sexuel et l’attachement19, vouloir se confondre avec celle qu’il appelle « la société des enfants » en faisant corps avec elle20. En réalité, Gide rêvait d’être l’Arabe21 qui entre dans les cafés maures, l’habitant d’un pays où l’art est partout sauf dans les musées22, plutôt qu’un écrivain soucieux. Sa lucidité s’efface probablement devant la possibilité de se réapproprier les désirs dont une éducation puritaine l’avait privé. Lorsqu’il arrive au Maghreb en 1893, Gide, à 23 ans, est vierge. Et ce qu’il appelle « préciser son désir » sur un autre ne se réalise que dans la mesure où il subit l’influence libératrice du compagnonnage, qu’il s’agisse de celui de Paul-Albert Laurens (« puceau » lui aussi) ou d’Oscar Wilde, bien plus expérimenté. La réponse que donne ce dernier au juge lors de son procès, pour « sodomie » et « outrage à la pudeur », en 1895, est représentative sans doute de leur état d’esprit :
– Pourquoi êtes-vous en rapport avec les jeunes gens ?
– Je suis un amant de la jeunesse.
[…]
– Ces jeunes gens étaient d’une situation inférieure ?
– Je n’ai jamais demandé ni ne me suis soucié de savoir quelle était leur situation. Je les ai trouvés pour la plupart intelligents et amusants. Leur conversation était pour moi un changement23.
3. L’Autre du pédophile
Tout le travail du lecteur est peut-être de « se soucier » de ces « jeunes gens ». Qui sont-ils ? Un des petits Philippins avec qui Matzneff a eu des rapports tarifés écrira-t-il un jour un livre ? La fiction prend en charge de nombreuses questions, que Lolita met si finement en scène, glissant lentement vers le regard de l’autre sur soi-même : « À propos, je me suis souvent demandé ce qui advenait de mes nymphettes, après. En ce monde prisonnier du réseau implacable des causes et des effets, se pouvait-il que ce spasme que je leur dérobais secrètement n’eût pas influencé leur vie24 ? » C’est une question essentielle que soulève ici l’Humbert Humbert de Nabokov. Être désiré trop tôt est une clé pour comprendre à la fois l’esprit farouche, fuyeur, qui anime de nombreuses « nymphettes » (c’est-à-dire des fillettes érotisées), et ce qui est à l’œuvre dans la pédophilie : la façon dont le désir de l’autre peut emprisonner.
L’histoire que Gide relate dans La Porte étroite rejoint cette idée, à travers l’épisode au cours duquel la tante du narrateur fait du garçon de treize ans un sujet désiré. Elle s’approche, le retient habilement par les mots, finit par le caresser : l’enfant enregistre la moindre parole, le moindre geste. « Je courus jusqu’au fond du jardin ; là, dans un petit citerneau du potager, je trempai mon mouchoir, l’appliquai sur mon front, lavai, frottai mes joues, mon cou, tout ce que cette femme avait touché25. » Fiction ou réalité, quelque chose se rejoue sans cesse de son enfance dans sa sexualité, et le « singulier malaise [éprouvé] auprès de [s]a tante, un sentiment fait de trouble, d’une sorte d’admiration et d’effroi » qu’un « obscur instinct [prévient] contre elle » n’est pas sans rappeler tout ce que l’on peut trouver d’ambiguïté dans la construction d’un sujet qui passe moins par ses propres désirs que par ceux qui lui arrivent d’abord de l’autre (et je pense ici également à ce que rapporte Vanessa Springora de la confidence par Gabriel Matzneff d’une relation qu’il aurait eue vers cet âge-là avec un homme plus vieux). Il suffit de quelques mots à l’écrivain marocain Abdellah Taïa pour dire cette image de soi qui se constitue dans le désir de l’autre, et la perception qu’il a de ce désir, alors même que c’est une partie de son corps qu’il ne peut précisément pas voir qui le lui révèle :
Moi petit. Lui grand. Sa barbe qui pique. Mes fesses excitantes26.
En regard de Gide, de Nabokov, de Tournier (dont le Roi des Aulnes pourrait être ce « grand » qui aime « les fesses des enfants […] souriantes, naïvement optimistes, expressives comme des visages27 »), et de tant d’autres (comme Flaubert cherchant en Égypte des « gamins » à « enfiler28 »), en regard des correspondances littéraires, des journaux intimes et des fictions, il faut aller chercher l’Autre du pédophile et de l’écrivain. Il faut aller lire les « romans de ces écrivains [qui] sont devenus la voix des sans voix29 ». Je mentionnerai rapidement Rachid O’ (dont L’Enfant ébloui fait le récit de ses amours, très jeune, avec des hommes beaucoup plus âgés), Mohamed Choukri (« C’était donc ça, le petit tour ! […] Il déboutonna ma braguette avec lenteur… Et se mit à me sucer méthodiquement. Moi je bandais. Je n’osais pas le regarder en face… Les femmes ne manquent pas dans ce pays. Pourquoi ces hommes recherchent-ils les garçons30 ? »), et à nouveau Abdellah Taïa (« Et le pire, c’est que j’ai aimé ça, être entouré par les bras forts de cet homme de quarante ans qui sentait bon et qui me parlait dans l’oreille en français tout en essayant de trouver un chemin vers mon sexe, mes fesses31 »). La nouiba (amour en groupe et entre enfants) décrite par ce dernier dans Une mélancolie arabe peut-elle nous apprendre quelque chose du « faire pankas32 » dont parle Gide dans Ainsi soit-il ou Les Jeux sont faits ? Et l’épisode traumatique qui suit, dans laquelle il devient la « proie » d’un adulte cette fois, de la façon dont l’enfance est tout aussi naturellement forcée ?
S’essayer à une comparaison entre des textes en apparence très éloignés, marquer les nuances, conserver les photographies que Gide a pu prendre de jeunes Italiens sans pour autant les exposer33, n’est pas une façon de justifier des œuvres abordant le désir pour les enfants, mais d’appréhender la question pédophile de la meilleure manière possible, c’est-à-dire : la plus complète.
Depuis le début, c’est l’angle manquant : le regard de Lolita sur Humbert Humbert. Celui des jeunes amants de Gide. Celui de la « petite V. » sur un certain « G. ». Le 21e siècle est en train de renverser cette unilatéralité, à travers des mouvements qui ne concernent pas seulement la sexualité, mais la représentation du monde de l’Autre à large échelle, de la place de la « jeune fille » à celle de l’animal. À partir de la paradoxale révélation d’évidences – cause animale ou petite enfance, le renversement ne tient qu’à une prise de conscience34 –, de nouvelles questions sont posées. C’est par un ajustement des mots que peuvent arriver les premières réponses.
Quel mot avons-nous trouvé pour redéfinir la place d’un enfant, d’une personne abusée ou d’un animal maltraité ? Victime35. Il est possible que nous atteignions rapidement des limites avec ce que soulève cette expression, même si c’est elle qui permettra à l’art de se frayer un chemin vers les mots pour dire l’Autre que constitue, non plus l’objet, mais le sujet de son regard. À l’origine, la « victime » est la créature sacrifiée devant les dieux. Au nom de quoi sacrifier aujourd’hui ? L’Art ? Comment imaginer notre rapport à la beauté de demain, dans cet héritage si lourd de domination masculine36, sans ligoter la création ? Il est sans doute nécessaire que le regard de l’art même évolue vers une meilleure représentation du monde de l’Autre, non pas dans ce qu’il crée, mais dans la façon dont il crée : de même qu’il est interdit de blesser les animaux pour le besoin d’un film, la prise de parole actuelle va probablement modifier les rapports de domination dans le processus créatif.
En ce sens, l’inscription du débat sur la pédophilie dans notre époque rejoint tous les combats qui se réclament d’un élargissement du regard. Toute la littérature (comme le cinéma37) travaille à une extraction : à une multiplication des rapports et des points de vue. Elle met des mots là où ils manquent, elle permet d’être à la fois l’enfant, le pédophile, l’animal. C’est une entreprise de compréhension que Gide lui-même a entamée, avec les Africains, avec le Potto de Bosman Dindiki, avec les personnes qu’il croise sur sa route, mais aussi les plantes, dont il essaie scrupuleusement de décoder les spécificités, les mécanismes et les mouvements… Mais une tentative de compréhension n’empêche pas un aveuglement, elle n’empêche pas les déterminismes culturels, psychologiques, les ressorts avec lesquels fonctionne, tant bien que mal, l’individu. C’est avec ses limites que Gide pense le monde, c’est avec elles sans doute qu’il pense les « gamins » d’Afrique ou d’Italie comme des sujets érotiques. Il est étonnant que Gide ait focalisé son désir sur un pays comme l’Algérie sans jamais en rapporter d’observations sur la colonisation, qui auraient sans doute abouti à un combat comparable à celui qu’il a mené contre les compagnies concessionnaires en Afrique-Équatoriale française. Il a gardé ce pays comme le lieu de sa libération sexuelle ; le Tchad, le Cameroun, le Congo, comme ceux d’un réveil intellectuel capable d’agir sur des vies. Si l’on peut redéfinir en termes de « tourisme sexuel » les « voyages érotiques littéraires » de Gide, de Barthes, de Genet (tel que m’en a parlé Walter S. Temple38), comment juger de sexualités d’autres lieux, d’autres temps et d’autres corps, quand on lit par exemple Le Funambule de Genet, inspiré par son histoire d’amour avec Abdallah Bentaga, qui avait entre 16 et 17 ans lorsqu’il le rencontre, ou la correspondance entre Gide et Athman39 ? Que veut-on régler de ces destins qui semblent parfois autant relever de la littérature que de la vie, Abdallah se suicidant entouré de livres de Genet annotés de sa main, Athman, « un certain soir, dans une crise aiguë de poésie et de mysticisme », disparaissant « seul, à pied, dans le désert40 », à jamais ?
Seuls les livres peuvent encore donner la possibilité à une jeune femme blanche – pour ne pas feindre parler d’ailleurs que de ma propre voix –, de voyager en Gide, Genet, Abdellah ou Abdallah, de faire raisonner en elle une voix marocaine de sexe masculin réactualisant le « On me pense » rimbaldien :
Jean lui avait visiblement tout raconté, je n’étais plus pour elle le petit marocain qui découvrait l’Europe, je m’étais métamorphosé en petit démon, briseur de cœur, un arriviste, une petite pute finalement. Même pour elle, j’étais un autre. Pas celui que je pensais être, moi. Chacun avait son image de moi-même41.
En étudiant l’œuvre de Gide dans son ensemble (brouillons, journal, correspondance et romans), on peut déjà deviner, à travers les ajustements qui sont faits par l’auteur lui-même, la nature de sa relation avec les garçons qu’il croise42. En la comparant avec les lettres qu’il reçoit de jeunes Africains conservées dans les archives de la Fondation Catherine Gide (qui ne parlent que d’un lien éducatif ou d’aides) et en la confrontant à d’autres écrits, on peut espérer comprendre la part de fantasme et de réalité dans l’érotisme vécu chez l’Autre, avec l’autre, et dans la forme de collision que prend la rencontre, entre le regard occidental et le regard africain, selon qu’il y a ou non échange d’argent.
En relisant enfin les témoignages qui s’inscrivent en miroir de ce que Gide a pu écrire de ses relations érotiques avec des garçons, nous pouvons également accorder nos regards. Il en existe au moins deux : celui de François Derais (pseudonyme du « Victor » de son Journal43), et celui de Marc Allégret, dont Gide fut le précepteur et dont il deviendra l’amant et l’ami. Là où le premier témoigne à la fois de l’échec d’un Journal à dire toute la vérité, et d’un « grand écrivain » à ne pas se laisser déborder par sa position, le second semble montrer une réussite :
J’ai beaucoup connu André Gide, quand j’avais entre seize et vingt ans. […] Nous étions devenus très intimes, nos conversations allaient plus en profondeur ; il y avait entre nous une grande tendresse mutuelle. […] Mais le plus important, pour moi, à ce moment-là, était son enseignement. […] Nous lisions du grec ensemble et, naturellement, on a parlé du sujet crucial qu’il allait traiter dans Corydon. Je dois dire que Gide n’a jamais cherché à faire du prosélytisme (dans sa vie privée, il en parlait assez rarement d’ailleurs). Quand il a écrit ce livre, il l’a fait par honnêteté, et en pensant qu’il se fermerait bien des portes. Quant à moi, je trouvais cela tout naturel. Ce qui ne m’empêchait pas d’avoir des aventures féminines, comme cette Sarah qu’on retrouve dans Les Faux-Monnayeurs44 !
Plusieurs choses à relever ici : le lien indubitable entre la vie et l’œuvre, avec des ponts qui, dans leur franchissement, font muer la personne en personnage ; une relation harmonieuse, s’inscrivant dans l’idéal grec tant recherché par Gide (celle de l’éraste et l’éromène), dont leur Correspondance témoigne également. Loin des lettres d’amoureuses naïves45 à Matzneff, Allégret y va de sa propre langue, de ses mots rieurs ou crus, amusés ou torturés, on les voit avancer ensemble sur la ligne de leurs vies parallèles et, par alternance, nouées. Ce qui n’empêchera pas Gide de remettre en question, dans Les Faux-Monnayeurs, jusqu’à son propre modèle pédérastique46.
C’est sans doute parce que l’atypicité de la sexualité gidienne va bien plus loin que ce que la « pédophilie » tente actuellement de cerner que son œuvre est considérée comme nodale, non seulement d’un point de vue littéraire, mais aussi clinique, juridique et historique. Lacan relit sa « psychobiographie » par Jean Delay pour dire quelque chose du désir, de l’homo litterarius et de la « vérité de la fiction47 », le psychanalyste Albert Nguyên décrit son « tour de force » littéraire (« faire accepter son être déviant » et par là « ouvrir la voie au déplacement de la norme48 »), l’historienne Anne-Claude Ambroise-Rendu situe le moment du glissement chez lui49, tout comme le psychiatre Romain Pages, résumant : « l’œuvre de Gide, en sortant la question des relations pédérastiques du champ criminel, pour l’aborder sous l’angle du désir à la première personne, a préparé le temps de la révélation et de la revendication50. » Parce que Gide a amorcé un mouvement, parce qu’il a été un auteur nobélisé malgré ses penchants51, il est sans doute légitime de le placer, avec Matzneff, sur la frise chronologique de la pédophilie. Mais n’a-t-il pas aussi préparé l’époque dans laquelle nous nous trouvons, à savoir celle du Je de l’autre, du Je-victime, et du moi aussi ?
D’une œuvre sculptée par les particularités de son désir, dont la « clef première », dit son auteur lui-même, est « la non-conformité sexuelle52 », d’une œuvre si personnelle, Gide a su faire un colossal poumon littéraire. Toute une génération a trouvé en elle un lieu à partir duquel respirer plus grand. Je m’en suis rendue compte, à écouter des lecteurs de Gide me parler de la « révélation » qu’a représentée pour eux Les Nourritures terrestres sans n’avoir alors jamais compris que le héros, « rodeur pour pouvoir frôler tout ce qui rode », « épris de tendresse pour tout ce qui ne sait où se chauffer », ayant « passionnément aimé tout ce qui vagabonde53 » était un amoureux des jeunes garçons, et d’autres me dire combien Les Faux-Monnayeurs les avaient aidés dans l’acceptation de leur homosexualité. En ce sens, Gide a gagné sa place parmi « les Classiques », dont Barthes nous dit qu’ils « sont les maîtres de l’obscur, […] de l’ombre propice aux méditations et aux découvertes individuelles », ajoutant : « Obliger à penser tout seul, voilà une définition possible de la culture classique54. »
C’est ici que le génie de Gide relègue décisivement Matzneff à une autre place : là où ses écrits peuvent servir d’étendard de l’anticonformisme et de l’émancipation (le « crée de toi, impatiemment ou patiemment, ah ! le plus irremplaçable des êtres »des Nourritures terrestres), là où son Corydon joue aujourd’hui les prolongations au rayon Gender studies des bibliothèques universitaires nord-américaines, chez Matzneff, le lecteur ne peut que s’identifier s’il est un pédophile (et ce type de pédophile-là), ou le rejeter s’il ne l’est pas55. Ce qui fera date, ce n’est pas son œuvre : c’est l’exploitation littéraire de sa criminalité sexuelle – c’est, finalement, le témoignage de Vanessa Springora, révélateur du passage à l’ère des lolitas56, mais également du glissement, cette fois-ci, d’une pédérastie hésitante, d’une lutte avec soi-même, d’un « état de dialogue » ayant fait vivre Gide « en écartelé57 », à une pédocriminalité58 revendiquée.
4. La pédophilie dans la chaîne éditoriale
La nécessité d’écrire sur la pédophilie de Gide m’est apparue en pleine affaire Matzneff, au moment où Charlotte Butty déplaçait de Mulhouse vers la Suisse son exposition « André Gide et l’Afrique-Équatoriale française ». Les journalistes lui ont spontanément posé la question : « Est-il acceptable de consacrer aujourd’hui une exposition à André Gide59 ? » Autrement dit : est-il possible de lire encore un auteur dont on estime qu’il serait condamné aujourd’hui pour certaines de ses actions ?
Les éditions Gulf Stream, en 2016, avaient décidé de renoncer à publier les livres de l’auteur de fantasy Jérôme Noirez, condamné par la justice pour détention et diffusion d’images à caractère pédopornographique. Bérénice Hupel, leur directrice,avait alors écrit dans un communiqué : « certains sujets ne peuvent être traités avec nuance ». La nuance n’est-elle pas au contraire le mot-clé pour aborder ces questions ? Bien sûr, il n’est plus envisageable d’organiser des séances de signatures d’un écrivain pédophile avec un « public Jeunesse », mais ses lecteurs ne tiraient-ils pas des bénéfices de ses livres, qui ne disent rien de sa pédophilie ? La condamnation d’un auteur doit-elle signer la mort de ses créations ?
La mesure de l’influence concrète d’une œuvre permettrait de mieux savoir quoi faire des écrits d’auteurs pédophiles ou relevant de la pédophilie. Le cas de Gide nous éclaire également sur ce problème, que remet intelligemment à plat David Steel : « Gide était, de bien des manières, un homme-enfant, observateur de l’enfance, hanté par l’enfance, qui plus est, un Erlkönig (Roi des Aulnes) […] en proie à une pulsion délétère certes, mais qui faisait de lui, à sa manière, une sorte de victime de l’enfance, y compris de la sienne. […] Chacun connaît le célèbre […] “Je ne suis qu’un petit enfant qui s’amuse – doublé d’un pasteur protestant qui l’ennuie” (Journal, I, 576). Heureusement qu’il y avait en Gide ce pasteur, […] ce qui fait qu’il est peut-être permis de le croire lorsqu’il excipe de l’influence, soit personnelle, soit littéraire, presque exclusivement bénéfique qu’il a eue sur les jeunes gens, c’est-à-dire sur nous tous, du moins d’esprit, ici assemblés aujourd’hui60. »
Le travail de l’éditeur, s’il se rapproche parfois de celui du législateur afin de savoir ce qu’il est autorisé ou non à publier, est sans doute de s’adapter aux affaires en cours, mais peut-être également de relayer un discours sur la différence entre le livre et son auteur. Il y a un corps, et il y a un texte. Il y a un corps qui tient en laisse un texte. Procès doit être fait au corps. Liberté doit être donnée à l’œuvre. Ce qui n’empêche pas, dans le cadre d’un procès, d’utiliser la laisse comme le lien qui décidera de la valeur juridique d’un Journal.
La décision de Gallimard de suspendre la commercialisation des journaux d’un écrivain pédophile est à l’écoute de son temps : la fiction peut tout se permettre, mais des textes qui reposent sur l’existence de « victimes » doivent être relégués à une autre zone. Mais cette zone doit-elle être cachée ? C’est avant tout dans la réception que peuvent résider les limites : ne pas censurer, mais ne pas récompenser61 une œuvre ouvertement pédophile, ne pas refouler – puisqu’il s’agit de reconnaître ce qui est, j’y reviendrai –, mais conserver, et ne pas retrancher, mais ajouter, appareiller.
Au sujet de Matzneff, Philippe Lançon remarquait : « L’état de pédophile concurrence celui d’écrivain62. » C’est d’autant plus vrai au moment où Vanessa Springora défait les fondements de sa littérature d’un coup de plume, la transmettant à la postérité (alors même que l’écrivain n’est pas encore mort) comme affaire, et non comme œuvre. L’affaire d’un pédophile qui écrivait… Les journaux de Matzneff deviennent le pendant littéraire aux « carnets noirs » du chirurgien Le Scouarnec63, qui a consigné pendant près de trente ans ses obsessions pour les enfants, la façon dont il a abusé sexuellement d’eux, ses activités pédopornographiques, avant que ses écrits ne soient dénichés en 2017. Par la joie pédophile qu’ils expriment, le style répétitif et la liste qu’ils révèlent, ils font écho à la complaisance de Matzneff, à ses petits « culs frais64 », à ses conquêtes dépersonnalisées – l’âge compte avant toute chose, et quand il y a un prénom, le pronom qui le devance l’uniformise : « un huit ans65 », « une Vanessa66 »… –, à ses récits, pour le résumer avec le psychiatre Bernard Cordier, « qui ressemblent à des modes d’emploi67 ». Alors pourquoi publier le journal de Matzneff, et non celui du Scouarnec ? C’est avant tout (avant même la décision ou non d’interdire) l’intention qui se trouve derrière un écrit qui présage de sa destination : Matzneff se veut écrivain, et enrobe ses écrits pour les transmettre aux générations à venir ; Le Scouarnec se veut pédophile, et demande à ce que les cartons qui contiennent ses textes soient brulés sans être lus à sa mort.
Quelle différence pouvant justifier d’une rupture ou d’une continuité éditoriale alors entre les journaux de Gide et ceux de Matzneff, tous destinés à la publication ? Une « pédérastie allusive » contre une sexualité « industrielle », dirait Sollers68, de « menus aveux », dirait Barthes69, contre un épanchement rébarbatif. Ses journaux, tenus sur des supports divers entre 1887 et 1950, s’ils font mention de ses escapades avec de « petits Arabes », portent sur tous les sujets, explorent doutes et contradictions, construisent un commentaire filigrané de sa vie comme de son époque, sont le lieu dans lequel se construit patiemment une œuvre, ne forment pas un manifeste pédophile. Un juriste ajouterait : on ne peut juger un habitant d’hier avec la législation actuelle (principe de non-rétroactivité des lois).
Si les « écritures pédophiles » du Scouarnec, de Gide ou de Matzneff ne s’inscrivent donc pas dans la même époque, ne relèvent pas de la même démarche et ne recouvrent pas la même forme, elles constituent un ensemble de textes nécessaires à la compréhension de ce qui anime le désir pédophile, dans ce qu’il comporte de réalité, de possible et de danger, à travers ce que leurs auteurs fixent, retiennent ou biffent, de leur intime. Le Journal de Julien Green, récemment publié, vient encore ajouter, dans sa propre langue, un lot de révélations plus utiles que scandaleuses. Ces écritures du dedans, du derrière et du dessouspermettent de s’interroger sur ce qui parcourt un corps de sa naissance à sa mort, et sur ceux qui le parcourent, aussi. Ce sont des questions d’itinéraires que posent peut-être d’abord les sexualités. L’écriture en est un supplémentaire, qui ajoute peut-être la question d’une responsabilité. Cette responsabilité, Gide la déplace : si exemplarité il y a, ce n’est pas dans une sexualité plus acceptable qu’une autre, mais dans la sincérité70 envers les autres et soi-même. Dans un billet qu’il adresse à Élisabeth Van Rysselberghe, la future mère de sa fille Catherine, Gide note, et c’est on ne peut plus limpide :
Je n’aimerai jamais d’amour qu’une seule femme ; je ne puis avoir de vrais désirs que pour les jeunes garçons. Mais je me résigne mal à te voir sans enfant et à n’en pas avoir moi-même.
L’écriture ne s’érige pas dans une intention particulière, elle ne remplit pas un rôle, mais elle se situe en posant fermement, comme définitivement, ce qui est. La présence, dans une même image, implicite ou explicite, du pédophile et de l’enfant nous insupporte en premier lieu parce qu’elle nous met face à une réalité. Gide, écrivain d’hier, le disait : « Je n’ai point cherché à prouver que [la pédérastie] doive être ; comprenez qu’il faut partir de ce point, de ce fait : elle est71. » Arthur Dreyfus, écrivain d’aujourd’hui, le souligne : « notre monde moderne, commercial, ce monde de marketing, n’a jamais été aussi pédophile, c’est pourquoi tout attrait pour la jeunesse est condamné aussi sévèrement, aussi moralement. On a peur de ce qu’on est72. » Antoine Gallimard, éditeur de cette lignée, y insiste : « la littérature est là, non pour dire le monde tel qu’il doit être, mais tel qu’il est73 ». On ne peut envisager de décrocher les toiles de Balthus74, pas plus que de retirer ses mots à Matzneff. Mais il faut savoir regarder et lire une œuvre. L’art est, peut-être, indissociable du discours, là où la pulsion s’en passe. Picasso disait que l’on devait « l’interdire aux ignorants innocents, ne jamais mettre en contact avec lui ceux qui y sont insuffisamment préparés ». C’est parce qu’il nous expose tels que nous sommes, et que la naïveté consisterait à croire que son but est de normaliser, son pouvoir, de légiférer.
Le changement en cours est considérable : le laxisme du milieu littéraire qui a permis à Gabriel Matzneff de se poser comme le pédophile parfait et d’être médiatisé (point non négligeable quand on pense à l’encouragement que cela peut représenter75), tandis qu’un pédophile de n’importe quelle autre profession voit sa vie brisée, est en phase de dissolution. Mais un nouveau danger se lève : la procédurisation, l’automatisation des refus, la mise à mort des écrits en lien avec la pédophilie.
Faut-il, doit-on, est-il acceptable de… gommer le mot « nègre », enterrer l’expression « Mademoiselle », jeter Matzneff, oublier Gide, retirer ses prix à Polanski… tout cela semble relever d’un même mouvement, dont la légitimité réside dans de réels abus soutenus par des systèmes familiaux (la famille Politique, Édition, Sport…), mais doit porter plus loin ses réponses, en misant sur l’esprit critique. « Éducation, c’est délivrance. C’est là ce que je voudrais apprendre à Marc », note Gide le 6 novembre 1917. C’est peut-être sur elle qu’il faut parier, et non sur un idéalisme qui nie une certaine réalité et s’inscrit comme une potentielle (nouvelle) machine à tyranniser. L’équilibre à trouver se situe toujours entre l’indignation bruyante et le silence.
Conclusion
Le sujet pédophile, parce qu’il implique l’existence de victimes potentielles, exige un débordement. Mais il invite aussi à revenir de ce que nos émotions peuvent générer d’excès, pour ajuster nos liens à l’histoire de la littérature (et de l’art en général) et aux histoires qui la nourrissent. Il faut se tenir dans une position déjà existante, déjà difficile : la position du diplomate. Lire devient diplomatique dans la mesure où cela demande, sans épouser le contenu d’un livre mais l’admettant, de s’y projeter pour mieux imaginer ce qu’il est possible de faire, à partir d’où nous pensons – de quel état de l’humanité ? – et, d’une certaine façon, que cette formulation passe ou non pour provocante, de mieux faire cohabiter le pédophile et l’enfant. C’est devenir, selon une définition donnée dans un tout autre contexte, mais à partir d’une expérience du terrain éloquente quant à la cohabitation du loup, des brebis et des bergers (l’imaginaire prédationnel convoqué n’est-il pas d’ailleurs fréquemment celui-là ?), par Baptiste Morizot, « légèrement traître » à l’égard de tout le monde : « Trancher fermement pour l’ambivalence, se maintenir dans l’incertitude, dans la pluralité des points de vue contradictoires, pour chercher des solutions plus saines et plus vivables, au service des relations d’interdépendance76. » Imaginer dans une relation d’interdépendance le pédophile et l’enfant, ce n’est en aucun cas accepter l’abus, le viol ou le seul érotisme d’un lien, c’est précisément fixer ce qu’est une relation possible entre un adulte et un enfant, et ainsi éviter la « société de dangers » construite autour de la sexualité comme menace et fantôme dont parle Foucault77. C’est éviter de tomber aussi dans une zone permissive que Foucault lui-même n’a pas évitée, en oubliant de penser les crimes pédophiles dans leur aspect le plus banal, le plus concret, le plus problématique – qui ne se situe pas au niveau du discours, mais bel et bien des faits. C’est encore envisager qu’il n’y a pas de part et d’autre d’une ligne stable des pédophiles et des enfants, c’est-à-dire des identités définitives s’affrontant sur un ring, mais un terrain vague, densément peuplé, complexe, souple, des âges et des relations. C’est enfin considérer que la posture à laquelle nous oblige ou nous invite l’art va à l’encontre de la facilité. Elle représente un temps pour visualiser et réfléchir, non pour trancher. Lolita est encore une fois exemplaire de ce point de vue là, puisqu’il fait cohabiter l’imaginaire du désir pédophile, sa mise en scène et sa réalisation, avec une éthique sociale, annoncée dans son introduction par John Ray : « Lolita nous commande de lutter tous au coude à coude – parents, éducateurs, assistantes sociales – et de redoubler d’efforts, avec une compréhension élargie et une vigilance inflexible, pour élever des générations meilleures dans un monde plus sûr78. »
Si la littérature ne montre pas d’emblée son hostilité envers la relation pédophile et bien plutôt son hospitalité, c’est parce qu’elle est le lieu dans lequel une certaine réalité résiste – résiste aux interdits et au temps. Lire la pédophilie revient à chercher l’écharde, à escarder, à effeuiller les sexualités, dans le roman comme dans ses marges. Le texte qui accompagne la vie, qui se glisse entre le brut et l’irréel, qui fait tampon, paroi, glissière : qui voudrait, ce texte, le sabrer ? Il est à la fois preuve, présence et possible. Il rend visible, et audible, ce qui se fabrique hors les mots. Il organise, et autour de lui peut s’organiser le processus de réflexion qui nous conduira plus loin.
Notre société doit accepter comme un socle fixe ses interdits – le meurtre, l’empêchement de l’inceste, l’existence de paliers sexuels liés aux âges –, avancer avec les connaissances, elle doit aussi savoir que repose sur eux un ensemble mouvant, soumis au temps et aux évolutions. Le texte littéraire nous montre les passages plus souvent qu’il ne cherche à cautionner des relations, à condition de s’en faire critique. Et il constitue une base solide pour comprendre le nomadisme de nos représentations. On ne doit pas publier un livre parce qu’il parle de pédophilie, mais parce qu’il questionne nos convictions. « Le chemin le plus clair est le trouble79. » Au cœur de la question pédophile, André Gide nous fournit un cas éclairant.
NB. Cet article a été publié dans la Revue Année Zéro, sous la direction de Yann Moix, en janvier 2022.
[1] Suivant la racine grecque du mot « pédophile », composé de paîs (enfant) et philía (amour, amitié).
[2] Boris Cyrulnik livre un témoignage éclairant dans son livre La Naissance du sens (Paris, Hachette, 1995). Voir le « Débat sur l’inceste réussi », avec Dominique Lecourt, p. 140.
[3]Voir les articles d’Anne Chemin publiés dans Le Monde (« De la pédophilie à la pédocriminalité, comment les agressions sexuelles sur mineurs sont devenues le mal absolu », 31 janvier 2020, « Les années 1970-1980, âge d’or de l’apologie de la pédophilie en France », 28 février 2020), de Dominique Perrin, également dans Le Monde (« “Les temps ont changé, il est devenu indéfendable” : dans un contexte post-#metoo, le malaise Gabriel Matzneff », 23 décembre 2019, « Prescription, déni, complaisance… Matzneff, une affaire en souffrance », 26 juin 2020), les entretiens avec Pierre Verdrager publiés sur L’Opinion(« Le livre de Vanessa Springora neutralise le récit de Matzneff sur la pédophilie ») et Télérama (« Affaire Matzneff : “Au prétexte de la libération sexuelle, la pédophilie était valorisée” », 2 janvier 2020), les articles d’Aude Lorriaux dans Le Parisien (« Affaire Gabriel Matzneff : Pourquoi la pédocriminalité a été minimisée dans le milieu littéraire français », 31 décembre 2019) et de Fiona Moghaddam sur le site de France culture (« Pédocriminalité : ce que disent les lois depuis 1810 », 2 janvier 2020), etc. Des articles antérieurs s’étaient bien sûr déjà interrogés sur ces questions : Anne-Claude Ambroise-Rendu, dans L’Histoire(no 296, mars 2005 : « Le pédophile, le juge et le journaliste ») ou Le Temps des médias (no 1, 2003, « Un siècle de pédophilie
dans la presse [1880-2000] : accusation, plaidoirie, condamnation »), Hubert Prolongeau dans Le Magazine littéraire (no 577, 2017, « Pédophilie, des totems au tabou »), etc.
[4] Dans « Lire Matzneff », les contributeurs à Lundi Matin proposent une vraie lecture de ses textes, qui ne s’arrête pas à des extraits, mais creuse à la fois son intention littéraire et les décisions éditoriales prises à la suite de la publication du Consentement (<www.lundi.am/Lire-Matzneff>, 13 avril 2020).
[5] Voir Ambre Philippe, Après le livre. Une enquête sur André Gide, Fondation Catherine Gide, 2016, 90 min. (en libre accès : <https://apres-le-livre.fondation-catherine-gide.org/le-film/>), et id., André Gide autour du monde. Un carnet de voyage gidien, Paris, Orizons, 2019.
[6] Du non-être à l’enfant-citoyen, l’enfant n’a pas toujours été l’entité que l’on admet communément aujourd’hui. On peut lire, sur « l’émergence de l’enfant-citoyen », La Libération des enfants. Contribution philosophique à une histoire de l’enfance, d’Alain Renaut (Paris, Bayard, 2002), ou ce qu’écrit Jean-Noël Luc dans L’invention du jeune enfant au 19e (Paris, Belin, 1998) : « Il faut attendre la modernité pour que l’enfance devienne un continent à part. »
[7] Me penchant sur la complexité du cas gidien, il me semble que cette figure désirante pourrait trouver dans l’orexis aristotélicienne un nouvel enracinement. La racine du désir comme source et puissance n’évitant pas le conflit, comme animation intime et comme tension vers et entre, à la fois dégagé de la fixité des notions manichéennes, mais impliquant, sans l’obliger, la notion de débordement (tout comme l’appétit, orexie). Pourquoi alors ne pas parler, à propos des sujets complexes, notamment ceux qui articulent le mouvement de l’écriture à celui de la recherche de plaisirs, de pédorexie ? Le mot anglais pederosis, utilisé par Nabokov dans Lolita, est également plus apte à décrire ce que nous appelons aujourd’hui pédophilie, regroupant trois éléments : pedo, enfant, eros, amour, désir, et osis, trouble, maladie.
[8] D’après l’historien Georges Vigarello, cité par Régis Revenin dans Homosexualité et prostitution masculines à Paris : 1870-1918, Paris, L’Harmattan, 2015, p. 175.
[9] Id.
[10] DSM-5, publié par l’APA (American Psychiatric Association) en 2018.
[11] Romain Pages, La pédophilie : médicalisation d’un désir interdit, Médecine humaine et pathologie, 2018, HAL Id : dumas-01766814.
[12] François Porché, L’Amour qui n’ose pas dire son nom (Oscar Wilde), Paris, Grasset, 1927.
[13] André Gide, L’Immoraliste, dans Romans et récits, t. I, éd. Pierre Masson, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2009, p. 690-691.
[14] Vladimir Nabokov, « Entretien sur Lolita », L’Express, 5 novembre 1959.
[15] André Gide, Dostoïevski [1923], Paris, Gallimard, 1964, p. 216.
[16] Se reporter au « secret de ressuscité » décrit dans Si le grain ne meurt [1924], dans Souvenirs et voyages, éd. Pierre Masson, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2001, p. 293 sqq.
[17] « Préface de la traduction américaine (1950) » de Corydon, dans Romans et récits, t. II, éd. Pierre Masson, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2009, p. 172.
[18] L’épisode qu’il relate dans Si le grain ne meurt au sujet de Mohammed, qu’il retrouve « deux ans plus tard » avec « je ne sais quoi de dur, d’inquiet, d’avili », témoigne à la fois de son attention et de son aveuglement : voir Souvenirs et voyages, op. cit., p. 310-311. Voir également les « Feuillets inédits 1910 », p. 1110-1113.
[19] Sur la confusion entre désir sexuel et désir d’attachement, ou besoin d’attachement, différence d’intentionnalité aujourd’hui largement comprise (si l’enfant exprime un désir, ce n’est pas d’avoir une relation sexuelle dont il ne maitrise aucun aspect, mais de recevoir une forme d’affection), on peut regarder l’entretien de Boris Cyrulnik avec Léa Salamé dans Stupéfiant (mars 2020) : <www.youtube.com/watch?v=FDakn-TQ7G4>.
[20] Voir un passage explicitant bien son regret de passer de la contemplation à la « débauche » dans son Journal, t. I : 1887-1925, éd. Éric Marty, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1996, p. 664-665.
[21] Voir « Je voudrais être cet Arabe… », dans Le Renoncement au voyage, ibid., p. 393.
[22] Voir L’Immoraliste, dans Romans et récits, t. I, op. cit., p. 684
[23] Voir Jean-Marc Varaut, Les Procès d’Oscar Wilde, Paris, Perrin, 1995.
[24] Vladimir Nabokov, Lolita, Paris, Gallimard, 1959, p. 34.
[25] Id., La Porte étroite [1909], Paris, Gallimard, « Folio », 1994, p. 22.
[26] Abdellah Taïa, Une mélancolie arabe, Paris, Seuil, 2008. Je souligne.
[27] Le Roi des aulnes, Paris, Gallimard, 1970, p. 354.
[28] Voir la lettre de Flaubert à Louis Bouilhet du 15 janvier 1850 (Le Caire), dans Gustave Flaubert, Œuvres complètes, t. 12 : Œuvres diverses, 1 : Fragments et ébauches ; Correspondance, 1830-1850, Paris, Club de l’Honnête homme, 1974, p. 674.
[29] Voir le travail de Gibson Ncube : Constructions et représentations littéraires de la sexualité « marginale » sur les deux rives de la Méditerranée : Rachid O., Abdellah Taïa, Eyet-Chékib Djaziri et Ilmann Bel », Stellenbosch University, 2014.
[30] Mohamed Choukri, Le pain nu, trad. Tahar Ben Jelloun, Paris, Librairie François Maspero, 1980, p. 82-83.
[31] Abdellah Taïa, L’Armée du salut, Paris, Seuil, 2006, p. 61.
[32] André Gide, Ainsi soit-il ou Les Jeux sont faits [1952], dans Romans et récits, t. II, op. cit., p. 1050-1051.
[33] Photographies conservées dans les Archives de la Fondation Catherine Gide, qui font l’objet d’une description de la part de Gide dans Et nunc manet in te, dans Souvenirs et voyages, op. cit., p. 947. Si elles sont très belles, elles pourraient soulever des questions comparables à celles qui animent les débats sur la publication du livre Sexe, race et colonies (Paris, La Découverte, 2018).
[34] Les animaux ont toujours été intelligents et la pédophilie a toujours été un problème : c’est sur ce type de renversement qu’insistent des titres récents, empruntant à l’art de la pirouette : Révolutions animales. Comment les animaux sont devenus intelligents (Karine Lou Matignon [dir.], Paris, Les Liens qui libèrent, 2016), Sommes-nous trop « bêtes » pour comprendre l’intelligence des animaux ? [Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are?] (Frans de Waal, id.) , L’Enfant interdit. Comment la pédophilie est devenue scandaleuse (Pierre Verdrager, Paris, Armand Colin, 2013).
[35] Sur le sujet, lire Tom Raisen, « Relecture d’un classique à l’ère du #metoo. Faut-il bannir l’œuvre d’André Gide ? », Land, 15 mars 2019, en ligne : <www.land.lu/page/article/260/335260/DEU/index.html>.
[36] On peut lire Muriel Salmona, Le Livre noir des violences sexuelles (Paris, Dunod, 2013). Anne Chemin en parle dans son article « Pédophilie : naissance d’un intolérable contemporain » (Le Monde, 1er février 2020) : « En dénonçant, au XXe siècle, la domination masculine, les féministes imposent peu à peu un autre regard : elles combattent la vieille croyance en l’incontrôlable “énergie” sexuelle des hommes, elles insistent sur le fait que le silence ne vaut pas consentement, elles montrent que l’agression sexuelle est une forme extrême d’oppression. »
[37] Regarder La Chasse (de Thomas Vinterberg, 2012), sur la façon dont une amitié avec une enfant va détruire la vie d’un adulte inculpé à tort, et Little children (de Todd Field, 2006), dont la caméra permet d’être spectateur d’un dérangement qui ne concerne pas seulement le pédocriminel, mais toute une société.
[38] Ambre Philippe, André Gide autour du monde, op. cit., p. 111, ou Après le livre, film cité, 20e min 20 s.
[39] En partie reproduite dans le Bulletin des Amis d’André Gide, no 102, avril 1994.
[40] Marcelle Schveitzer, Gide aux Oasis, Nivelles, Éd. de la Francité, 1971, p. 86, cité dans le BAAG, ibid.
[41] Abdellah Taïa, L’Armée du salut, op. cit., p. 116.
[42] Voir ce que dit Frank Lestringant dans sa biographie André Gide l’inquiéteur, t. I, Paris, Flammarion, « Grandes Biographies », 2011, p. 246-247.
[43] L’Envers du Journal de Gide, Tunis 1942-43, Paris, Le Nouveau portique, 1951.
[44] Marc Allégret répond à un journaliste. Voir les annexes de la Correspondance entre Gide et Marc Allégret, Paris Gallimard, « Les Cahiers de la NRF », 2005.
[45] Je pense aux « lettres d’une petite fille au vilain monsieur » des Moins de seize ans. Vanessa Springora écrit : « On croirait lire la prose naïve et désuète d’amoureuses d’un autre siècle. Ce ne sont pas les mots de gamines de notre âge, ce sont les termes universels et atemporels de la littérature épistolaire amoureuse. G. nous les souffle en silence, les insuffle dans notre langue même. Nous dépossède de nos propres mots. » (Le Consentement, Paris, Grasset, 2020, p. 82.)
[46] Je renvoie ici à qu’en dit Claude Coste dans « L’art de la fugue », in Hélène Baty-Delalande (dir.), Les Faux-Monnayeurs, Relectures, Paris, Publie papier, 2013.
[47] Voir Jacques Lacan, « Jeunesse de Gide ou la lettre et le désir », Critique, no 131, Paris, Éditions de Minuit, 1958, p. 291-315, repris dans Écrits, Paris, Le Seuil, 1966.
[48] Albert Nguyên, « Un devoir de sincérité : Gide à la question », L’en-je lacanien, no 21, 2013, p. 50.
[49] Voir le chapitre 5 de son Histoire de la pédophilie : XIXe-XXIe siècles, Paris, Fayard, 2014.
[50] Romain Pages, op. cit., p. 23.
[51] Voir ce qu’il en dit dans sa préface à la traduction américaine de Corydon, déjà citée.
[52] Lettre d’André Gide à Ramon Fernandez, citée par Jean Delay, La Jeunesse d’André Gide, t. II, Paris, Gallimard, 1957, p. 549.
[53] Les Nourritures terrestres, dans Romans et récits, t. I, op. cit., p. 401.
[54] Roland Barthes, Œuvres complètes, t. I, Paris, Seuil, 2002, p. 46. Je souligne.
[55] Michel Onfray raconte comment il a « cessé d’aimer cet auteur » dans son pertinent « Du bon usage de la pédophilie », L’Infini, no 59 : La Question pédophile, 1997. En ligne : <https://michelonfray.com/interventions-hebdomadaires/du-bon-usage-de-la-pedophilie>.
[56] J’entends par lolitas les figures désirées prenant aujourd’hui la parole.
[57] André Gide, Morceaux choisis, Paris, La NRF, 1921, p. 434.
[58] Charlotte Cauzit en parle dans son article « Pourquoi vaut-il mieux parler de “pédocriminalité” plutôt que de “pédophilie” ? », en ligne : <www.francetvinfo.fr/culture/livres/affaire-gabriel-matzneff/pourquoi-vaut-il-mieux- parler-de-pedocriminalite-plutot-que-de-pedophilie_3778825.html>. Il est à noter qu’à ce jour, la criminalité de Gabriel Matzneff est présumée, l’écrivain n’ayant pas encore été jugé. Le premier procès, pour « apologie de la pédophilie », se tiendra en 2021.
[59] Notamment Valérie Passelo : « La Médiathèque Valais accueille, en avant-première suisse, l’exposition “André Gide et l’Afrique équatoriale française” jusqu’au 13 mars. L’auteur a été l’un des premiers à se montrer critique vis-à-vis du colonialisme au début du 20e siècle. Mais son nom ressort aujourd’hui dans l’actualité, à la lumière de l’affaire Matzneff. Gide, comme d’autres intellectuels de son époque, ne cachait pas ses inclinations pour les très jeunes garçons. Est-il, dès lors, acceptable de lui consacrer une exposition ? » <www.leregional.ch/N131885/andre-gide-un-lanceur-d-alerte-bien-sulfureux.html>.
[60]Bulletin des Amis d’André Gide, no 31, octobre 2003, p. 443.
[61] Charlotte Pudlowski note : « On écrit parfaitement bien depuis les prisons françaises. Les éditeurs peuvent venir chercher des textes au parloir, rien ne les empêche de les publier. Les jurés littéraires ne sont pas obligés de les honorer. » Article publié suite à la remise du Renaudot à Gabriel Matzneff : « Non Gabriel Matzneff, la pédophilie n’est pas un “style de vie” », publié sur Slate le 19 novembre 2013 : <http://www.slate.fr/culture/80167/matzneff>.
[62] Voir Philippe Lançon, « Le Diable attrapé par la queue », Charlie hebdo, 31 décembre 2019.
[63] Voir l’article de Rémi Duprès et Florence Aubenas dans Le Monde du 3 janvier 2020 : « Les “carnets noirs” de Joël Le Scouarnec, le chirurgien pédophile ».
[64] Gabriel Matzneff, Un galop d’enfer (Journal 1977-1978), Paris, La Table Ronde, 1985.
[65] Id., Mes amours décomposés (Journal 1983-1984), Paris, Gallimard, 1990.
[66] Un galop d’enfer, op. cit.
[67]BernardCordier, « Non au prosélytisme », L’Express, 2 février 1995.
[68] Philippe Sollers, « Le Libertin métaphysique », Le Monde, 25 septembre 1981. En ligne : <www.pileface.com/sollers/spip.php?article365>.
[69] Roland Barthes, « Notes sur André Gide et son Journal », dans Œuvres complètes, op. cit.
[70] Le sujet est abondamment traité dans la critique littéraire gidienne, je mentionnerai ici le travail de la sociologue Gisèle Sapiro autour de Gide : « Le principe de sincérité et l’éthique de responsabilité de l’écrivain », dans L’écrivain, le savant et le philosophe : La littérature entre philosophie et sciences sociales, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2003, disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/psorbonne/19852> (2/02/2020).
[71] André Gide, « Feuillets », 1910, Journal, I, op. cit., p. 668.
[72] Cité par Rémi Guinard dans son article publié sur Slate le 29 mai 2016 : <http://www.slate.fr/story/113541/encore-ecrivains-maudits>.
[73] Voir son entretien dans le Journal du Dimanche du 12 janvier 2020.
[74] Cf. la polémique ayant entourée l’exposition de Thérèse rêvant (1938) au Metropolitan Museum of Art, à New York, en 2017.
[75] Voir Bernard Cordier, op. cit.
[76] Baptiste Morizot, Manières d’être vivant, Arles, Actes Sud, 2020, p. 241.
[77] Voir Michel Foucault, « La Loi de la pudeur », dans Dits et écrits, t. 2 : 1976-1988, Paris, Gallimard, « Quarto », 2001, p. 772.
[78] Vladimir Nabokov, op. cit., p. 11.
[79] Baptiste Morizot, op. cit.