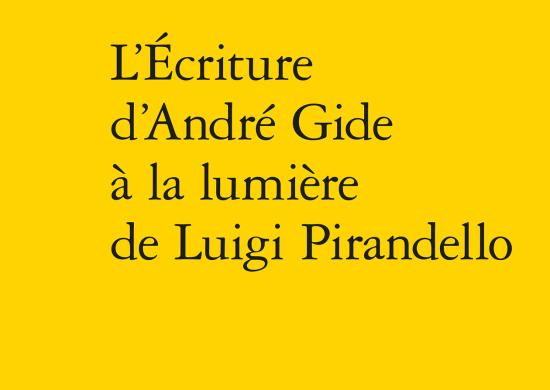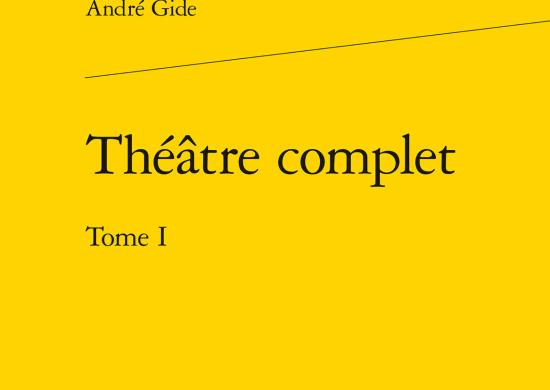Sur : Arden de Faversham. Trad. de l’anglais par André Gide. Édition publiée sous la direction de Jean-Yves Tadié. Préface de Jean-Pierre Prévost, Paris, Gallimard, « Le Manteau d’Arlequin – Théâtre français et du monde entier », 2019, 160 p.
Cette publication se base sur un tapuscrit de la traduction d’Arden de Faversham par André Gide, dont Jean-Pierre Prévost a fait l’acquisition lors d’une vente aux enchères en 2016. Dans sa préface, ce dernier s’attarde sur l’histoire mouvementée de la traduction, par Gide, de cette pièce à l’auteur anonyme, datant de la fin du XVIe siècle.
Gide, comme d’autres de ses contemporains, était convaincu de la nécessité de traduire de grands auteurs étrangers pour s’accomplir en tant qu’écrivain. Son œuvre de traducteur comprend notamment Hamlet, ainsi qu’Antoine et Cléopâtre. La traduction d’Arden de Faversham s’avère cependant être son entreprise de traduction la plus étrange. Cette pièce — basée sur le fait réel de l’assassinat du gentilhomme Thomas Faversham — était particulièrement novatrice et audacieuse pour son temps. Il s’agit de l’une des premières pièces à pouvoir être classifiée comme drame bourgeois ou tragédie bourgeoise dans la littérature élisabéthaine. Sa dramaturgie, ainsi que sa bouffonnerie, la rendent frappante de modernité. C’est sans doute un désir d’exercice intellectuel qui poussa Gide à entreprendre sa traduction. Exercice où il s’avéra particulièrement lucide grâce à son élégance, sa concision, sa fermeté et, surtout, son sens du théâtre.
En 1932, c’est l’écrivain qui proposa à Antonin Artaud de traduire la pièce. Parallèlement, il travaillait sur une traduction de Hamlet pour Jacques Copeau[1]. Ces deux traductions n’eurent pas de suite immédiate, le Hamlet engendrant des difficultés de traduction. De plus, Gide était en désaccord avec la conception théâtrale d’Artaud. Selon lui, la suprématie de la mise en scène nuit au texte dans le théâtre de ce dernier.
En 1933, un extrait de la traduction d’Arden par Gide fut publié dans un numéro des Cahiers du Sud, consacré entièrement au théâtre élisabéthain. En 1937, la compagnie Le Rideau de Paris s’intéressa à cette traduction. Finalement, c’est Henri-René Lenoir qui traduisit le texte, moins fidèlement que Gide ne l’aurait fait selon Marcel Herrand[2].
Dix ans plus tard, en 1947, Richard Heyd, éditeur suisse du Théâtre complet se réjouit de savoir que Gide a repris la traduction de la pièce. Le 1erjuin 1948, l’écrivain lui en transmet une version complète pour une publication. Et pourtant, cette traduction ne figurera pas dans l’édition.
En 1950, Gide se remit à sa traduction, cette fois dans le cadre d’une collaboration avec Jean-Louis Barrault. Il s’installa à Juan-les-Pins, dans une villa mise à sa disposition par Florence Gould, afin de travailler à ce projet avec Élisabeth Van Rysselberghe. Durant cette période, il affirmait être heureux[3]. Cependant, le projet ne fut jamais finalisé pour deux raisons : un nouveau projet d’adaptation des Caves du Vatican, puis le décès de l’écrivain, en février de l’année suivante.
Jean-Pierre Prévost émet deux hypothèses pour ce qui est de l’origine du tapuscrit qu’aucune indication ne permet de dater. Selon lui, il s’agit soit de la version de 1948, envoyée à Richard Heyd, soit de la version complète remaniée de 1950.
Afin d’en savoir davantage, Jean-Pierre Prévost a comparé ce tapuscrit avec les versions manuscrites écrites par André Gide et Élisabeth Van Rysselberghe, et conservées aux Archives de la Fondation Catherine Gide. Les répliques sont identiques. Les indications manuscrites sur la page de garde du tapuscrit semblent avoir été rédigées par Élisabeth Van Rysselberghe. Des notes manuscrites de Gide sont visibles tout au long du premier acte. La reliure soignée et les dix pages blanches précédant le premier acte laissent penser que cet exemplaire était destiné à l’éditeur.
Dans cette préface bien ficelée, Jean-Pierre Prévost parvient à mettre en évidence les enjeux entourant une telle traduction. De manière entrecoupée, Gide s’est impliqué pendant près de 20 ans sur cette traduction. Le fait qu’il n’ait pas abandonné ce projet, malgré les nombreuses embuches rencontrées, ne peut qu’éveiller la curiosité du lecteur pour cette fameuse pièce et lui donner envie de découvrir le résultat du travail et de la persévérance de l’écrivain, dont les qualités de traducteur ne sont plus à prouver.
[1] Sur les aléas de la traduction de Hamlet, voir P. Schnyder, « André Gide traducteur. Autour de Hamlet », in Martine Sagaert et Peter Schnyder (éds), André Gide. L’Écriture vive, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, « Horizons génétiques », 2008, p. 79-99.
[2] Interview à Candide, 16.08.1939
[3] André Gide, Ainsi soit-il, in Souvenirs et voyages, éd. de Pierre Masson,Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2001, p. 999-1000.