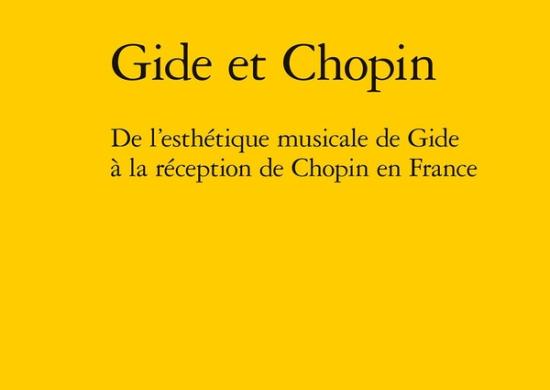Marco Longo et Vincenzo Mazza étaient présents le 3 octobre dernier dans le berceau historique de la Bibliothèque nationale de France, le site Richelieu, pour parler de leur travail sur le théâtre d’André Gide. Nous avons souhaité donner suite à cette rencontre entre le public, les deux auteurs et le directeur du département des Arts du spectacle de la BnF, Joël Huthwohl, par un entretien qui permette de mieux saisir les enjeux de cette recherche théâtrale.
Marco Longo est l’auteur de L’Écriture d’André Gide à la lumière de Luigi Pirandello. Vincenzo Mazza a édité le premier tome du Théâtre complet d’André Gide. Les deux volumes ont été publiés en 2024 chez les Classiques Garnier, dans la collection de la « Bibliothèque gidienne », soutenue par la Fondation Catherine Gide.

Ambre Philippe : Vincenzo Mazza, je vais commencer par vous, puisque vous vous attaquez à un travail qui s’inscrit dans la continuité, à la fois de celui d’un éditeur, Richard Heyd, qui entreprend entre 1947 et 1949 de publier l’intégralité des textes théâtraux de Gide chez Ides et Calendes (Lausanne), et de celui de l’universitaire Jean Claude, qui a proposé il y a 20 ans un bilan exhaustif des activités théâtrales de Gide[1]. Cette (ré)édition que vous êtes en train de construire et dont le premier tome vient de paraître, vous la nommez une véritable « entreprise éditoriale ». Pouvez-vous nous parler de ce travail d’historien du théâtre à partir de votre édition du Théâtre complet d’André Gide ?
Vincenzo Mazza : permettez-moi d’abord de vous remercier de me laisser parler en premier, alors que Marco Longo vient de publier une réflexion tirée de sa deuxième thèse de doctorat, portant sur les ponts et les points de contact entre deux continents, celui de Gide et celui de Pirandello. J’éprouve un grand plaisir à vous parler de ce projet. Il est né d’une idée de Peter Schnyder qui, après différents échanges au sujet des éditions possibles de plusieurs textes dramatiques de Gide, m’a soudainement proposé une sorte de version ultime de toutes les possibilités : éditer la totalité de son théâtre. J’ai alors fourni un projet qui tâchait de combler les manques des deux tomes de la Pléiade, Romans et récits, œuvres lyriques et dramatiques, publiés en 2009. Manques compréhensibles étant donné l’espace limité donné à l’édition complète des œuvres fictionnelles de Gide ! Manque qui a rendu possible et utile cette nouvelle édition, en même temps que le travail d’accompagnement de la Fondation Catherine Gide et le travail de Jean Claude nous ayant précédé, dans les deux tomes que vous avez évoqué, publiés il y a désormais trente-deux ans. Les notices des textes publiés dans la Pléiade et un lot impressionnant d’études m’ont fourni une base incontournable pour comprendre quelles étaient les directions et perspectives possibles pour essayer de prolonger la réflexion sur les rapports intenses et durables — on parle de plus de soixante-ans ! — de Gide avec les arts du spectacle.
L’idée est donc non seulement de combler l’écart entre les textes dramaturgiques de Gide, achevés ou non, publiés dans l’édition de la Pléiade en 2009, et celle de Richard Heyd entre 1947 et 1949, mais aussi de faire connaître tout ce que Gide a produit dans ce domaine et qui est finalement méconnu, comme la traduction de la pièce élisabéthaine Arden de Feversham, ayant à une certaine époque été attribuée à Shakespeare, et dont l’auteur reste inconnu. Mais également les traductions, comme celle, partielle, du Second Faust, et celle, intégrale, d’un fragment du Prométhée de l’auteur fétiche de Gide, Goethe. Pour ce Théâtre complet de Gide, j’ai choisi de respecter l’ordre chronologique des œuvres, en considérant les premières publications intégrales de ses textes dramatiques parus en revue ou en volume. Le premier tome, à la différence d’Ides et Calendes et de la Bibliothèque de la Pléiade, contient Amal ou la lettre du roi que Gide publia en 1922. Le deuxième tome concernera la traduction partielle du Second Faust, de Goethe, et celle d’Antoine et Cléopâtre qui est seulement dans l’édition de Richard Heyd. Le troisième tome prévoit la réédition de la traduction d’Hamlet et de l’adaptation du Procès de Kafka écrit avec Jean-Louis Barrault. Ces deux textes ont été publiés dans les années quarante, mais ne figurent pas dans la Pléiade. Ce sont deux projets vraiment désirés par Barrault, et qui engendreront les plus grands succès de Gide au théâtre. Le quatrième présentera pour la première fois dans une édition complète le fragment du Prométhée de Goethe, la traduction d’Arden de Feversham, publiée en version intégrale de manière posthume, mais également les notes préparatoires pour une pièce jamais commencée, Sylla. Voici pour ce qui est des textes dramatiques publiés partiellement ou inédits. Mais notre édition fournit également, au début de chaque tome, une chronologie théâtrale de la période abordée. Il s’agit de rappeler les événements majeurs des rapports entre Gide et le théâtre via leur chronologie, des déclarations des personnalités du monde de la scène, des extraits tirés de la presse de l’époque et des documents d’archives inédits ou méconnus (masse documentaire très importante, à commencer par celle liée à Gide et conservée par la Fondation Catherine Gide, la bibliothèque littéraire Jacques-Doucet et la BnF). Il est désormais beaucoup plus facile d’accéder aux archives de presse qu’il y a seulement une dizaine d’années, grâce à Gallica par exemple. C’est essentiel pour comprendre ce qu’il se passe à ce moment là entre Gide et le théâtre, relation rendue difficile par le manque de réel succès. Pour chaque texte dramatique, il est prévu une « Notice » qui veut, à la lumière de la littérature gidienne à jour ainsi que de la production récente en sciences humaines, raconter la genèse du texte, commenter les échanges avec celui qui est à chaque fois l’interlocuteur privilégié ou traducteur. J’essaie également de rendre compte de ce qui a lieu dans la presse au moment de la parution du texte, et, s’il y a eu un spectacle, de fournir une analyse de son histoire avec à l’appui les documents des fonds d’archive du monde théâtral. Une histoire des éditions du texte gidien est prise en compte dans la « Note pour l’établissement du texte », qui précède une « Bibliographie sélective » pour tâcher d’aller plus loin, et une section « La pièce à la scène » fournit un nombre important d’informations factuelles sur les productions de renom en France et en Europe tirés du texte dramatique en question.
AP : Marco Longo, vous avez choisi pour votre part d’aborder l’écriture de Gide sous un angle particulier, à travers la lecture de son quasi exact contemporain italien (et, comme vous, Sicilien), Luigi Pirandello, de deux ans son aîné. Quelle est la première question qui a motivé votre recherche, et la première réponse à laquelle elle a donné lieu ?
Marco Longo : Merci Ambre pour l’occasion de cet entretien qui permet de remettre en bon ordre toutes les idées que l’après-midi du 3 octobre Vincenzo et moi nous avons proposées au public présent dans la salle de la BNF, grâce aussi aux questions de Joël Huthwohl, Peter Schnyder, Robert Kopp et aux vôtres, et d’en laisser une trace pour l’avenir.
Il faudrait avant tout expliquer pourquoi ces deux auteurs. L’un est Français, lié à ma passion et à mon travail de spécialiste de littérature française et du théâtre de Gide, l’autre Sicilien, à qui me soude un lien atavique et ancestral, qui laissait clairement apercevoir, à un chercheur sicilien surtout, des ressemblances évidentes, des passages et des personnages gidiens qui avaient le goût ou l’arrière-goût de certaines atmosphères pirandelliennes, voire de certains raisonnements philosophiques que l’on retrouve dans les pages du Sicilien. Pour les démontrer, il a fallu émettre des hypothèses, car il n’existait aucune attestation ni d’une rencontre entre les deux auteurs, ni d’une fréquentation : toutefois, les deux prix Nobel ont eu des liens avec les mêmes artistes et hommes de lettres (Georges Pitoëff, Benjamin Crémieux, entre autres) et Pirandello, quant à lui, a passé une longue période à Paris entre les années 20 et 30. Au début je n’avais que deux indices : une copie d’Œdipe dans la bibliothèque privée de Pirandello dédicacée par Gide lui-même (« À Luigi Pirandello. En cordial et attentif hommage. André Gide ») et une référence assez positive à Gide dans une lettre de Pirandello à sa comédienne Marta Abba. Je me suis alors posé une série de questions : se peut-il qu’ils ne se soient jamais croisés ? Pourquoi dans leurs écrits privés ne se mentionnent-ils jamais ? Pourrait-on trouver d’autres pistes à suivre ? Une pléthore de questions, en fait. Au fur et à mesure que mes recherches avançaient, en retraçant tous les possibles liens en commun, en Italie, mais surtout à Paris, je percevais qu’ils s’étaient côtoyés, alors que rien ne le documentait. Du coup, un article en hommage à André Gide, publié un mois après sa mort, m’a donné la certitude que je ne m’étais pas trompé. L’auteur de cet article, Pasquale Marino Piazzolla, un journaliste et intellectuel italien qui avait vécu à Paris pendant les années 30, avait eu la possibilité de connaître de près André Gide et de lui demander des jugements personnels sur quelques-uns des auteurs italiens, dont Pirandello. Les mots de Gide rapportés dans l’article semblaient laisser entendre que les deux s’étaient connus ou du moins que Gide connaissait l’écriture pirandellienne. Mais la certitude est arrivée après : pendant la deuxième année de recherche et de travail, une lettre de Paola Masino, amie de Pirandello à Paris dans les années 20 et ensuite en Italie jusqu’à la mort du dramaturge sicilien, a confirmé que les deux auteurs se sont rencontrés, chez les Crémieux à un dîner en hommage à Pirandello en 1929, ce que d’autres indices indirects, dont le journal de l’abbé Meunier, ont validé. Voilà la première réponse, à laquelle je suis arrivé par une méthode d’enquête indiciaire – a-t-on dit – basée sur les détails, des éléments négligeables à première vue, des écarts, des données marginales, mais qui peuvent devenir révélateurs de l’intertexte Gide-Pirandello, comme le définit Wladimir Krysinski, qui s’apparente à celle qu’a théorisée Carlo Ginzburg, et qu’Umberto Eco a qualifiée d’abduction. En fait, en bon Sicilien, je me suis inspiré d’emblée – je l’avoue – des enquêtes du commissaire Montalbano, le héros d’Andrea Camilleri, dont je me suis occupé en tant que production littéraire traduite en France. Peut-être un autre modèle littéraire a-t-il influencé mon chemin : la recherche de Patrick Modiano dans les archives de la mémoire de Dora Bruder. Quoi qu’il en soit, il ne restait alors qu’à essayer de comprendre pourquoi toute relation entre les deux est passée sous silence.
AP : Dans nos sociétés de « réussites » et d’échelles, l’échec est de plus en plus reconnu comme essentiel… à la réussite. Je ne compte plus le nombre de témoignages sur la nécessité d’échouer, dans la lignée d’une très belle (et fameuse) suite de mots de Beckett dont voici la fin : « Essaie encore. Échoue encore. Échoue mieux. » Gide, en allant vers le théâtre, sait qu’il n’est pas « chez lui » : mais il sait aussi que vivre veut dire prendre des risques. Un enfant n’apprend à marcher qu’après avoir vécu un nombre de chutes incalculable. C’est donc le sens même de la vie que de faire et d’échouer, puis de réussir. Gide s’est-il arrêté trop tôt ? Peut-on dresser une petite philosophie de l’échec à partir du théâtre de Gide ?
VM : C’est une remarque excellente ! Si seulement Gide avait été sage, wise, comme disent les anglophones, comme vous l’êtes, Ambre. Je crois que Gide a essayé d’entrer dans le monde du théâtre par la porte principale en s’adressant à André Antoine avec sa première pièce, Saül, achevée en mai 1898, et pour utiliser une formule familière : « ça n’a pas marché ». Cela arrive après les premiers ouvrages de Gide qui restent encore aujourd’hui dans l’imaginaire collectif lié à cet immense écrivain, Paludes publié en 1895 et surtout Les Nourritures terrestres arrivé sur les étals des libraires en 1897. Cette déception aurait pu et, je dirais, aurait dû, créer l’attitude suggérée par la belle phrase de Beckett, mais elle a engendré, au contraire, une amertume et une méfiance envers le public surtout, qui ne l’a pas laissé travailler librement au long de sa carrière. Dans celle que l’on pourrait appeler « la troisième phase de sa carrière », Gide est très sollicité par des metteurs en scène de renom, et son écriture dramatique atteint enfin un public large, restant à l’affiche longtemps, dans des théâtres importants. Je me réfère à Jean-Louis Barrault, Jean Vilar et Jean Mayer, qui ont monté ses pièces, traductions ou adaptations, dans des théâtres comme la Comédie-Française, le Théâtre Marigny, les différents sièges du Théâtre national populaire et même au Festival d’Avignon. Et donc non, malheureusement, la philosophie beckettienne dans toutes les variantes possibles n’a pas été employée par Gide, mais cette phrase me permet de conclure en mentionnant une autre de mes passions, celle pour le tennis. C’est un excellent joueur suisse, non le plus célèbre, Roger Federer, mais Stan Wawrinka, qui s’est fait tatouer la phrase de Beckett en extenso et en a fait son modus operandi : « Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better. »
ML : À mon avis, le théâtre de Gide cherchait la nouveauté des thématiques et de la mise en scène dans un contexte qui n’était pas encore prêt à recevoir et apprécier de telles innovations. Le Paris du vaudeville et de la comédie légère de la fin du XIXe siècle n’avait ni le goût, ni la capacité de se passionner pour les tentatives symbolistes de Lugné-Poë, par exemple. Et c’est en effet à Lugné-Poë que Gide s’adresse pour la mise en scène de ce qui sera son premier « four » en 1901, Le Roi Candaule, surtout après qu’Antoine avait pratiquement éreinté la pièce à la première lecture. Et si l’on parcourt les années suivantes, on se rend compte que Gide a toujours fait confiance à des metteurs en scène novateurs, mais qui étaient marginaux par rapport au système de production théâtrale de l’époque : je pense à Pitoëff et à Copeau. C’est peut-être pour cette raison que, lorsqu’il revient à l’écriture théâtrale avec son Œdipe, en 1930-31, monté justement par la troupe de Georges et Ludmilla Pitoëff, il en offre un exemplaire à Luigi Pirandello qui avait été consacré en Italie et en Europe comme le dramaturge du changement. Et je rappelle que c’est grâce à Georges Pitoëff que Les Six personnages en quête d’auteur ont vu le jour à Paris. Il avait peut-être perdu trop de temps – mais il avait déjà produit deux de ses chefs-d’œuvre romanesques, Les Caves du Vatican et Les Faux-monnayeurs – et son théâtre était en retard, car il s’était imposé comme romancier et non pas comme dramaturge. L’échec lui avait servi à comprendre comment briller davantage.
AP : Vous m’aviez confié, Vincenzo Mazza, dans la cadre de votre résidence récente à la Fondation des Treilles[2], votre intérêt tout particulier pour « les fours ». Cela reviendrait à comprendre les mécanismes du succès, ce qui fait que deux contemporains côte à côte peuvent l’un, réussir, l’autre, échouer. Alors, question simple et compliquée : pourquoi Gide a-t-il raté ? À travers cette question j’aimerais aussi vous donner l’opportunité de répondre à trois des questions qui vous ont été posées lors de l’échange avec le public, le 3 octobre (elles viennent toutes de Peter Schnyder). D’abord, comment se fait-il que Gide se soit constamment adossé à des hypotextes, comme la Bible ou les mythes grecs (tout en les subvertissant) ? Ensuite, comment se fait-il qu’il n’ait pas tiré parti de l’expérience de l’écriture scénique de l’un de ses proches les plus importants, Paul Claudel ? Enfin, pourquoi n’a-t-il pas su tirer profit non plus de sa propre puissance critique ? (Il a été très lucide, comme en témoignent ses critiques littéraires, mais aussi théâtrales : lettres à Angèle, revues sur les Tisserands de Gerhart Hauptmann, sur le Repas du Lion de François de Curel, etc.).
VM : Merci de me rappeler ce séjour fabuleux aux Treilles ! J’en profite pour remercier la Fondation Catherine Gide et la Fondation des Treilles qui m’ont attribué le premier Prix des archives littéraires, qui me permet de travailler sur la correspondance entre deux autres fondateurs de la NRF, Jean Schlumberger et Jacques Copeau. Vous avez évoqué mon intérêt pour les fours : cela peut presque, formulé ainsi, passer pour une forme de perversion, et peut-être que ç’en est une !... mais je crois plus sérieusement que, dans mon travail d’historien du théâtre, une des tâches que je me suis imposée — après avoir absorbé les travaux des fondateurs des Annales, Marc Bloch et Lucien Lefebvre, et de leurs descendants et élèves, puis également influencé par les travaux de l’école italienne des historiens dont Carlo Ginzburg peut être considéré comme le chef de file de celle que l’on appelle la « micro-histoire » — est de décortiquer l’évidence. Cela veut dire aller vers le dépassement de l’idée, en transposant grossièrement les formules des historiens cités, car pour comprendre l’Histoire, la voie principale n’est pas d’étudier les vainqueurs des batailles et des guerres, et donc, dans les domaines des arts du spectacle, les succès. Alors, pour comprendre mieux un moment spécifique du théâtre, qui peut être un spectacle, une pièce de théâtre, ou une collaboration entre artistes, le résultat positif en termes de réponse du public n’est absolument pas le barème principal, il représente seulement une des données à analyser. Le but, avant d’approcher un objet d’étude, est de comprendre s’il s’agit d’un concentré d’éléments riches en possibilités d’analyse et s’il peut éclairer même seul un aspect d’un projet ou d’un moment de la carrière d’un artiste. Je tâche de vous donner un exemple concret. Gide, une fois Saül terminé, échange un nombre important de lettres avec Paul Valéry sur les qualités et les défauts de la pièce. Nous sommes en 1898, Saül a été monté pour la première fois en 1922 par Copeau et a été un « four noir », mais l’histoire de Saül est complexe et étudier seulement ce moment de la correspondance entre Gide et Valéry signifie, par exemple, mieux comprendre les idées de ces deux grands écrivains sur les mécanismes dramaturgiques. Il faut absolument contextualiser cela, car les idées de Gide sur la dramaturgie, quand Saül est monté au Théâtre du Vieux-Colombier en 1922, sont bien différentes, et sa dramaturgie a changé, de même que son écriture en général. Et c’est cette richesse que nous fournit un écrivain classique comme André Gide.
Pour répondre aux questions complexes posées par Peter Schnyder à l’occasion de la rencontre du 3 octobre à Richelieu, je suis obligé de généraliser en tâchant de synthétiser une production étendue comme celle de Gide. Disons que Gide, en utilisant des sujets bibliques et les grands mythes d’une partie de la culture occidentale, fait essentiellement deux choses : premièrement, il suit l’exemple des écrivains classiques qu’il apprécie particulièrement, comme Eschyle et Racine, par exemple ; deuxièmement, il veut se démarquer de la production contemporaine, celle qui a du succès entre la fin des années quatre-vingt du XIXe siècle et les années trente du XXe siècle. C’est-à-dire le théâtre de boulevard… on peut mentionner Edmond de Rostand, que Gide n’apprécie guère ? Mais il veut également se distinguer du théâtre symboliste qui vise et suggère souvent des mondes forts éloignés du quotidien pour faire rêver les spectateurs. Gide au contraire est très concret dans le développement des situations de ses personnages, leur affres sont très « humaines ». Mais le grand ennemi en termes de dramaturgie, c’est le théâtre naturaliste et de dénonciation sociale qui touche son apogée, en France, avec les deux périodes d’Antoine avec le Théâtre-Libre (1887-1894) et le Théâtre Antoine (1897-1906). Gide comme Camus, dont une des devises pour définir le théâtre est « Une histoire de grandeur animé par des corps », est contre ce qu’il appellera l’épisodisme dans sa deuxième conférence sur le théâtre, donnée à Bruxelles en 1904. Episodisme entendu comme la mise en place au théâtre de situations quotidiennes, communes. Gide plaide pour un théâtre où l’être humain est confronté à des situations dont l’éventuelle solution nécessite des capacités même inconnues aux personnages concernés.
La deuxième question est très difficile : je lance des hypothèses en partant d’une donnée solide et qui pourrait nous éclairer. Dans la correspondance entre Gide et Claudel, il n’est presque jamais question de théâtre ou de dramaturgie. C’est étonnant, mais c’est ainsi. Ensuite, il y a la question du catholicisme, qui forcément s’impose. Gide, qui en général n’a pas absorbé directement, ou suivi l’esthétique de ses contemporains, n’avait aucun désir d’écrire pour le théâtre en suivant un écrivain à tel point imprégné de sa foi religieuse qu’elle pouvait redéfinir l’ensemble de son rapport au monde (et donc aux arts). Il y a une autre différence qui est liée également au succès, qui est arrivé tard pour le théâtre de Claudel. Gide n’a jamais donné l’impression qu’écrire pour le théâtre était sa voie principale, tandis que pour Claudel, la poésie lyrique et la poésie dramatique ont été d’emblée les modes d’expression privilégiés. Sans craindre offusquer les spécialistes de Claudel, la production littéraire de Gide est largement plus variée que la sienne, de même que de la plupart de ses contemporains (de renom).

Pour répondre à la troisième question, il faut monter en puissance interprétative. Gide a envie de donner son avis et d’analyser la littérature dans ses différentes formes, toutes époques confondues. Le nombre de critiques ou d’annotation sur les textes lus est tellement large que l’on s’étonne si par exemple, il n’a pas parlé d’un écrivain espagnol. Je crois que Gide a travaillé pour produire des textes dans les genres les plus différents, mais que chaque section littéraire sur laquelle il se penchait était étanche par rapport à une autre. De plus, quasiment chaque production de texte ne naît pas d’un désir ou d’une volonté programmatique, mais d’un besoin soudain qui est souvent lié à des événements majeurs de sa vie professionnelle ou de sa vie privée. Pour finir, il ne faut pas oublier que la production dramatique de Gide a dû se confronter avec l’esprit du temps… qui manifestement n’était pas en phase. Mais si l’on imagine une production lui succédant comme celle de Marguerite Duras, et les personnages des pièces de Gide, joués comme l’ont été joués les premiers dans les mises en scène de Claude Régy, alors on pourrait même imaginer Gide comme dramaturge décalé avec son époque, aux prises avec nos contemporains.
ML : La Bible et le mythe grec sont sans aucun doute la « substantifique moelle » de la formation d’André Gide, l’héritage le plus profond de son père qui lui racontait ces histoires dans la bibliothèque de leur domicile rue de Tournon, dont l’accès était cependant interdit par sa mère. Il s’agit donc d’hypotextes à mi-chemin entre les deux figures parentales qui ont marqué la jeunesse de Gide et par là-même les choix de l’âge adulte aussi bien que son écriture, entre la liberté et l’interdit, entre l’innovation et la tradition. Ce n’est pas un hasard si Gide choisit des intrigues bibliques ou mythiques pour lancer son théâtre : je pense à Philoctète, Le Roi Candaule, Saül, Bethsabé, Le Retour de l’enfant prodigue, Œdipe. Ce choix lui a permis aussi de prendre parti dans le sillon du théâtre des mythes dont la littérature française du XXe siècle est riche. Se borne-t-il à la citation des sources telles quelles ? Non, bien sûr. Il intervient sur l’intrigue en subvertissant les personnages et les situations pour fléchir la tradition à sa pensée et à ses découvertes personnelles. Les résultats portent sur des mésententes, des critiques négatives, bref des « fours ». Seul Œdipe ne respecte pas ce schéma, mais cette pièce marque son retour au théâtre lorsqu’il s’est déjà affirmé comme romancier. C’est, à mon avis, cette volonté d’être un classique moderne qui a limité les possibles développements de son écriture dramatique. Gide s’est toujours tu sur les auteurs qui ont pu l’influencer. S’il avait en revanche accepté de bon gré des influences, son théâtre aurait jalonné l’histoire du théâtre moderne, car les nouveautés ne manquaient pas. De l’autre côté, les rapports avec Claudel sont surtout l’histoire des échanges et des disputes sur deux visions tout à fait différentes de l’homme et du catholicisme et des tentatives de Claudel de convertir Gide à sa vision religieuse. Le théâtre de Claudel reflète parfaitement cette vision et donc ne pouvait pas être un modèle pour Gide. Encore une fois le prix de la liberté intellectuelle lui coûte cher. L’activité de critique théâtral – mais je dirais plutôt d’une personne curieuse intéressée par cet art – ne fait qu’aiguiser sa perception du théâtre de son époque et du potentiel qu’un bouleversement du code théâtral aurait pu faire éclater. Pirandello, quant à lui, fut beaucoup plus courageux et, après avoir traversé des tempêtes difficiles avec le public, lors de la mise en scène des Six personnages en particulier, il sut s’imposer en Italie et en Europe. Toutefois, il faut le dire, ce courage avait été, du moins dans la première phase de sa production, soutenu par Mussolini. Après, les rapports avec le fascisme changeront et Pirandello lui aussi aura du mal à mettre en scène ses pièces, toutefois il avait déjà tracé le nouveau cours du théâtre européen et mondial du XXe siècle.
AP : Être historien du théâtre, et vous me direz si je me trompe, Vincenzo, c’est inscrire ce qui est voué à ne vivre que furtivement, sur des planches, dans la durée. Que voudriez-vous graver de la relation de Gide au monde des planches ?
VM : Tout ! Mon ambition est de restituer la plupart de moments où Gide a eu à faire avec les arts du spectacle, en tant que dramaturge, chroniqueur d’un événement spectaculaire, lecteur d’un texte lié au théâtre ou alors comme correspondant épistolaire parlant des arts de la scène. Et pourquoi ce désir ? Parce que rarement Gide n’a échangé ou engendré des réactions dans le panorama culturel de son époque.
AP : On sait que Gide, donc, n’a pas « réussi » au théâtre. Pourtant ses pièces ont été montées, nous en gardons des photographies bien vivantes (vous nous en avez montré quelques-unes), avec de grands acteurs. En quoi cette œuvre mal connue est-elle devenue pour vous le lieu d’un questionnement durable et foisonnant ?
VM : Je tâche de poursuivre ma réponse précédente, en disant que la chance de travailler sur Gide est celle de comprendre, à travers sa langue, l’esprit du temps, d’un temps long, car sa carrière a dépassé les soixante ans : trois générations. C’est une des possibles portes d’entrée pour comprendre une partie d’une culture vaste comme l’est la culture française. Moi, je peux le faire, dans la limite des mes compétences, via les arts du spectacles, car c’est le domaine où j’ai le plus d’instruments pour pouvoir tâcher de comprendre et de restituer le contenu d’un texte ou d’un spectacle. Il s’agit pour moi de combler les vides nombreux autour du rapport de Gide avec le théâtre, et de magiquement éclairer des moments de l’histoire, des histoires du théâtre, surtout français.
Dans la soirée qui a suivi la présentation de vos livres respectifs, je vous ai parlé d’un entretien entre un (immense) peintre, Jean Dubuffet, et (non moins immense) auteur et metteur en scène, Valère Novarina, ayant fait l’objet d’une « lecture-concert » par l’acteur Charles Berling et les musiciens d’Hifiklub. Vous m’avez alors demandé de quand dataient leurs échanges : il s’agit de lettres envoyées et reçues entre 1978 et 1985, plus précisément des lettres-pneumatiques (« il est agréable de savoir que Paris est parcouru de tuyaux où souffler entre amis », peut-on y lire). Si je vous reparle de cela, c’est pour dire qu’aujourd’hui, les lectures musicales rencontrent un grand succès. L’hypothèse selon laquelle Gide n’a pas eu de succès parce que ses textes pour le théâtre étaient trop « littéraires » n’est à mon avis pas la bonne, puisque si le théâtre de Gide n’a pas été joué, on a bel et bien joué, mis en scène, tourné, dansé, ses romans ! Entre autres : Les Nourritures terrestres (danse), Les Faux-monnayeurs (film) et La Symphonie pastorale (films et pièce de théâtre)… Qu’en penser ?
ML : Oui c’est vrai, le cinéma a eu plus d’intérêt pour les œuvres romanesques gidiennes que le théâtre n’en a pas eu pour les pièces du prix Nobel. D’ailleurs, Gide est surtout un auteur de nombreux récits et d’un grand roman dont les intrigues pouvaient bien être adaptées pour le septième art. Et Gide n’a pas manqué de s’intéresser au cinéma, mais ce nouvel engouement émanait d’un amour plus personnel : celui pour Marc Allégret. En général, le nombre d’adaptations cinématographiques ou chorégraphiques n’est pas supérieur à celui des mises en scène. C’est un théâtre élitaire que celui d’André Gide, mais il faut dire qu’il a été monté par des grands de la scène : Lugné-Poë, Copeau, Pitoëff, Barrault en France, Reinhardt en Allemagne, Cutrufelli et Pagliaro en Italie. Il s’agit de rares mises en scène, mais qui sont restées dans l’histoire du théâtre grâce aux metteurs en scène qui ont été reconnus comme des jalons de l’art scénique. Encore une fois, c’est le temps qui a donné raison à Gide, dont les choix étaient prématurés à l’époque ou on ne pouvaient pas donner de résultats immédiats.

AP : Pirandello a reçu le prix Nobel de littérature en 1934. 13 ans plus tard, en 1947, c’est le tour de Gide. Les deux ont une œuvre multiple (roman, poésie, théâtre…), mais celle de Pirandello est saluée pour avoir renouvelé de manière audacieuse et ingénieuse l’art du théâtre[3], tandis que Gide le reçoit pour la qualité et la variété de ses écrits, liés par leur sens du courage et de la vérité. Sur quels plans les deux auteurs se rejoignent-ils, se séparent-ils, comment les faites-vous se rencontrer et quelle « autre » ou nouvelle compréhension de leurs œuvres peut donner ce rapprochement entre ces deux géants de la littérature ?
ML : On peut bien affirmer que, paradoxalement, c’est dans le domaine du théâtre que ces deux prix Nobel ne se sont pas « rencontrés ». Cependant, il faudra des détails supplémentaires. Avant de s’imposer comme dramaturge grâce à Dullin et surtout à Pitoëff, Pirandello a été connu en France comme auteur humoristique dans des milieux que Gide fréquentait et par l’intervention d’amis communs, comme Crémieux et Mortier. C’est bien dans cette perspective que j’ai essayé d’analyser et de redéfinir l’ironie gidienne en termes d’humorisme, étant donné que quelques-uns des ouvrages « mineurs » (inachevés et/ou posthumes), tels que Ainsi soit-il ou Les jeux sont faits, L’Art bitraire, Le Grincheux et Conversation avec un Allemand, montraient une vision humoristique de la vie. C’est une élaboration gidienne, certes, mais qui, à notre avis, s’appuie sur l’essai sur l’Humorisme de1908 et le roman Feu Mathias Pascal de la même époque, mais aussi sur une série de nouvelles publiées dès les premières années du XXe siècle en France ainsi que sur les autres romans pirandelliens, On tourne et Un, personne et cent mille. Le premier mécanisme humoristique gidien coïncide avec la mise en abyme que Gide a empruntée à la peinture pour la transplanter et la rendre célèbre en littérature. Or, ce mécanisme de l’œuvre dans l’œuvre, comme de la pièce dans la pièce, m’a ensuite permis d’élargir l’analyse à toute la production gidienne, romanesque et théâtrale, aussi bien qu’aux traductions, adaptations, essais, préfaces, souvenirs de voyage. Cette analyse a été conduite à partir de certaines thématiques pirandelliennes telles que l’humorisme, le sentiment du contraire, le carnaval, les personnages en quête d’auteur, la chambre de torture, les hantises face au féminin, la bonne et la mauvaise foi, la famille, le mariage, la religion, le meurtre, le masque, la forme et le flux vital. D’ailleurs, l’ironie gidienne pourrait bien s’apparenter de l’humorisme pirandellien et, de plus, la sotie gidienne et la farce transcendantale que Pirandello emprunte à Friedrich Schlegel se rapprochent l’une de l’autre, tout en se touchant au moment où la vision de la réalité se développe sur deux plans apparemment contradictoires, mais qui en fait co-existent, celui du comique et celui du tragique (l’observation du contraire et le sentiment du contraire pirandellien). La décomposition de la mécanique humoristique par l’intermédiaire du petit démon de la réflexion — qui gêne les deux écrivains — est donc observation de la matière traitée et par conséquent réflexion sur cette observation et sur cette matière mêmes, niveau artistique et niveau critique qui se séparent pour mieux se scruter et s’analyser avec du recul. Seule la perception du tragique que le rire parfois camoufle insuffle ce sentiment critique que la mise en abyme gidienne et le métathéâtre pirandellien impliquent. Par le biais de cette clé de lecture, je me suis aperçu qu’il existe dans la production gidienne des personnages « éminemment pirandelliens » qui semblent suivre un fil rouge unique : Defouqueblize dans Les Caves du Vatican, Armand et surtout La Pérouse dans Les Faux-Monnayeurs, lié au thème de la folie grâce au personnage de Madame La Pérouse internée comme une folle, exactement comme la femme de Pirandello, qui, de manière de plus en plus générale, mettent en place la déstructuration du monde bourgeois et de ses principes et valeurs. Il y en a d’autres, comme Lafcadio, Michel et Mathias Pascal, qui sont frères meurtriers à l’affût d’une identité à tout prix, mais il y a aussi un Amédée Fleurissoire dont le voyage à Rome est diamétralement opposé à celui de Serafino Gubbio (le héros de On tourne) ou de Mathias Pascal, héros du plus célèbre Feu Mathias Pascal. Cependant, le domaine des personnages féminins n’est pas exempt de développements convergents qui proposent une hantise récurrente chez les deux auteurs, « l’homme entre deux femmes », relevant du thème biblique de Lazare entre ses deux sœurs, mais qui transforment au fur et à mesure les sœurs en mères, ou en général en femmes, dont la sainteté s’abîme en prostitution, en sacrifice irrationnel, en volonté suicidaire. L’exclusion-persécution d’Isabelle (héroïne éponyme gidienne) et de Marta (héroïne de L’Exclue) trouvera d’autres possibilités de réalisation dans le triptyque de L’École des femmes, Robert et Geneviève et dans les dernières héroïnes dramatiques de Pirandello. Il s’agit là de personnages en quête d’un auteur qui veuille les écouter et surtout les faire écouter en en publiant leurs confessions et en réalisant ainsi leur drame intérieur. De toute façon, si l’influence n’a pas été directe, bien des auteurs « médiateurs » qui relèvent du contexte historique et culturel et des lectures que les deux auteurs on partagées ont pu être le « pont » qui a relié l’imaginaire des deux prix Nobel dont, entre autres, Dante et Saint Bonaventure, Cervantès et Unamuno, Lasca et Chamisso, Shakespeare, Dostoïevski et Bourget, Maeterlinck, Crommelynck et le monde belge, Carlyle et le monde anglais, les philosophes allemands, Nordau, Séailles, Binet, Lombroso, Tarde, Durkheim, France et Bergson.
AP : Vous avez donc trouvé la trace d’une rencontre réelle entre Gide et Pirandello. Le rendez-vous pourtant est manqué, puisqu’il n’y aura aucune correspondance, pas même la plus petite mention de l’un ou l’autre dans leurs écrits. Avec quel autre homme (ou femme) de théâtre la rencontre a-t-elle eu vraiment lieu et débouché sur une collaboration, un échange, une réalisation ?
ML : Je me permets de vous corriger : le rendez-vous a eu lieu – et à mon avis il y en eut d’autres – mais il a été caché. Ils ont évité d’en parler, ou bien de parler l’un de l’autre. C’était une précaution, à mon avis. Un auteur dont le théâtre était soutenu et financé par Mussolini et qui avait publiquement adhéré au parti fasciste le lendemain du délit Matteotti ne pouvait pas être lié à un auteur comme Gide, sympathisant du communisme et homosexuel. Et vice-versa. D’ailleurs, l’histoire de la difficile pénétration de Gide dans les milieux intellectuels italiens des années 20 et 30 le démontre bien. De sa part, Pirandello, dont la diffusion en France est moins entravée, est présenté par Camille Mallarmé, femme de Paolo Orano, sénateur du parti fasciste, par le biais de Dullin. De plus, c’est Alfred Mortier qui fait connaître Pirandello dans le salon de Madame Aurel, sa femme. Dans le contexte de mon essai, les collaborations de Gide et de Pirandello avec des hommes de lettres ou de théâtre, qui étaient en même temps des amis communs, furent nombreuses (ce qui m’a convaincu d’une influence indirecte). Je peux en citer au moins deux : d’un côté, Benjamin Crémieux, collaborateur de La NRF, la revue de Gide, comme on l’appelait à l’époque, qui fut, après Camille Mallarmé, et avec sa femme Marie-Anne Comnène, le traducteur attitré de Pirandello en France. Le couple a traduit presque quarante drames pirandelliens et a offert un lieu familial sûr à Pirandello pendant les longs séjours parisiens de celui-ci. De l’autre côté, Georges Pitoëff, metteur en scène des Six personnages en quête d’auteur à Paris en 1923, mais aussi d’autres pièces pirandelliennes jusqu’à la dernière avant la mort de Pirandello : Ce soir, on improvise, montée en 1935 pour célébrer la remise du prix Nobel. Entre-temps, Crémieux avait collaboré avec Pitoëff et avec Pirandello pour la réalisation et la mise en scène en 1925 du scripte d’Henri IV en français. En 1930-31 au plus tard, Gide envoie cet exemplaire d’Œdipe dédicacé dont j’ai parlé au début. C’est la troupe des Pitoëff qui monte son Œdipe et le représente en tournée européenne avant d’arriver à Paris. À ce moment-là Pirandello, dont les rapports avec le fascisme n’étaient plus des meilleurs, avait rédigé et essayé de mettre en scène Ce soir, on improvise. Et là une autre découverte : le régisseur de Ce soir, on improvise s’appelle Hinkfuss, « pied claudiquant » en allemand, ce qui renvoie à l’étymologie du nom d’Œdipe. Au moment où la régie s’effrite, Hinkfuss élimine le dramaturge en commettant un parricide — en 1928, Freud venait de publier son Dostoïevski et le parricide — et pour cela il mérite d’être expulsé, comme il le sera à la fin de la pièce, de la salle de théâtre. Gide, qui connaissait assez bien l’allemand, comme Pirandello d’ailleurs, pourrait avoir saisi la citation en retrouvant un air de familiarité dans l’emploi de ce sous-texte mythique dont il s’empare pour le forger à ses propres intentions. Ce faisant, il accomplit les mêmes opérations que Pirandello impose à la matière antique. Car Gide actualise le mythe par le biais de l’humorisme, tout en provoquant des anachronismes et en faisant parler Œdipe comme un personnage moderne hors de la fiction, sans état civil, jugeant les actions et les choix de son auteur. Pirandello, pour sa part, fait disparaître le mythe derrière une narration mimétique bourgeoise qui ne contraste pas moins avec la nature apparemment réaliste de la matière. Voilà c’est peut-être une « rencontre » bien théâtrale que nous avons dénichée, et une espèce de message en code d’appréciation et de présentation de Gide à Pirandello.
AP : Gide et le théâtre, en une phrase, Vincenzo Mazza, cela donne quoi ?
VM : En une phrase c’est difficile, mais là où Gide me semble le plus efficace, c’est dans son ambition avérée de concilier le désir de faire un théâtre qui traite des grandes figures de la culture classique, tirés des textes de référence des époques antérieures, et de nous les proposer dans une perspective où sont mises en lumière leurs fragilités et leurs hésitations. Les héros, plus que les héroïnes, vu qu’il y en a moins dans le théâtre de Gide, sont des êtres vulnérables, ce qui aurait dû créer d’avantage d’attachement chez les spectateurs ou les lecteurs.
AP : Même question, Marco Longo, avec Pirandello ?
ML : Chez Gide cela donne sans aucun doute de belles intuitions et la volonté de se mettre à l’épreuve dans un terrain, celui du théâtre, qui, entre la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe, était un banc d’essai pour les dramaturges voulant se démêler de la tradition pour réfléchir sur le genre littéraire aussi bien que — ce qui à l’époque était une nouveauté —, sur ses mécanismes ou sur les rapports entre la vie et la scène. Ce n’est plus le dispositif du théâtre dans le théâtre des dramaturges baroques, c’est peut-être une relecture moderne du jeu hamlétique. Obsédé par ses personnages qui lui rendaient visite, disait-il, pour lui raconter leur drame inachevé sur la scène, Pirandello bouleverse les termes du jeu et le fait devenir une plongée dans l’âme humaine dominée par un esprit parfois en proie aux excès. « Pirandello et la folie » n’est pas seulement le titre d’un essai critique sur l’œuvre du Sicilien ou une des thématiques pirandelliennes, mais une donnée de sa vie privée avec laquelle il a dû cohabiter, à cause de la folie de sa femme.

AP : Je crois savoir que vous êtes, Marco Longo, parallèlement à votre métier de professeur, metteur en scène. Que pourrait-on faire aujourd’hui comme projet théâtral avec Gide ? Et d’ailleurs, et je pose la même question à Vincenzo Mazza, quels sont vos projets actuels et à venir ?
ML : C’est vrai, je travaille au théâtre depuis 25 ans, une profession parallèle à celle de professeur, aussi bien comme formateur que comme metteur en scène. L’année dernière, j’ai monté deux pièces de Pirandello dans un théâtre de ma ville. Quant à Gide, on pourrait bien le remettre en scène et le présenter au public moderne. Le Roi Candaule et Œdipe pourraient être deux beaux projets de mise en scène. On en a parlé à plusieurs reprises avec Vincenzo… On espère bien trouver les moyens pour réaliser au moins un de ces deux projets, en France ou en Italie.
VM : Je suis très superstitieux, et je crains de parler de projets qui sont à l’état d’ébauche, au risque de faire comme Gide quand il a écrit de superbes notes sur Sylla, pièce jamais commencée, ou comme pour Ajax, où la première scène du premier acte se trouve à jamais orpheline... Oui, sinon, le projet rêvé, mais confessé, c’est de monter Le Roi Candauleavec Marco Longo, préférablement en France. Difficile entreprise, d’autant plus que nous avons des idées sur la pièce, et je dirais heureusement, qui diffèrent, et que cela pourrait même donner de bons résultats. On verra.
AP : Enfin, comment va le monde de la scène aujourd’hui, en France et en Italie ? Que semble-t-il presser de nous raconter ?
ML : La scène d’aujourd’hui est parfois trop pressée de raconter l’immédiat et le morcelé, s’inspirant de l’actualité à la une et aussi des technologies modernes, tout en négligeant les grands textes théâtraux qui, dans leur complexité dramatique et philosophique, contenaient en germe toutes les réflexions éthiques, morales et esthétiques du présent et souvent de l’avenir. Cependant, il existe une autre perspective dans le théâtre actuel, même s’il s’agit d’une mode déjà dépassée : l’actualisation à tous niveaux (scènes, costumes, langage, situations) des textes de la tradition théâtrale. Là aussi, il faut savoir différencier un travail bien fait d’autres travaux qui souvent sont forcés par une mise en scène dominante et contraignante. Le metteur en scène a le droit d’ajouter son goût dans le montage et dans les indications sur le jeu des acteurs, sur les scènes et les costumes, mais l’idée et la vision dramatique de l’auteur devraient toujours l’emporter. Dans l’histoire de la régie moderne ce n’est souvent pas le cas. Personnellement, je vais au théâtre en triant bien les opportunités de passer une belle soirée qui puisse laisser une empreinte, une réflexion, un sourire.
VM : Comme je le répète aux étudiants, la vedette au théâtre est depuis les années soixante et depuis, de plus en plus évident, le/la metteur.e en scène ! Cela veut dire que le texte, et par conséquent les histoires au théâtre ont tout simplement moins d’importance par rapport aux générations et siècles précédents. C’est un théâtre qui parle beaucoup de l’actualité, ce n’est pas du tout une nouveauté au théâtre, bien au contraire, mais il le fait avec des possibilités techniques qui privilégient les effets sensoriels, donc auditifs et visuels. Cela est cohérent avec une société qui véhicule, ou mieux, bombarde ses messages avec les images. Sinon, je peux vous confesser que je voudrais aller davantage au théâtre et pouvoir me comparer à Raimondo Guarino, l’historien du théâtre qui m’a formé et qui a été formé à son tour par un ponte dans le domaine, Fabrizio Cruciani. L’exemple de Guarino est simple, il arrive à voir presque tout ce que se produit en Italie ou qui passe en Italie, en termes de productions spectaculaires, tout en poursuivant dans une production scientifique massive. Pour terminer sur le théâtre contemporain, je voudrais mentionner deux exemples lumineux, un Français, Le Théâtre du soleil d’Ariane Mnouchkine, et un autre dont le metteur en scène est italien, mais dont la carrière s’est épanouie à l’étranger, Eugenio Barba, avec l’Odin teatret. Les deux compagnies ont été fondées, coïncidence charmante je trouve, en 1964. J’adore leur production, car quand on assiste à un de leurs spectacles, on devient témoins de deux façons de s’inscrire dans l’histoire du théâtre, une histoire qui a trouvé, qui trouve et qui trouvera assurément le moyen d’échapper à l’éphémère propre du théâtre. Cela rappelle mon travail sur les rapports entre Gide et le théâtre : s’opposer aux risques propres liés à la nature du théâtre, l’éphémère.

[1] Jean Claude, André Gide et le théâtre, tome I et II, Paris, Gallimard, « Les Cahiers de la NRF », série « André gide », nos 15 et 16, 1992.
[2] Vincenzo Mazza est lauréat du Prix des Archives de la Fondation Catherine Gide et de la Fondation des Treilles en 2024, pour son projet d’édition de la Correspondance (inédite) entre Jean Schlumberger et Jacques Copeau.
[3] Pirandello reçoit le Nobel « for his bold and ingenious revival of dramatic and scenic art », et Gide, « for his comprehensive and artistically significant writings, in which human problems and conditions have been presented with a fearless love of truth and keen psychological insight ».