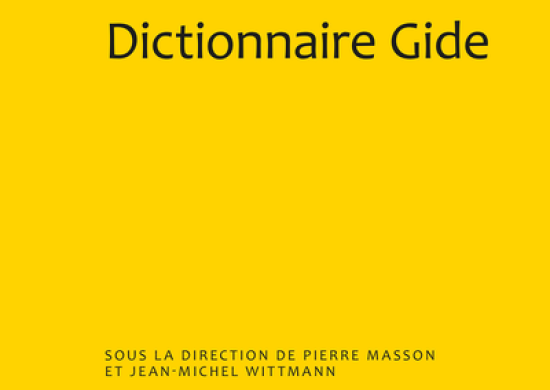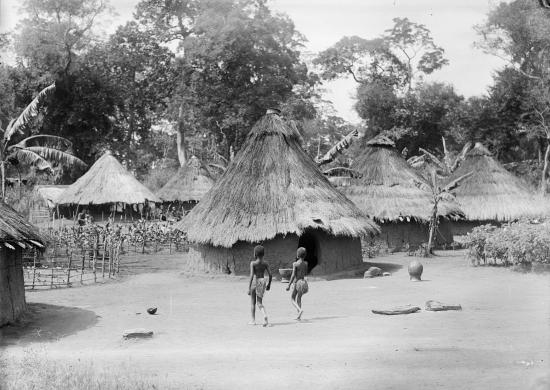La première mention d’un Philoctète apparaît dans la correspondance d’André Gide en 1893, soit peu de temps après sa propre découverte de la tragédie éponyme de Sophocle. À ce moment-là, la pièce bénéficie d’un premier sous-titre, comme d’autres textes de l’écrivain : « ou le Traité de l’immonde blessure ». Ce qui tend à la rattacher à d’autres œuvres de jeunesse du même genre, comme Le Traité du Narcisse (première publication en 1892), La Tentative amoureuse ou le Traité du vain désir (1893), et El Hadj ou le Traité du faux prophète (1896). Dans sa version finale, en 1899, ce sera Philoctète ou le Traité des trois morales. Et le texte paraîtra en volume au Mercure de France, suivi du Narcisse, de La Tentative amoureuse et d’El Hadj. On sait que l’écrivain Gide a passé sa vie à subvertir les genres littéraires traditionnels. Peut-être éprouvait-il le besoin, grâce à des sous-titres censés être plus « clairs », d’expliciter son œuvre, d’abord pour lui-même, puis à destination de son lecteur.
Gide, dans la formidable effervescence créatrice de sa première période (Les Cahiers d’André Walter, 1891, Le Voyage d’Urien, 1893, Paludes, 1895, Les Nourritures terrestres, 1897, L’Immoraliste, 1902, autant d’œuvres majeures), travaille simultanément à plusieurs livres, sur de longues durées parfois, en les reprenant à plusieurs reprises. C’est le cas pour Philoctète, commencé à La Brévine, en Suisse, à l’hiver 1894, achevé en 1898. Quelques fragments du texte seront prépubliés entre août et décembre 1897 dans l’éphémère Revue sentimentale de Gabriel Soulages, avant que l’ensemble ne paraisse dans La Revue blanche du 1er décembre 1898.
Ce qui explique, le directeur littéraire de la revue étant Léon Blum, ami de Gide, critique et écrivain avant de devenir l’homme politique que l’on sait, et La Revue blanche engagée à la pointe du combat pour la défense du capitaine Alfred Dreyfus, que nombre de commentateurs et de biographes (comme Ernst Robert Curtius, Louis Martin-Chauffier ou Alan Sheridan), estiment que Philoctète doit être lu et interprété en référence à l’affaire Dreyfus, dont la pièce est contemporaine, et pourrait en constituer une transposition. L’officier juif injustement déchu et reclus à l’île du Diable rappellerait le héros grec abandonné par Ulysse et les siens sur l’île de Lemnos, en raison d’une vilaine blessure au pied, « immonde » selon Gide, et parce que, se plaignant de ses souffrances, il démoralisait ses frères d’armes en route pour aller conquérir Troie.
Mais un oracle ayant prédit que, pour vaincre les Troyens, les Grecs auront besoin de l’arc et des flèches de Philoctète, présents de son compagnon Héraclès, ceux-ci envoient en mission, afin de les récupérer, Ulysse, l’homme « aux mille tours » d’Homère, accompagné de Néoptolème, le fils du défunt Achille, par qui Philoctète se laissera peut-être plus aisément fléchir parce qu’il ne le connaît pas.
Gide, dans sa pièce, brève quoiqu’en cinq actes, a conservé l’essentiel de la trame de Sophocle : la requête et la ruse d’Ulysse, qui charge le jeune et beau Néoptolème d’amadouer Philoctète et de lui verser une potion soporifique afin de s’emparer de ses armes ; le remords de l’éphèbe de se prêter à cette traîtrise, qu’il décide de révéler à sa victime ; l’acceptation de celle-ci, qui boit volontairement le somnifère et se laisse dépouiller. Mais chez Sophocle, Philoctète sera contraint par Héraclès de gagner Troie pour y combattre, tandis que chez Gide celui-ci demeurera à jamais sur son rocher, devenu un désert polaire, maudit.
Grand lecteur de l’Antiquité gréco-latine, admirateur de Sophocle à qui il reviendra plus tard, Gide a composé avec ce Philoctète la première pièce de théâtre de sa carrière, même s’il s’agit là plus d’une œuvre morale, d’un « traité » (à la façon des allégories du Moyen Âge), que d’un dispositif réellement dramatique et scénique. L’action est mince, les protagonistes apparaissent figés dans leurs tuniques et leurs cothurnes, débitant de longues tirades assez abstraites, comme si chacun était résigné au sort qui est le sien. Quant aux « trois morales » du sous-titre originel, cela supposerait que chacun des personnages ait la sienne, théorie qui peut être remise en question. Si l’on suit Gide, on ne voit guère quelle serait ici la morale d’Ulysse, mis à part le service absolu des intérêts de sa patrie, la Grèce, par n’importe quels moyens et dût-il mentir, tromper, tuer ou laisser mourir. Néoptolème, lui, digne fils de son père, n’a pu accomplir la tâche déshonorante que l’on attendait de lui, privilégiant sa morale personnelle au bien commun. Philoctète, pour sa part, a fait preuve d’intelligence, de générosité et d’esprit de sacrifice, mais en secret. C’est lui le vrai héros de cette pièce « en costumes », assez rhétorique, plus faite pour être lue que pour être représentée, en dépit de quelques belles mises en scène modernes.
Gide lui-même s’est montré parfaitement conscient des limites de cette première pièce. Dans un avertissement qui figure en tête des premières éditions, mais non repris dans le Théâtre complet, il confie : « Philoctète n’a pas été écrit pour le théâtre. C’est un traité de morale (…) » Et, dans une lettre de novembre 1904 à son traducteur allemand Franz Blei, il confirmera : « Cette pièce ne fut pas écrite pour la scène, où je crains fort qu’elle n’ennuie le public. » L’éditeur Richard Heyd, dans sa notice au volume I du Théâtre complet (1947), qui donne Saül avant Philoctète, précise que la pièce, n’a été jouée sur scène qu’une seule fois, en 1919. À sa reprise, en 1937, elle fut simplement lue par deux comédiens.
Si l’on devait cependant garder en mémoire une seule phrase de Philoctète, ce pourrait être celle-ci, à l’Acte I, quand Néoptolème, le novice, demande à Ulysse, l’homme mûr réputé pour sa sagesse, voire sa rouerie : « Mais quel est le devoir, Ulysse ? » Un moment d’émotion, de désarroi, passager. Néoptolème, on l’a vu, accomplira ce qu’il considère être son devoir, conformément aux valeurs que lui a inculquées son père défunt, le guerrier Achille : l’honneur avant tout. Ce qui requiert Gide, en plus de la morale, c’est cette relation, pédagogique au sens propre, entre éphèbe et adulte, telle qu’elle se pratiquait à Athènes, par exemple entre Socrate et ses disciples. Lui-même, toute sa vie, a justifié son attirance pour les jeunes gens par son désir de leur enseigner la vertu, la morale, de les guider sur les chemins de l’existence. Jusqu’à ce que l’élève s’affranchisse du maître. Qu’on se souvienne de l’Envoi des Nourritures terrestres (œuvre parue en 1897, quand Gide mûrissait Philoctète) : « Nathanaël, à présent, jette mon livre. Émancipe-t-en. » Et, plus loin : « Éduquer ! Qui donc éduquerais-je, que moi-même ? » Un mouvement de balancier si typiquement gidien, entre deux forces contraires en tension permanente dans sa pensée.
Gide puisera à nouveau, par la suite, l’essentiel de son inspiration théâtrale dans l’Antiquité biblique ou mythologique, mais il saura mieux s’affranchir de sa psychologie et de ses codes. Et son écriture ira s’assouplissant, au fur et à mesure qu’il intégrera les contraintes inhérentes à la dramaturgie.