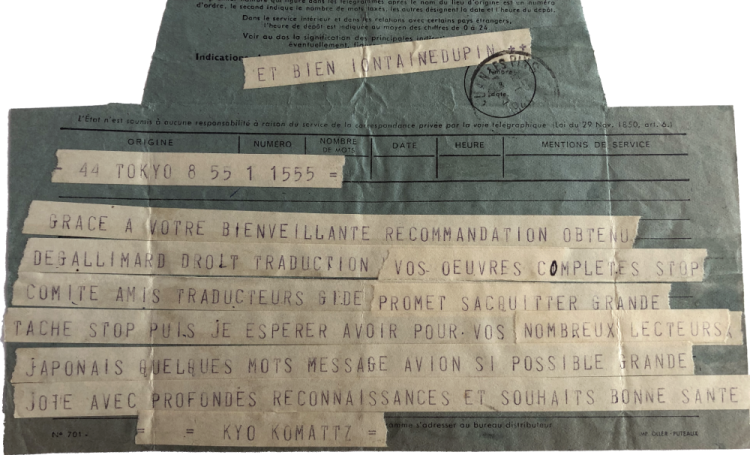L'article qui suit a été publié par Albert Londres dans L’Excelsior du 24 mars 1922. Il fait partie d'une série d'articles passionnants sur le Japon, réunis en 2010 par Arléa sous le titre Au Japon. Le journaliste français donne de l'histoire une version acérée, il raconte l'Histoire par des histoires qui à la fois nous attristent et nous font rire, en tout cas nous emportent. L'écriture de Londres est toujours belle, imagée, espiègle, et si nous reproduisons dans ce Carnet “Un peuple se réveille...” c'est parce qu'il nous aide à comprendre le Japon contemporain de Gide, les échanges entre l'écrivain et ses lecteurs, tout en nous interrogeant sur l'accueil que nous pouvons faire de ses “visions” — celle d'un Japon criminel par peur d'être envahi, celle d'un Japon attaquant la Corée et la Chine pour demeurer en paix, faire démonstration aux yeux du monde de sa puissance et ainsi siéger auprès des “grands”... puis se retrouvant à vivre avec son ombre comme Caïen...
*
« Le Japon va tomber sur l'Amérique. » Les champs de bataille de la vieille Europe étaient encore tout palpitants de la grande rencontre barbare que des hommes à la clairvoyance infatigable se passaient ce cri inspiré. Ce n'était pas une nouvelle de première main, mais la propagation d'un oracle ancien. Depuis longtemps les dieux des sciences politiques et morales, consultés par les bonzes des diplomaties, avaient en effet répondu, en termes ambigus comme il convenait : « Oui, un typhon guerrier s'élèvera bientôt sur une côte extrême. » Il s'agissait, bien entendu, de l'Extrême-Orient.
Le monstre qui devait le vomir s'appelait : le Japon. Parmi les puissances qui se partagent le monde, c'était la plus apocalyptique. Tout ce que l'on savait de ce pays, c'est qu'il faisait effectivement partie de ce qu'on appelle le système solaire, mais à part que l'on pouvait assurer qu'il était habité — et la preuve en est que la France y envoya plusieurs ambassadeurs : Gérard, Regnault, Bapt et, muses, saluez ! Claudel — on ne possédait pas beaucoup plus de lumière sur son compte que sur celui de la lune.
Comment ! Voici un pays, si petit, que lorsqu'on le cherchait sur les cartes, premièrement on ne le trouvait pas ; deuxièmement, quand on l'avait découvert, c'était pour s'écrier : « Quoi ! Ce ne sont que ces quatre petits points ? » et, troisièmement, pour s'apercevoir qu'à la proportion de l'échelle générale du monde son nom était plus long que sa superficie, puisque chacune de ses quatre îles était juste grande pour contenir une lettre de ce nom, si bien que, ce nom en comptant cinq, Japon, il y avait la dernière qui se trouvait en pleine mer.
Et, du coup, il y a de cela cinquante années, ce pays change d'avis. Il s'était librement retiré du monde. Des nations qui aiment la société lui font savoir que cela n'est pas bien. Elles le lui font savoir évidemment par la bouche de leurs canons. « All right », dit le Japon, qui commençait ainsi à parler l'anglais, « puisque vous désirez m'avoir dans vos salons, j'irai ».
Et, après trois siècles de réclusion farouche, il fit son entrée sous les lustres. Mais il était nu comme Saint Jean. Il se rendit compte que ce n'était pas correct et que pour pénétrer dans le monde il faut des redingotes, des habits noirs, de hauts chapeaux, bref : du linge. Mais la garde-robe d'une nation ne se compose pas comme celle d'un dandy. Pour elle, ses vêtements d'introduction s'appellent cuirassés, torpilleurs, canons, baïonnettes et autres accessoires innocents. Ayant accepté de rendre et de recevoir des visites, le Japon voulut être à la hauteur. Il dépêcha, sans tarder, des costumiers dans le vieux monde, puisque c'était là, paraît-il, qu'on coupait le mieux. Les missionnaires tailleurs revinrent dans leurs îles heureuses et dirent : « L'Angleterre est habillée de tant de vaisseaux, la France de tant de régiments, l'Allemagne, plus coquette, n'a jamais assez de l'un ni de l'autre. »
« C'est bien, dit le Japon, nous irons de pair. » Et il tailla en pleine étoffe, ce qui veut dire en plein acier.
A moins que l'on ne soit une digne mère de famille qui accompagne sa fille, quand on entre dans une salle de danse, c'est pour danser. C'est ce qu'en 1894, pour la première fois, fit le Japon. Ses habits étant prêts, il voulut les essayer. Il mit ses gants et fit poliment une invitation à la Chine. La Chine refusa. Alors il l'étrangla. « Eh ! dirent cette vieille Europe et cette jeune Amérique, vous allez un peu fort ! » Ils lui retirèrent la Chine des mains non sans demander à ce valseur un peu brusque de leur céder une partie de ce qu'il avait trouvé dans les poches de la victime.
« Compris ! dit le Japon, si on en use de la sorte avec moi, c'est sans doute que je ne suis pas assez bien habillé. » Il se remit à tailler dans le fer. Dix ans après, il se trouva justement que la Russie et le Japon tombèrent à la fois amoureux fous du pays du Matin calme, qui porte le joli petit nom de Corée. Le Japon se regarda et constata qu'il était vêtu à la dernière mode, que, par conséquent, il pouvait se présenter. La Russie ne voulut pas lui céder le pas. Le Japon l'éventra. Ce coup-ci, l'Europe et l'Amérique, prises de considération pour une personne si bien vêtue, ne dirent rien.
Le Japon avait percé le secret, qui fait que l'on est ou que l'on n'est pas respecté dans le monde. Il n'avait pas demandé à pénétrer dans ces milieux élégants. On l'y avait contraint. Il entendait être de la première et non de la seconde fournée. C'est alors qu'atteint de la frénésie de certaines dames en face des bijoux de leur rivale il dit : « Chaque fois que les nations, mes bien-aimées sœurs, ajouteront un cuirassé à leur collier, je ferai de même. » Et comme l'orgueil est souvent fille de l'émulation, il précisa : « Et un plus gros ! »
Il est à penser que si les nations, ses bien-aimées sœurs, avaient pu soupçonner les dispositions du Japon pour les parures, elles ne l'eussent pas si péremptoirement appelé dans le cercle de leurs relations. Aujourd'hui, elles ne peuvent rien miser que le Japon ne tienne l'enjeu. « Tant de dreadnoughts à tant de canons jumelés », criait-on de la Manche et de l'Atlantique. Et l'on entendait une voix qui, de l'autre côté du Pacifique, ripostait : « Banco ! »
A ce taux, la banque aurait fait le saut. C'est ce que, dans une sagesse empreinte d'actualité, entrevit l'un des gros pontes. « Arrêtons là, dit-il, ce vertigineux baccara. » Il proposa un endroit pour les palabres. Et ce fut Washington.
C'est à ce moment que votre serviteur, partant de ce principe que sur la terre il faut bien être quelque part et qu'autant vaut se trouver à l'est qu'à l'ouest, gravit un soir dans cette bonne chère ville de Marseille la coupée de la malle d'Extrême-Orient.
Et tout en voguant, il apprit beaucoup. Par exemple, que c'était le siècle du Pacifique qui commençait. L'Atlantique, la Méditerranée ! vieilles eaux fatiguées qui ne tarderaient guère à sentir la vase ! Tout juste si l'on y pourrait encore pêcher des grenouilles ! Quant au marché commercial, il fallait avoir du miel de nid d'hirondelles sous les paupières pour ne pas s'apercevoir qu'il n'en restait qu'un : la Chine, ce vieux citron de Chine qui, plus on le pressait, plus on avait de jus. Quatre cent mille Chinois, monsieur ! qui sont prêts à tout acheter et qui n'ont pas de pétrole !
Peut-être supposez-vous encore, vous qui êtes restés sur les rives anémiques de l'Occident, que le pétrole est une huile minérale ? Dès qu'on a touché Singapour, c'est un dieu. C'est le dieu des guerres futures et des paix lointaines. On pourra signer à Washington, à quatre ou à douze, tous les protocoles que vous voudrez. Il s'agira, paraît-il, de savoir ce qu'en pensaient les deux géants graisseux qui se nomment Standard Oil et Royal Dutch.
On vous prouvera d'ailleurs la chose en arrivant à Shanghai. On vous dira :
— Vous voyez ce fleuve sur lequel nous naviguons ?
— Oui.
— C'est le fleuve Jaune.
— Ah !
— Vous voyez sur ses bords ces deux immenses camps ?
— Oui.
— Là c'est la Standard ; là c'est la Royal.
— Bien.
— Vous voyez ces formidables tours de Babel en fer qui se regardent face à face ?
— Oui. Ce sont des réservoirs.
— Bien. Mais que croyez-vous que contiennent ces réservoirs ?
— Du pétrole.
— Du pétrole ! Non, monsieur ; des canons ! Et c'est par là que débutera la guerre.
Laissons ces plaisanteries profondes. Continuons notre voyage sur ces mers extrêmes et retenons la vision qui nous frappe. Dans ces eaux lointaines nous n'avions rencontré tout d'abord que des peuples éteints ou enchaînés ou protégés, En voici un de la même race, mais tandis que les autres sommeillent, lui est réveillé. Il promène fièrement, sur leurs côtes, la fumée de ses bateaux, comme un panache. Est-ce pour faire signe à ses frères de peau de se rallier à lui ? Est -ce là ce péril jaune, qui passe ? C'est le Japon !