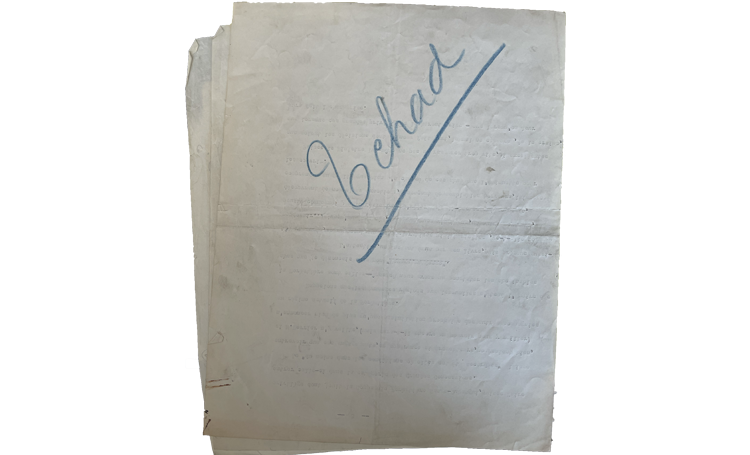André Gide et René Maran en 1925
Les deux écrivains
André Gide effectue son voyage au Congo de juillet 1925 à mai 1926. Né en 1869, il est alors âgé de 55 ans. Il est déjà l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages et de traductions1 — ses derniers ouvrages en date étant : L’Immoraliste (1923), Corydon (1924), Si le grain ne meurt (1924) et Les Faux Monnayeurs (1925) – texte qui paraît durant le voyage de Gide.
René Maran, né à la Martinique en 1887 de parents guyanais, a 38 ans. Fonctionnaire des Services civils2 de la colonisation, il a séjourné de la fin 1909 à 1920 en Oubangui-Chari, puis au Tchad3 de 1920 à 1923. Il est déjà l’auteur de recueils de poèmes (La Maison du bonheur, 1909 ; La Vie intérieure, 1912 ; Le Visage calme, 1922), d’un roman (Batouala) en 1921 qui obtint le Prix Goncourt le 14 décembre 19214 – récompense qui a déchaîné une vaste polémique en milieux littéraire et politique. En 1924, il publie Le Petit Roi de Chimérie, sous-titré conte5, qui dénonce sous forme imagée les erreurs commises pendant la Première Guerre mondiale. Et le 25 avril 1927, au moment même où Gide achève à La NRF la première publication en feuilleton du Voyage au Congo — et avant la parution du texte en livre6 (1928) — sort des presses Djouma, chien de brousse. Dans ce deuxième roman, René Maran dénonce longuement les exactions coloniales, alors que Batouala n’avait fait scandale que par sa préface.
1925 : le Congo s’achève pour Maran, débute pour Gide
Une démission
René Maran quitte le Tchad en mai 1923 par le Nigeria, une voie que le Gouverneur général de l’AEF de l’époque, Victor Augagneur, lui a refusée et qui le met dans l’illégalité. Ses démêlés avec l’Administration s’achèveront par sa démission le 3 novembre 1924, ratifié par un arrêté du 7 février 1925, soit 6 mois avant le départ de Gide pour le Congo.
Un procès
Il a dû faire face, en même temps, à un autre problème, celui du procès retentissant intenté par Blaise Diagne (1872-1934) contre lui et le journal Les Continents, à propos du recrutement des troupes noires pendant la Première Guerre mondiale. Un article anonyme (mais attribué à René Maran) accusait Blaise Diagne, Haut-Commissaire du gouvernement chargé en 1918 de recruter des troupes indigènes en Afrique, d’avoir perçu de l’argent par personne recrutée et d’avoir employé des moyens violents. Ce procès avait amené à la barre plusieurs généraux et ministres ; Clémenceau lui-même avait fait parvenir son témoignage par écrit. Le journal et René Maran furent condamnés le 2 décembre 1924 pour propos diffamatoires contre Blaise Diagne. Vu les personnalités concernées et la publicité faite à ce procès, Gide ne pouvait pas l’ignorer.
Un rêve
Pour Gide, ce voyage est, semble-t-il, l’accomplissement d’un rêve de ses vingt ans : « Ce n’est là qu’un projet de jeunesse réalisé dans l’âge mûr ». Quant à la mise en œuvre concrète, elle a subi quelques retards qui ont été déjà racontés ailleurs. Il peut y avoir aussi d’autres raisons7 : l’invitation de de Coppet, l’attachement à Marc Allégret et aux plaisirs sensuels, l’intérêt de son épouse pour les missions protestantes, le désir de la "vie primitive" selon ce que Gide lui-même a pu dire ou que les commentateurs ont suggéré.
René Maran suit le voyage de Gide
Chronologie 14 juillet 1925 – 15 octobre 1927
Date | Gide Voyage | Gide Articles | Maran Journal du peuple |
1925 | |||
14 juillet | Départ
Gide apprend le massacre de Boda et du ‘bal de Bambio’ (Pacha) |
|
|
|
|
| |
27 octobre
|
|
| |
26 décembre |
| N°47, allusion à Gide qui visite l’Afrique équatoriale | |
1926 | |||
|
Retour |
|
|
20 février |
| N°8, La loi d’amnistie et les Colonies. -Contre Antonetti et Lamblin, - L’administrateur homosexuel | |
13 mars |
| N°11, Randau, dans son livre L’Homme qui rit jaune homosexualité aux colonies | |
17 avril |
| N°15, L’AEF ou la colonie rouge. I-L’adminis-tration criminelle -Louard administrateur homosexuel, -le massacre de Boda rapporté par Gide -Enquête de Marchessou sur l’affaire de Boda, suite à la protestation de Gide à Alfassa | |
24 avril |
| N°16, L’AEF ou la colonie rouge. II La macchabétisation d’une race : le Chemin de fer Brazza-Océan | |
8 mai |
| N°18, L’AEF et la maladie du sommeil (III ?) La colonisation médicale | |
14 mai |
|
| |
1ernovembre |
| NRF n°158 : I |
|
1erdécembre |
| NRF n°159 : II |
|
1927 | |||
1erjanvier |
| NRF n°160 : Rafaï, Bangui, Nola |
|
15 janvier |
|
| N°2, L’AEF ou la colonie rouge. L’affaire Pacha |
1erfévrier |
| NRF n°161 : De Nola à Baboua |
|
19 février |
|
| N°7, Commentaires sur le Voyage au Congo (articles de la NRF) d’André Gide |
1er mars |
| NRF n°162 : De Baboua à Fort-Archambault |
|
1er avril |
| NRF 163 : Le Lac Tchad |
|
25 avril |
|
| Djouma, chien de brousse roman |
15 octobre |
| Revue de Paris : « La détresse de notre Afrique équatoriale » |
|
René Maran, par des correspondants et des informateurs, est au courant des étapes du voyage de Gide bien avant la parution en feuilleton, par ce dernier, du récit dans La NRF. En effet, il fait allusion à Gide qui « visite en tous sens l’Afrique équatoriale française », dans le no 47 du 26 décembre 1925 du Journal du peuple. Dans le même journal, il prend à partie Antonetti, gouverneur général de l’AEF, et Lamblin, lieutenant-gouverneur de l’Oubangui-Chari (no 8 du 20 février 1926) ; il salue la démarche de Gide qui a dénoncé aux autorités les abus à Boda et l’enquête administrative qu’il a provoquée : « seul un de ces empêcheurs de tourner en rond que sont les écrivains » est capable d’un tel courage (no 15 du 17 avril 1926). Ainsi, quand René Maran parle de ces graves événements, c’est donc sept mois avant que Gide ne les expose lui-même bien plus longuement et de manière très indignée à La NRF dans les numéros de décembre 1926, janvier et février 1927.
Gide, en effet, égrène son récit du 1er novembre 1926 (no 158) au 1er mars 1927 (no 163), à raison d’un épisode le premier de chaque mois (soit six en tout).
René Maran réagit aussi pendant la publication :
— d’abord, juste après le troisième numéro par un article « L’affaire Pacha » (no 2 du 15 janvier 1927), c’est-à-dire alors que le récit gidien n’en est encore qu’à la moitié ;
— ensuite, après le quatrième numéro, par ses « Commentaires sur le Voyage au Congo d’André Gide » (no 7 du 19 février) : il rappelle le texte de Gide du 1er février puis, pour prouver que l’administration a caché beaucoup de choses, il l’illustre par plusieurs faits cruels. Tout ce qui indigne Gide est bien peu quand on a vécu treize ans au "Congo" – ou plutôt en AEF, le terme "Congo" n’étant plus utilisé depuis longtemps.
On peut donc situer 1925-1926 comme le moment où ces deux écrivains se croisent sur les problèmes coloniaux. Ils ne contestent pas la colonisation en elle-même mais ses abus dont ils ont été soit seulement témoin sommaire (Gide), soit témoin durable et “victime administrative” (Maran).
On se propose de montrer (I) ce qui, de l’extérieur, les rapproche et (II) ce qui, de leur propre point de vue, les distingue. En dépit des différences réelles, on cherchera (III) des convergences dans d’autres domaines que ceux de la colonisation.
I/ Points de vue extérieurs
Dès la parution de Voyage au Congo, bien des contemporains ont relié les dénonciations de Gide à celle de Maran soit pour conforter leurs appréciations négatives des abus coloniaux, soit, au contraire, pour les condamner : l’un et l’autre étant jugés coupables de méconnaître l’effort colonial. En voici quelques illustrations.
1. Gide et Maran associés pour leur condamnation commune des abus
Ce rapprochement des deux écrivains semble aller de soi, en raison de leurs critiques des exactions coloniales.
En 1927
— Le 18 mars, à l’Assemblée nationale, le député communiste Marcel Cachin dénonce les exactions coloniales (portage, construction du chemin de fer Congo-Océan) et leurs conséquences sur la démographie de l’AEF. À l’appui de ses affirmations, il cite René Maran et Gide. Propos que reprend L’Humanité du 19 mars (« André Gide et René Maran nous ont décrit les violences que l’on fait subir aux noirs de l’Afrique. Votre civilisation ne mérite en rien ce mot ») ainsi que le 10 avril, Les Nouvelles8 (Alger).
— Le 21 mai, dans Le Journal du peuple, Jean Madelaigue souligne que la publication du nouveau roman de René Maran, Djouma chien de brousse, est confortée peu après par Voyage au Congo de Gide et par le livre Erreurs et brutalités coloniales de Victor Augagneur, ancien gouverneur général de Madagascar puis de l’AEF. Propos analogue dans Le Quotidien du 27 mai et Paris Midi du 1er juin.
- J. Ernest-Charles, dans Le Quotidien du 10 août, remarque qu’il s’agit de la rencontre de deux approches différentes : « Récemment, dans Djouma chien de brousse, René Maran décrivait cet esclavage avec une indignation concentrée et véhémente. André Gide, venu d’une autre atmosphère, se laisse soudain émouvoir et finalement la question essentielle dans ces régions immenses domine son livre tout entier ».
-Selon John Charpentier dans le Mercure de France du 1er septembre, les conclusions de Gide sont analogues à celle de René Maran.
En 1928 :
— Le 18 juillet, Les Nouvelles (Alger), qui a déjà interviewé André Gide et Marc Allégret, estime que la publication de Djouma, chien de brousse d’un « nègre de talent, M. René Maran, auteur fameux de Batouala » vient confirmer leurs propos. (Encore que la publication de René Maran soit légèrement antérieure à celle de Gide.)
En 1929 :
— Le 1er janvier, L’Universel (Mouvement pacifique chrétien) recommande la lecture sur la colonisation des livres suivants : Erreurs et brutalités coloniales de Victor Augagneur, Djouma, chien de brousse de René Maran, Voyage au Congo d’André Gide, Towards Nationhood in West Africa de Graft Johnson.
— Le 4 mars, dans Le Cri des peuples, Tiémoko Garan Kouyaté évoque le recrutement pour le Congo-Océan et la nécessité de recruter 23.250 travailleurs : « on conçoit aisément le drame qui se joue. Je n’y insiste point après MM. Félicien Challaye, René Maran, André Gide, Albert Londres, Robert Poulaine, etc. ».
— Dans le numéro de mars de L’Afrique française Henri Labouret fait un compte rendu de La Femme-Antilope de F. Valdi : « Après René Maran et Charles Gide (sic)9, M. F. Valdi, sans viser au scandale, mais avec une précision acquise par dix années d’observations journalières, informe une fois de plus le public français qu’il est grand temps d’administrer à l’Afrique équatoriale les remèdes exigés par son état. »
En 1930 :
— Le 7 juin Le Cri du jour défend Félicien Challey : « Il s’est toujours tenu sur le terrain objectif des faits et les enquêtes de Londres, de Gide, de Kessel au pays noir, les livres de René Maran lui ont donné lamentablement raison. »
On pourrait multiplier les exemples de ce genre10 qui réunissent René Maran, Gide et d’autres écrivains dans la dénonciation des abus coloniaux. Les articles et publications ultérieures de Denise Moran, Jean Dorsenne, Christiane Fournier aussi sont souvent cités comme leur confirmation11.
2. Maran et Gide associés parce que jugés ignorants de l’effort colonial.
— Une lectrice de La Femme de France, dans le no du 23 octobre 1927, critique Gide car « tel Maran, il n’a dépeint que les inhumanités qu’il a cru découvrir sans jamais parler des difficultés que rencontrent les coloniaux dans l’accomplissement de leurs tâches. Certains passages de son livre nous ont bien fait rire. Le blanc, un goujat, pillant le nègre martyr au regard lyrique et qui pleure sur l’épaule de Gide en lui faisant ses confidences ».
— L’écrivain et critique littéraire, Pierre Bécat, dans L’Avenir de la Touraine des 19 et 20 décembre 1927 ironise sur Gide : il voyage aux frais de la princesse, il est reçu par les administrateurs à la vie difficile mais dont il fait punir certains, il ne peine pas comme les Africains, il raconte son voyage pour se faire de l’argent. René Maran, de race noire, a montré ce que sont ces populations, bien qu’il parte aussi en guerre contre les Européens : « Je trouve tout naturel qu’un noir cultivé comme l’auteur de Batouala convoite les postes importants qu’ont les Européens dans un pays dont il est. Mais M. Gide, que veut-il ? »
— Le 28 février 1929, dans Les Annales coloniales, Eugène Devaux12 rend compte d’une conférence de Julien Maigret, qualifié « d’antigide de l’AEF » : il s’insurge contre Gide, Albert Londres (« un rigolo ») et Maran « noir des Antilles qui n’aime pas les noirs d’Afrique et dont Batouala est précédé d’une préface qui est un véritable soufflet pour les Blancs ».
3. Maran et Gide critiqués par une même personne qui ne les associe pas
On se rend compte que, parfois, une même personne a dénigré séparément les deux écrivains.
Edmond Jaloux (1878-1949)
Il a désapprouvé l’attribution du Prix Goncourt à René Maran (La Revue Hebdomadaire du 7 janvier 1922) et, plus tard, il prendra Gide à partie, sans pour autant le rapprocher de l’auteur de Batouala.
Paul Souday (1869-1929)
— René Maran a publié une "Lettre à Paul Souday" dans laquelle il écrit : « Il serait de votre devoir de reconnaître publiquement que vous avez eu tort de me malmener un peu trop vivement naguère puisqu’il est désormais prouvé que, loin d’avoir menti, je n’ai fait que dire une toute petite partie de cette vérité que les événements des Antilles et de la Guyane éclairent d’un jour singulier » (La Griffe du 1er octobre 1924). En 1921, Paul Souday lors du prix Goncourt préférait Chardonne à Maran.
— La querelle avec Gide est surtout littéraire, mais Paul Souday trouve bien inutile Le Voyage au Congo (Le Temps des 7 et 13 juillet 1927) et il avait critiqué ses mauvaises habitudes (Le Temps, 23 décembre 1926).
4. Gide mentionné, Maran oublié
— Si en son temps Le Populaire avait parlé à plusieurs reprises (1921, 1922) des démêlés occasionnées par Batouala, Léon Blum ne se réfère jamais à René Maran ni dans son compte-rendu d’Erreurs et brutalités coloniales de Victor Augagneur (où il cite Gide) ni dans la série d’articles qu’il publie en faveur de Voyage au Congo13 et contre les sociétés concessionnaires (les no des 1114 , 20, 25, 26, 27 juillet 1927) ; il ne mentionne jamais René Maran. Cet oubli est d’autant plus surprenant que le no du 15 mai 1927 informe de la participation de René Maran à un débat organisé par la Ligue des Droits de l’Homme sur les scandales coloniaux et particulièrement le régime des concessions.
— Le Mercure de France du 1er novembre 1927, place Gide dans le sillage pêle-mêle de Brazza, de Maistre, Crampel, Gentil15, Challaye, mais René Maran n’est pas cité.
— Dans les interventions qui sont faites à l’Assemblée nationale le 23 novembre 1927, on cite Félicien Challaye et Gide ; et le 14 juin 1929, on se réfère à Albert Londres, André Gide et Robert Poulaine.
— Lorsque Pierre Mille dans La Dépêche de Toulouse, le 8 octobre 1929, fait un compte-rendu de Voyage au Congo, il mentionne Félicien Challaye16 et l’affaire Gaud et Toqué, il se cite lui-même, mais ne parle pas de René Maran qu’il connaît bien et avec qui il a parfois polémiqué17.
II/ Points de vue intérieurs
Si René Maran et Gide dénoncent les exactions coloniales en Oubangui-Chari et au Tchad, ils ne vivent pas leur indignation sur le même mode et ne peuvent pas se sentir liés réellement dans leurs aspirations et conceptions personnelles. On lit souvent que Gide a rencontré René Maran « dont il cite les idées sans toutefois le mentionner ». Pourquoi ce silence ? Quelles idées de Maran cite-t-il ? De même, parler de « filière intertextuelle » entre les deux écrivains18 ou affirmer que Maran « était un disciple de Gide19 » paraît plutôt exagéré au vu de ce qui suit.
André Gide : Comment se situe-t-il lui-même dans la contestation des abus coloniaux ?
Au cours de son voyage, sa découverte personnelle
Gide part au Congo avec une mission ministérielle. En raison de sa notoriété et de la protection officielle, il est reçu par les autorités coloniales : Matteo Alfassa, intérimaire du gouverneur général ; Auguste Lamblin, le Gouverneur de l’Oubangui-Chari, qui met à sa disposition un véhicule ; l’ensemble des administrateurs des régions traversées.
À l’origine, la mission de Gide, accompagné du jeune Marc Allégret, paraît surtout touristique, un voyage de découverte suggéré par Marcel de Coppet rencontré chez Roger Martin du Gard — un périple comme il n’en avait jamais fait auparavant et qui va constituer un tournant dans sa carrière.
Gide n’est pas particulièrement préparé à son voyage. Mais après les révélations du chef Samba N’Goto le 27 octobre 1925, (relatant des faits du début septembre), Gide va changer de regard : « En acceptant la mission qui me fut confiée, je ne savais trop tout d’abord à quoi je m’engageais, quel pourrait être mon rôle et en quoi je serai utile. À présent je le sais et je commence à croire que je ne serai pas venu en vain ».
Gide est arrivé à Brazzaville le 14 août et à Bangui le 27 septembre. Il réalise que, pendant ces trois premiers mois, il était passé à côté de questions importantes, c’est pourquoi dans l’édition définitive de son livre il annote son propre texte. Ainsi, fin août, il avait assisté au procès de Henri Sambry, commis des services civils de 2e classe, et commente en note :
« Je ne pouvais prévoir que ces questions sociales, que je ne faisais qu’entrevoir, de nos rapports avec les indigènes, m’occuperaient bientôt jusqu’à devenir le principal intérêt de mon voyage et que je trouverais dans leur étude ma raison d’être dans ce pays. Ce qu’en face d’elles, je sentais alors, c’est surtout mon incompétence. Mais j’allais m’instruisant ».
Il découvre le travail forcé des femmes, les meurtres insensés, les otages, les punitions inhumaines, le portage… l’administration couvrant les sociétés commerciales puisqu’elle attend les revenus de l’impôt payé par tête d’habitants (impôt de capitation) et, à un autre degré, également par les sociétés. La collecte du caoutchouc naturel — et dans d’autres régions l’ivoire — étant au fondement de ce système à ce moment de la colonisation.
Après la découverte des exactions de l’administrateur Pacha (le ‘bal de Bambio’), quand il observe des choses qui le choquent, Gide en fait immédiatement part aux autorités administratives en qui il a confiance pour qu’elles interviennent et prennent des mesures.
Au moment de l’édition complète de son livre, se situer dans l’histoire coloniale
De retour en France, après la publication du récit de son voyage dans La NRF, puis après celles de Voyage au Congo puis de Retour du Tchad, Gide publie l’intégralité de son périple avec des notes, des annexes et des documents complémentaires : lettres, articles de presse (Le Populaire, La Revue de Paris), débats à la Chambre des députés. Il peut alors se situer lui-même dans le sillage de personnalités qui ont, avant lui, dénoncé les abus coloniaux en AEF : à commencer par l’administration elle-même (un rapport administratif de 1902, celui de Bobichon en 1904 et d’autres rédigés par Bruel, Thomasset., etc.) et Brazza21 appelé à réaliser une enquête (dont il dit à juste titre qu’elle n’a pas été publiée22) après l’affaire Gaud et Toqué23 (1903). Il cite également à plusieurs reprises L’Afrique centrale française (1907) d’Auguste Chevalier. Il se réfère aussi à une récente conférence d’Augagneur, ancien Gouverneur général de l’AEF. Il n’est donc pas le premier à dénoncer les méfaits coloniaux, dont il attribue la responsabilité majeure aux sociétés concessionnaires. Si certains administrateurs ont commis de graves fautes, comme Pacha dans la Lobaye, cela vient essentiellement des sociétés concessionnaires, ainsi qu’aux gardes indigènes, qui agissent, en dernier ressort, pour l’intérêt de ses sociétés, dont il faudra absolument supprimer les contrats.
Comment Gide envisage-t-il René Maran ?
Pour lui, c’est comme si René Maran n’existait pas puisqu’il n’en fait état nulle part. Il a pourtant traversé les lieux où René Maran a servi : Bangui, Grimari, Sibut, Crampel, Mobaye et Fort Archambault et ne pouvait pas méconnaître un écrivain qui obtint le Prix Goncourt pour un texte dont l’histoire se passe à Grimari.
Léautaud, qui échangea toute une correspondance avec Maran, rapporte, dans son Journal en date du 17 juin 1926, une conversation avec Gide juste au retour de son périple africain : « Je lui disais que René Maran s’est fait beaucoup d’ennemis en racontant certaines choses. Il m’a dit qu’il s’en fera certainement aussi beaucoup avec l’ouvrage qu’il se propose d’écrire ».
Une rencontre de Gide et de Maran a eu lieu quelques temps après : « Ce n’est pas André Gide, contrairement à une opinion admise, qui a signalé le premier comment on s’y prenait pour construire le chemin de fer Congo-Océan. C’est moi qui ai eu cet honneur. Se fondant sur les renseignements que je lui communiquai en septembre 1926 et sur deux chroniques solidement documentées que je fis paraître au Journal du Peuple, Voyage au Congo n’a été publié qu’en 1927 » déclare René Maran24 — le récit en feuilleton de Gide dans La NRF ne commence en effet qu’en novembre 1926, soit plusieurs semaines après.
Ces faits rendent encore plus étonnant le mutisme de Gide. L’écrivain Nimrod, dans une communication « René Maran – André Gide : un soupçon de proximité » (Continents Manuscrits, 17/2021) parle de conspiration du silence. On souhaite ici apporter des éléments complémentaires à son analyse.
René Maran : Comment se situe-t-il lui-même vis-à-vis de Gide ?
Pour répondre à cette question, il convient de distinguer les niveaux et les périodes.
Sous l’angle littéraire
René Maran, grand lecteur et passionné de littérature, connaît les livres de Gide. Ainsi, quand il est en Oubangui-Chari, à Grimari, il enjoint à son ami Charles Barrailley le 3 mars 1914 : « Lis Suarès, Gide, Montaigne, Saint-Evremont et La Bruyère. » Il cite Gide dans une autre lettre le 6 décembre 1917. Idem dans un article sur Suarès en 1914. Dans Le Journal du peuple : il évoque « Gide et les Gidards » (2 juin 1923), et le situe comme courriériste littéraire en même temps qu’André Suarès, Sainte-Beuve, Anatole France (1er août 1925), etc.
Après Voyage au Congo, René Maran continue d’être lecteur de Gide. Ainsi, dans Bec et Ongles du 21 novembre 1931, René Maran rend compte de Claire de Jacques Chardonne25 : « Le héros de Claire est un personnage essentiellement gidien, mais d’un imprégné de catholicisme. Il rappelle le Michel de l’Immoraliste. […] Claire est un lucide amalgame de Proust et de Gide… » Il n’a pas cessé, tout au long de sa carrière de critique littéraire, de reconnaître la valeur de celui qui allait recevoir le prix Nobel de littérature en 1947.
Sous l’angle de l’homosexualité et de la pédérastie26
Le début du XX° siècle est marqué, comme on sait, par une importante littérature de l’homosexualité masculine et féminine. Proust (Prix Goncourt 1919) aborde le thème dans Sodome et Gomorrhe (1921-1922) et surtout, Gide publie Corydon (1924). Or, Maran n’apprécie pas cette dimension homosexuelle, comme le prouvent les illustrations suivantes.
Dans le Journal du peuple
— Le 20 février 1926, René Maran écrit un article sur « La loi d’amnistie et les Colonies ». Il stigmatise fortement le Gouverneur général Antonetti « et son sous-verge, M. Lamblin, lieutenant-Gouverneur de l’Oubangui » qui n’appliquent pas la loi d’amnistie du 3 janvier 1925 à M. A. Symphorien, administrateur adjoint des colonies, d’origine antillaise, qui a fait chasser l’éléphant avant le 12 novembre 1924. Il poursuit, au sujet de Lamblin :
« En tout état de cause, il aurait dû plutôt réserver sa sévérité pour cet administrateur des colonies qui, de 1921 à fin 1923, n’a cessé d'engider les indigènes de la circonscription du Bas-M'Bornou27, et qui poussa même son amour de l'inversion28 jusqu’à confondre l’un des fils du sultan de Rafaï29 avec le bon petit dieu Ganymède, cher à Verlaine ».
— Le 17 avril 1926, René Maran revient longuement sur « l’affaire de l’administrateur Louard, dit "Louard inférieur", à cause de sa vive et bien curieuse intelligence. Or, on n’a daigné s’occuper des faits et gestes du chef de la circonscription du Bas-Mbomou, que dans le courant de l’année 1923. Le cas de ce fonctionnaire aux mœurs gidiennes relevait de la correctionnelle. Il était d’autant plus grave que, deux ou trois ans auparavant, un autre fonctionnaire, qui résidait à Bakouma-Dzako, subdivision ressortissant à la circonscription du Bas-Mbomou avait pu, au su de tout le monde, se livrer impunément aux mêmes déportements ». Le Gouverneur général, le gouverneur de l’Oubangui-Chari, la direction du personnel au ministère sont au courant. On a simplement demandé à Louard de prendre sa retraite30.
— Le 13 mars 1926, René Maran présente les personnages du dernier livre de Robert Randau, L’Homme qui rit jaune :
« Et ces ronds-de-cuir coloniaux qui peut-être, par amour de Proust, passent leur temps à s’engider ; et Mesdames Châtaigne (la femme du gouverneur) et Gléglent qui se mettent langue en bouche, pour parler comme Brantôme, et trouvent tant de charme et tant d’infinies délices à ce qu’il appelle la fricarelle. [...] Cette aristocratie de lupanar. »
— le 15 janvier 1927, René Maran revient sur « l’administrateur Louard, dit "Louard-inférieur", qui, pendant les deux ou trois années qu’il passa dans le Bas-Mbomou prenait joie et plaisir à enganyméder tous les négrillons, qui à leur insu et par la seule beauté de la plus charnue de leurs formes parvenaient à trouver ce que, par métonymie, on pourrait appeler le chemin de son cœur. En dépit du scandale, c’est tout juste si l’on crut inviter M. Louard à demander sa mise en retraite. […] C’est ainsi qu’avait accoutumé d’agir l’administrateur B31… à Bakouma-Dzako, trois années auparavant ».
Rabelais utilisait déjà le verbe “enganyméder” En 1924, la revue Europe (no 20 du 15 août) emploie “encorydonner”, certainement à cause du Corydon de Gide. L’Encyclopedia of Homosexuality définit “engider32” par “sodomiser” et précise que ce verbe a été « created by the novelist Louis-Ferdinand Celine from the name (Andre) Gide », idée qu’on retrouve ailleurs33, mais comme le premier roman de Céline Voyage au bout de la nuit date de 1932, on ne peut plus en fait lui en attribuer la paternité.
Dans les années 1924-1930, Gide a été l’objet de nombreux sarcasmes34. Ainsi, Pierre Bonardi, pour commenter le livre de Gide intitule son article : « Corydon en mission officielle » (Paris-Matinal, 7, 9 et 10 septembre 192735).
Toutefois, à partir du Voyage au Congo, Maran a abandonné ses allusions et ses commentaires sur l’homosexualité en référence à Gide. A-t-il assimilé sa situation personnelle à celle de Gide puisque tous deux ont ce sentiment de solitude que la différence (homosexualité pour l’un, race pour l’autre) engendre — eux qui veulent simplement être « pareils aux autres36 » mais que les autres rejettent ?
Sous l’angle colonial
Une secousse positive
René Maran éprouve une certaine satisfaction de la publication de Voyage au Congo, puisque cet ouvrage va dans le sens de son combat incessant mais avec une résonnance plus grande encore que Batouala, Djouma chien de brousse et ses multiples articles, conférences, débats, pétitions, etc. C’est pour cette raison que, lorsqu’il a publié l’édition définitive de Batouala en 1938 (des corrections et un chapitre en plus que le texte de 1921), il a complété ainsi sa première préface : « Je n’ai eu qu’en 1927 les satisfactions morales qu’on me devait. C’est cette année-là qu’André Gide a publié Voyage au Congo. Denise Moran faisait paraître Tchad peu après37. Et les Chambres étaient saisies des horreurs auxquelles donnaient lieu la construction de la voie ferrée Brazzaville-Océan ».
Une vision incomplète et faussée
Cependant, selon René Maran, dès le premier article incisif sur Pacha le 15 janvier 1927 dans Le Journal du peuple jusqu’à celui, plus édulcoré, qu’il publie dans Présence Africaine en 1949, André Gide a, malgré sa volonté, été manipulé par l’administration coloniale qui l’a empêché de voir la réalité. Certes, il a rédigé des lettres aux autorités et il a informé le grand public (articles de presse, livre) de ce qu’il avait vu et su. Mais ce n’était pas grand-chose par rapport à l’étendue des abus dont la responsabilité ne se cantonnait ni à des excès de tirailleurs et de quelques fonctionnaires ni aux seules sociétés concessionnaires. Il faut s’en prendre au fonctionnement du système dans sa totalité et notamment à l’impôt de capitation que devait chaque adulte (homme et femme) à la Colonie, et qui était payé par le truchement du caoutchouc et par les ressources naturelles locales. Gide n’a pas séjourné assez longtemps, il n’a pas pu enquêter suffisamment pour comprendre l’ampleur du problème. Il s’est aussi mépris sur l’impact de ses protestations auprès des haut responsables de la Colonie.
Des commentateurs38 ont, de leur côté, insisté sur la vision occidentale de Gide au sujet des populations qu’il rencontre, ce qui accentue le décalage avec la réalité. Au demeurant, le fait que René Maran, dont la culture est très française, soit noir, et qu’il ait vécu des situations de racisme, ne le situe pas pour autant dans le rang des Africains.
Les fonctionnaires rencontrés et nommés par Gide dans Voyage au Congo
Presque tous les fonctionnaires que Gide nomme dans son livre ont connu René Maran et ont même interféré avec lui, ce qui rend le silence de Gide encore « plus assourdissant ».
— Matheo Alfassa, l’intérim du Gouverneur général :
Lorsque René Maran a eu le Prix Goncourt et que la préface de Batouala avait créé des polémiques au sein du personnel administratif et parmi les colons, il avait rédigé une circulaire le 7 février 1922 pour dire que, d’une part, Maran n’avait cité aucun nom de fonctionnaire et qu’à ce titre il n’était pas redevable de la justice et que, d’autre part, il s’agissait d’une œuvre littéraire et non d’un rapport politique. De plus, il avait autorisé le 30 juin 1922 la promotion de René Maran au choix, comme Adjoint principal de 3e classe, ce qui avait déchaîné la presse coloniale. Le Gouverneur général, Victor Augagneur, avait même, à son retour de congé, désavoué39 les décisions d’Alfassa40.
Petit détail anecdotique : Gide a fait son voyage de Bordeaux au Congo avec Madame Alfassa.
— Auguste Lamblin :
Il sert à Bangui comme secrétaire général du gouvernement (1914), intérimaire du gouverneur (1917), gouverneur titulaire de 1919 à 1929. Gide ne tarit pas d’éloges sur lui. René Maran le déteste et en dit le plus grand mal, notamment parce qu’il avait refusé de prendre en compte ses plaintes en justice et qu’il l’a même sanctionné par un blâme en novembre 1918.
— Marcel de Coppet :
Il vient une première fois au Tchad en décembre 1920 jusqu’à mai 1923, d’abord à Fort-Archambault puis à Fort-Lamy au cabinet du gouverneur. René Maran part pour le Tchad, un peu après, le 2 février 1921 : agent spécial à Fort-Archambault jusqu’au 16 janvier 1922 puis chef de la subdivision de Koumra de janvier 1922 à son départ le 6 mai 1923 (un peu après de Coppet), par le Nigeria, contre l’avis du Gouverneur général. Ils sont donc tous deux au Tchad en même temps. De Coppet était sur place quand le Prix Goncourt a été attribué à René Maran et il a suivi les difficiles péripéties du départ41 de l’auteur de Batouala. Or, c’est en grande partie à l’invitation de Marcel de Coppet que Gide est venu au Congo. Ils ont donc forcément conversé sur René Maran42 !
— Prouteaux :
Administrateur de 1re classe venant d’AOF le 5 août 1924. Il est qualifié par René Maran, dans Le Journal du peuple du 25 juin 1927, de courtisan d’Antonetti : « M. Prouteaux, gouverneur par intérim de l’Oubangui-Chari, ce haut fonctionnaire qui dans le privé n’hésite pas à afficher la dilection qu’il témoigne à l’Action Française ». René Maran l’accuse d’affamer les travailleurs du Congo-Océan parce qu’il envoie des vivres aux « deux ou trois semaines après que ces derniers eussent quitté Bangui pour Brazzaville ».
La plupart des fonctionnaires affectés en Oubangui-Chari-Tchad, cités par Gide dans Voyage au Congo, ont dû connaître René Maran, si l’on se réfère à la date de leur première affectation :
En 1909, Félix Éboué. En 1910 l’année où René Maran entre en fonction : Jean Marchessou, Raymond Bouquet (titularisé en même temps que René Maran le 23 mars 1910) ; Lucien Thiébaut, Justin de Poyen-Bellisle (dont Gide retranscrit un rapport en appendice du chapitre VII) ; Paul Marcilhacy ; Fernand Labarbe (au Gabon). En 1911, Bergos, Bouvet. En 1912, Jules Staub. En 1914, Isambert, Augias. En 1915, Blaud, Pacha. En 1918, Pécaud, Sambry.
Pour ceux qui sont arrivés plus tard, il n’est pas sûr qu’ils aient connu personnellement René Maran : en 1920, Chambaud ; en 1921, Bossert, Cacavelli ; en 1922, Griveau, Morel.
— Les rares administrateurs, cités par Gide, pour qui René Maran a de l’estime sont :
Félix Éboué :
Gide le rencontre le 8 octobre 1925 à Bangassou, il le qualifie d’« homme remarquable et fort sympathique » ; il est l’auteur d’une petite grammaire sango43 « que je travaille depuis huit jours » dit-il. René Maran connaît Eboué depuis le Lycée à Bordeaux ; ils sont amis et plus tard, en 1957, il publiera Félix Éboué grand commis et loyal serviteur, 1885-1944 (Éditions Parisiennes). Éboué, nommé Gouverneur général de l’AEF par de Gaulle en novembre 1940, est le premier homme de couleur enterré au Panthéon en mai 1949.
Jean Marchessou :
Administrateur adjoint de 2ème classe en janvier 1910, il a été le premier chef de circonscription de René Maran en 1910-1911. C’est lui qui sera chargé de l’enquête sur Pacha. Il deviendra Gouverneur en 1931 au Gabon.
Blaud :
Il est arrivé en AEF en 1915, René Maran apprécie son comportement. En 1938, administrateur de 1re classe, il sera chef du département du Dar-Kouti.
Des parodies de justice
René Maran a beaucoup insisté sur la question de la justice coloniale étroitement dépendante du bon vouloir des autorités politiques, à commencer par le Gouverneur général qui décidait ou non de poursuivre des affaires en justice.
— Henri Sambry.
Gide assiste à son procès à Brazzavile les 24 et 25 août 1925 et éprouve une sorte de pitié à son égard : « Un malheureux administrateur envoyé trop jeune et sans instruction suffisante dans un poste trop reculé ». Il écope d’un an de prison avec sursis pour violences et voies de fait. Le 17 avril 1926, René Maran, qui connaît la justice locale, écrit : « On vient de le condamner à un an de prison avec sursis, ce qui revient à dire qu’il en méritait au moins cinq sans sursis » (Le Journal du peuple). Une décision complémentaire fut pourtant de le rétrograder d’un échelon. Mais il continua normalement sa carrière.
— Georges Pacha
Ce cas est intéressant et symptomatique de l’administration coloniale et d’une certaine naïveté de Gide. Suite à la lettre adressée par Gide au Gouverneur général par intérim le 6 novembre 1925, deux mois plus tard un arrêté en date du 4 janvier 1926 stipule que Pacha « est suspendu provisoirement de ses fonctions pendant la durée de l’enquête sur les faits qui lui sont reprochés ». Le 6 février, un mois plus tard, il est « affecté à Brazzaville pour servir au Bureau des finances. L’effet de la suspension de fonctions prononcée envers cet agent prendra fin pour compter du jour de la prise de fonction de son nouveau poste ». Il a donc suffi qu’il arrive à Brazzaville pour poursuivre sa carrière normalement ; cela correspond approximativement au moment où Gide était sur le Logone, le 20 février 1926. Pacha sera adjoint principal de classe exceptionnelle en 1940 et chef de cabinet du chef de territoire du Moyen-Congo. Mieux : en juillet 1944, il recevra la Médaille coloniale avec agrafe “Afrique française libre” ! — le premier sur la liste étant Félix Éboué…
— Raphaël Antonetti
La réalisation du chemin de fer Congo-Océan suscita une levée de protestations dans la presse et à la Chambre au sujet du traitement scandaleux des travailleurs qui moururent par milliers. Gide, comme Maran, Albert Londres et d’autres, fait partie des indignés. Lorsqu’il est avec Marcel de Coppet la question est posée : ce dernier (qui recruta des troupes noires au Sénégal pour la Première guerre mondiale) dut recruter au Tchad des Saras pour le chemin de fer, sur ordre de son chef, et se demandait s’il allait continuer… Une mission d’enquête fut créée, Antonetti convoqué à Paris, puis tout reprit son cours à peu près comme avant…
— Sociétés concessionnaires
Beaucoup de ces sociétés étaient déjà dissoutes ou en voie de dépérissement leur rentabilité s’épuisant, d’autant que le cours du caoutchouc s’affaissa. L’administration, elle-même, s’impatientait et la Chambre des députés en fit l’objet de débats (23 novembre 1927, 14 juin 1929). Elles finirent par disparaître. Gide a peut-être contribué, par sa notoriété, à accentuer un mouvement déjà en place auprès des responsables et de l’opinion publique.
Un soulèvement presque prévisible
Les conditions cruelles auxquelles les populations étaient soumises — dénoncées par les uns et les autres — conduisirent à un vaste soulèvement de trois ans, de 1928 à 1931, dans tout l’Ouest de l’Oubangui-Chari, le plus grand de l’histoire de l’AEF. On l’appelle communément “la guerre du Kongo-Wara”. Elle obligea à amener des troupes des autres colonies, à créer une escadre aérienne à Bangui et à prendre toutes sortes de mesure à l’égard des populations “rebelles”, mais aussi à faire des concessions sur la question du travail — d’autant que l’ampleur de la contestation44 attira l’attention sur la France.
Le Tchad
La deuxième parie du Voyage au Congo est constituée par Le Retour du Tchad (de février à mars 1926, la suite concerne le Cameroun) ; Gide informe des différentes événements au cours des étapes successives. René Maran, qui a passé près de trois ans à Fort-Archambault et Koumra a publié en 1931 Le Tchad de sable et d’or. Ce texte, très personnel, puisque, pour une fois il est à la première personne, est poétique. Il décrit les lieux, la remontée du fleuve en baleinière, la vie en brousse, l’histoire de la pénétration coloniale, les croyances et le mode de vie sara, le départ par le Nigeria. L’attention à l’histoire des populations vient très probablement d’une monographie qu’il a rédigée quand il était chef de la subdivision de Koumra. Pour lui, c’est la seule fois dans sa carrière où il s’est senti utile puisqu’il avait à diriger : « Pour la première fois de ma vie, je vis, j’agis, je sers à quelque chose », puisqu’il a enfin une responsabilité — qui fait d’ailleurs penser à Gide quand il découvre qu’il a enfin une vraie mission. Le livre, écrit dix-huit ans après son départ définitif, gomme cependant toutes les graves péripéties administratives de son départ.
Il y aurait donc lieu d’entreprendre une comparaison rigoureuse entre les deux textes, ce qui ne peut être réalisé ici.
Parenthèse sur les danses Dakpa
Le 14 octobre 1925 à Bambari, Gide assiste à la danse de vingt-huit petits danseurs dakpas. Il ajoute en note :
« C’est elle que l’on peut voir, admirablement présentée, dans le film de la mission Citroën. Mais les membres de la mission ont-ils pu croire vraiment qu’ils assistaient à une mystérieuse et très rare cérémonie. Danse de la circoncision nous dit l’écran45. »
Gide remarque, à juste titre que cette danse est devenue un spectacle sur demande des autorités pour les étrangers de passage. La mission a traversé l’Afrique de Colomb-Béchar à Madagascar, d’octobre 1924 à juin 1925, avec d’ailleurs de belles scènes en Oubangui-Chari et au Tchad. Le film s’intitule La Croisière noire, il a été présenté pour la première fois le 2 mars 1926 à l’Opéra de Paris — un peu avant le retour de Gide — puis diffusé dans toute l’Europe. Gide ignore-t-il que le réalisateur était Léon Poirier, qui avait lu Batouala et voulait absolument filmer la cérémonie du ganza46 ? Il avait demandé au gouverneur Lamblin de l’aider à faire refaire cette danse décrite par René Maran dans son roman. Ce que Gide a vu doit être aussi une danse spectacle sur commande. Mais, le cas est identique pour la plupart des scènes filmées par Marc Allégret dans Voyage au Congo, présenté le 10 juin 1927 : ce sont aussi des mises en scène, de même d’ailleurs que les photos qui évitent tous les problèmes sociaux dénoncés dans le livre47. Ajoutons que la mission Citroën avait avec elle un peintre de qualité, Alexandre Iacovleff (1887-1938), qui a illustré une très belle édition de luxe de Batouala aux Éditions Mornay le 12 juillet 1928.
III /« Mais déjà André Gide a donné la parole à René Maran…»
Idéologiquement de gauche
L’Association Internationale des écrivains pour la défense de la culture, fondée en juin, a tenu ses assises à la Mutualité le 4 novembre 1935 à Paris. La séance était présidée par Gide, qui a rendu hommage à Henri Barbusse (Prix Goncourt 1916) décédé deux mois plus tôt, le 30 août. Puis ont pris successivement la parole : Jean-Richard Bloch, René Maran, Jef Last (écrivain hollandais, ami de Gide), Julien Benda, Jean Cassou, Alain, Jean Guéhénno, Aragon, André Malraux (Prix Goncourt, 1933), A. Chamson... Le journal Vendredi (no 1, du 8 novembre 1935) qui en rend compte indique ce moment où : « André Gide a donné la parole à René Maran ». L’Humanité du 5 novembre commente :
« René Maran, le grand écrivain de race noire, déplore que la France pratique une politique coloniale aussi absurde que la France de l’Ancien régime, par manque de franchise et de foi républicaine. Elle n’a pas su par une politique généreuse s’attacher les populations de couleur ; elle a renoncé à sa mission ; elle donne dans le racisme. M. Laval ne veut pas qu’on diffuse l’enseignement dans les colonies. »
Ainsi, les deux auteurs se retrouvent publiquement pour des idéaux généraux communs.
La dénonciation des injustices sociales à l’époque coïncidait aisément avec l’adhésion au communisme, ce qui fut le cas de Gide, jusqu’à la publication du Retour de l’URSS en novembre 1936, qui marqua sa rupture avec l’idéologie marxiste. René Maran, même s’il publia dans des revues marxistes ou proches, n’adhéra jamais au Parti communiste et n’eut donc pas à connaître la désillusion de Gide. Il eut toujours une appréhension à l’égard des partis politiques et des associations, sauf littéraires.
Du côté de la littérature
À la lecture du Voyage au Congo, certains lecteurs sont surpris de voir Gide commenter Bossuet48, Goethe, Shakespeare, divers auteurs du XVIIe siècle et des écrivains plus contemporains, comme Conrad49 à qui le livre est dédié. Quand on lit la correspondance de René Maran, on constate qu’en Oubangui-Chari, il écrit un essai sur Mathurin Régnier (1573-1613) et qu’il prépare, parmi d’autres, un livre Le Petit Roi de Chimérie truffé d’allusions à la littérature du Moyen-Âge. Il suit l’actualité littéraire et la commente et fait part de ses préférences littéraires et philosophique (Marc Aurèle). Il consacre, depuis son enfance solitaire à Bordeaux, son temps à lire et à écrire où qu’il soit. Après avoir quitté la carrière coloniale, il vivra de sa plume, particulièrement comme critique littéraire, d’où ses innombrables lectures et des centaines de comptes-rendus.
On pourrait faire un inventaire commun des nombreux auteurs que l’un et l’autre admirent : Tagore traduit en français par Gide est cité dans la préface de Batouala par René Maran, et ils partagent le même goût pour bien des poètes et des romanciers.
L’écriture de la nature et des animaux les rapproche aussi. Si Gide a publié50 une petite plaquette (1927) sur Dindiki, le périodictique Potto qu’il avait adopté pendant son voyage et qui mourut malgré ses soins, René Maran a publié de nombreux ouvrages dont les animaux sont les personnages principaux : Djouma Chien de brousse (1927), Bêtes de la brousse (1941), Mbala l’éléphant (1943), Bacouya le cynocéphale (1953).
Les deux auteurs sont des poètes51 : qu’en est-il de leurs poésies respectives ? Les deux auteurs sont romanciers52 : qu’en est-il de leurs romans respectifs ? Les deux auteurs ont entretenu des correspondances importantes : que peut-on en dire ? Les deux auteurs ont connu le poids de la différence (sexuelle pour l’un, raciale pour l’autre) et la solitude qui en découle53. C’est probablement l’aspect qui, en définitive, les rapproche le plus.
C’est donc dans une perspective plus littéraire et intime qu’il faudrait aussi envisager les rapports entre ces deux auteurs.
[1] On citera : en1918, Typhon de Conrad, (auteur d’Au cœur des ténèbres paru en français en 1924 dont l’action se déroule au Congo ‘belge’ encore propriété personnelle de Léopold II) et, en 1921, L’Offrande lyrique de Tagore, auteur cher à René Maran.
[2] À ce titre, il dépend du Gouverneur général et non du ministre des Colonies.
[3] De 1906 à 1920, l’Oubangui-Chari et le Tchad forment une seule entité administrative. De 1920 à 1934, ils sont séparés puis à nouveau réunis de 1934 à 1937 pour être encore séparés à partir de 1937.
[4] Le 24 décembre, au Vieux-Colombier, André Gide participe à la célébration du centenaire de Dostoievsky.
[5] Maran a parlé aussi de légende symbolique : « J’y parlerai de la guerre et de la civilisation » (Lettre à Barrailley du 6-12-1918).
[6] Voyage au Congo suivi de Retour du Tchad, illustré de 64 photographies inédites de Marc Allégret, Gallimard, 1928
[7] Évoqué par Franck Lestringant dans « 1925. Le Voyage au Congo d’André Gide » France Inter, 14 mai 1917 ; par Anny Wynchank (Bulletin des Amis d’André Gide, janvier 1994, n°101).
[8] Ce journal avait publié : le 21 février un article sur le voyage de Gide, le 13 juillet un interview avec Allegret, le 16 septembre un autre article.
[9] Confusion de prénoms : Charles Gide est l’oncle d’André Gide.
[10] Bulletin de la société de géographie de Toulouse 1er janvier 1930 ; L’Esprit français du 12 juillet 1931 ; L’Éveil de l’AEF du 19 novembre 1932 ; La Gazette de Bayonne 7 mars 1933 ; L’Effort du 23 avril 1937… Il arrive cependant que les deux écrivains soient cités sur un mode différent : ainsi, le Lieutenant-colonel Burthe d’Annelet dans son livre Du Cameroun à Alger (1932), mentionne Gide quand il passe à Boda mais dit le plus grand mal de Maran quand il passe à Bambari.
[11] Voir par exemple Bec et Ongles des 24 septembre et 15 octobre 1932 (journal où Maran tenait plusieurs rubriques).
[12] Il critiqua à plusieurs reprises René Maran, dans le même journal (dont il a été le gérant et un des rédacteurs) : ainsi en 1922 les 31 janvier, 16 et février, 31 juillet et 24 août ; en 1924, le 31 juillet…
[13] La publicité pour Voyage au Congo est une phrase de Léon Blum « Gide est un homme qui sait voir et que rien n’arrête dans l’expression de ce qu’il a vu » (Le Populaire du 8 juillet 1927).
[14] L. Blum reproduit une lettre de Gide qui fait l’éloge de Lamblin et réprouve le recrutement pour le chemin de fer Congo-Océan. Il s’appuie sur l’avis de « l’administrateur C… (de Fort-Archambault) qui pense qu’on a trompé les indigènes recrutés : « cet abus de leur confiance est moralement inadmissible » ; raison pour laquelle il a écrit à son chef : « Ce recrutement encore a été possible, je ne réponds plus du suivant ». Il s’agit à l’évidence de Marcel de Coppet.
[15] En réalité, Brazza s’est fortement opposé à Gentil.
[16] Félicien Challaye, qui fut le secrétaire de Brazza assiste, avec Lamblin, à la première présentation du film Voyage au Congo le 19 mars 1927 chez Mme de Lestrange (Yvonne de Trévise). Gide avait lu Challaye mais ne le mentionne guère. (cf. Durosay « Image et imaginaire », BAAG n°80, octobre 1988). Challaye avait pris la défense de René Maran en 1922 et participera à de nombreuses conférences avec lui.
[17] Le Journal du peuple « Lettre à Pierre Mille » (25 octobre 1924), « …le Pierre Mille de la bonne époque, dont l’opportunisme colonialo-littéraire brille présentement d’un si vif éclat à La Dépêche coloniale » (19 mars 1927).
[18] Kathleen Gyssels « Liaisons dangereuses : relire Maran après les fastes du Centenaire de Batouala », Études Caribéennes décembre 1921.
[19] Boniface Mongo-Mboussa « L’autre cinquantenaire : l’oubli de Maran (1887-1960 », Africultures, 6 septembre 2010.
[20] On utilise ici l’édition Galimard Folio, 2022.
[21] René Maran a écrit deux livres sur Brazza : Brazza et la fondation de l’AEF (1941) et Savorgnan de Brazza (1951). Le rapport de Brazza condamnait fortement les pratiques des sociétés concessionnaires et les exactions des tirailleurs et de certains administrateurs, 20 ans avant Gide. Or, Gentil à l’époque et ses successeurs jusqu’à Antonetti n’ont jamais infléchi le fonctionnement global, l’administration coloniale passant toujours outre aux critiques qui se sont renouvelées sans effet réel.
[22] Ils le seront en mars 2014 par Catherine Coquery-Vidrovitch.
[23] Accusés de plusieurs meurtres, dont celui d’avoir, le 14 juillet 1903, fait exploser un prisonnier avec une cartouche de dynamite. Cf. J.D. Pénel introduction à Henri Cyral Les Mystères coloniaux : l’étoile des savanes, L’Harmattan, 2023.
[24] Cité par Onana René Maran, le premier Goncourt noir (1887-1960), Duboiris, 2007. Le livre de Gide paraît en 1927, mais dans la revue de la NRF en feuilleton à partir de novembre 1926.
[25] En décembre 1921, Maran et Chardonne étaient ex-aequo au Goncourt. La voix du président avait fait pencher la balance en faveur de Maran.
[26] Cf. Ambre Philippe : « André Gide au cœur de la question pédophile », Année Zéro, 21 janvier 2022.
[27] Il s’agit de Marie-Joseph-Louis-Albert Louard, chef de la circonscription du Bas-Mbomou, dont René Maran ne donne le nom que dans l’article du 17 avril.
[28] Havelock Ellis (que René Maran mentionne souvent) publie Sexual inversion en 1909 ; la troisième édition (qui cite Gide) date de 1927.
[29] Serait-ce celui des fils du sultan dont Gide dit : « Le troisième, qui n’a pas vingt ans (en 1925) est revenu à Rafaï où il reste auprès de son père. C’est un grand garçon timide, qui vient nous serrer la main puis se retire » (10 octobre 1925) ?
[30] Il prend sa retraite comme administrateur de 2ème classe le 31 décembre 1924. Il avait commencé sa carrière oubanguienne en 1909-1910, en même temps que René Maran.
[31] Si l’on se fie à l’initiale du nom, ce pourrait être Bellivier, administrateur adjoint de 3ème classe qui fut chef de la subdivision de 1916 à 1918 puis de 1919 à 1920.
[32] H. Galli, dans sa thèse, Échappée en morphologie dérivationnelle : approche épistémologique de la discipline avec application au préfixe français ‘en-‘ (Zurich, 2006) figure le verbe ‘engider’.
[33] Le Dictionnaire français de l’homosexualité masculine[1] indique que le verbe ‘enculer’ « figure évidemment dans la langue du romancier Louis-Ferdinand Céline, avec un assez grand nombre de variantes, dont engider ».
[34] Par exemple La Dépêche de Brest : « Je paierais volontiers les frais d’hôtel à celui qui réunirait dans une villégiature très campagnarde, Mlle André Gide, comme dit ce terrible Henri Béraud, et une femme de lettres dans le genre mettons de Georges Sand pour n’offenser aucune vivante. Ce n’est peut-être pas Corydon que s’appellerait leur roman » (23 octobre 1924) ; « Quand une littérature pourrie déferle aux devantures des librairies, quand André Gide raconte, pour l’émerveillement, comment on peut se faire salement caresser par un négrillon » (29 janvier 1927) ; « une littérature officielle de l’inversion dont M. André Gide fut le représentant le plus significatif » (12 décembre 1927), etc.
[35] Reproduit dans BAAG octobre 2008, n°160. Gide est qualifié de « chef de l’école corydonesque », de « Corydon impénitent ».
[36] René Maran Un homme pareil aux autres (1947).
[37] Denise Moran avait la particularité d’avoir vécu dans l’administration coloniale au Tchad pendant trois ans. Son livre Tchad (1934) et auparavant ses articles (dans La Lumière et dans Le Populaire sa série ‘En écoutant battre le cœur de l’Afrique, en 1932, où elle cite René Maran) s’appuyaient sur son vécu et sur les archives des postes où elle avait servi.
[38] Voir dans le BAAG, les remarques de D. Durosay et d’Anny Wynchank.
[39] Lettre du 22 novembre 1922 au ministre.
[40] Le 23 août 1925, Gide retranscris un passage du n°2 du Bulletin de la Société de recherches congolaises, le n° 1 de 1922 avait été introduit par Alfassa.
[41] Cf. J-D. Pénel René Maran et l’Afrique centrale (Dumerchez, 2022) p 95-102.
[42] Alain Couturier dans sa biographie Le Gouverneur et son miroir, Marcel de Coppet (1881-1968) (L’Harmattan, 2006) ne mentionne pas René Maran quand il était au Tchad en même temps que de Coppet ! L’attitude de René Maran vis-à-vis de de Coppet va de la critique (Bec et Ongles du 4 mars 1933) à l’éloge (Présence Africaine 1949).
[43] Le titre exact est : Langues Sango, Banda, Baya, Mandjia : notes grammaticales, mots groupés d'après le sens, phrases usuelles, vocabulaire, préface de M. Gaudefroy-Demombynes, Larose, 1918. Pour montrer qu’il sait un peu de sango, dans la nuit du 27 octobre à Ngoto, quand quelqu’un veut entrer, il interroge : « Nous crions en sango : Zo nié ? (Qui est là) ».
[44] Cf. le livre de l’historien centrafricain R. Nzabakomada-Yakoma L’Afrique centrale insurgée. La guerre du Kongo-Wara, 1928-1931 (L’Harmattan, 1986).
[45] C’est un film muet. Si on se réfère aux cartons du film donnés par D. Durosay (BAAG, n°101, p 74) l’un d’entre eux, avant les danses dakpas, affiche « Après l’excision, jeunes filles N’Zakaras dansant sous la conduite des matrones ». C’est une erreur car l’excision n’existe pas chez les Nzakaras mais chez les Bandas (dont les Dakpkas sont un sous-groupe).
[46] Cf. F. Martin et J.D. Pénel Le Passage de la Croisière noire au Niger, L’Harmattan, 2022.
[47] Cf. Daniel Durosay, « Les images du Voyage au Congo. L’œil d’Allégret », BAAG, janvier 1987, n°73 ; « Images et imaginaire dans le Voyage au Congo. Un film et deux auteurs », BBAG, octobre 1988, n°80 ; « Les cartons retrouvés du Voyage au Congo » BAAG, janvier 1994, n°101.
[48] Cf. André Morello « Lire Bossuet au Congo. Gide à la frontière des préjugés et de l’ethnologie » BAAG janvier-avril 2013, n°177-178.
[49] Cf. Walter Putnam : « Conrad, Gide et le Congo » BAAG, octobre 1988, n°80.
[50] Initialement publié dans la revue Commerce (cahiers trimestriels publiés par les soins de Paul Valéry, Léon-Paul Fargue, Valéry Larbaud) du 1er septembre à l’automne 1926 puis en février 1927 aux éditions La Lampe d’Aladin.
[51] Aux recueils de René Maran cités avant 1925 dans ‘introduction, il faut ajouter Les Belles images (1935), Peine de cœur (1941), Le Livre du souvenir (1958).
[52] René Maran : Le Cœur serré (1931), Un homme pareil aux autres (1947).
[53] Le livre de Charles Du Bos, Le Dialogue avec André Gide, paraît en 1928.